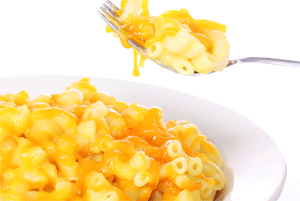
Les participants à la recherche du Département de médecine sociale et préventive sont passés à table pour manger ce qu'ils croyaient être le macaroni rassasiant, mais qui était en fait le classique macaroni au fromage.
Hélène Arguin, Marlène Gagnon Sweeney, Étienne Pigeon et Angelo Tremblay ont invité 18 hommes à se présenter à trois reprises à leur laboratoire pour y consommer un macaroni au fromage. Lors de deux premières visites, les chercheurs leur servaient, en alternance, un macaroni ordinaire ou un macaroni rassasiant contenant davantage de protéines, de fibres, d'acides gras insaturés et de calcium. Les deux plats avaient la même densité énergétique, la même apparence, le même goût et la même texture. Les détails sur la composition des deux macaronis n'étaient pas divulgués aux participants. La seule consigne qui leur était donnée était de manger à leur faim. Ce qu'ils firent.
Un mois plus tard, avant de procéder au troisième test, les chercheurs ont expliqué à chaque participant que le but du projet était la mise au point et la commercialisation d'un plat rassasiant. Ils leur ont montré, tableaux et graphiques à l'appui, que les résultats des deux premiers tests permettaient de conclure que le macaroni rassasiant remplissait toutes ses promesses. Le hic: les chercheurs avaient inventé ces données de toutes pièces. En effet, les résultats des deux premières visites n'avaient révélé aucune différence au chapitre de la quantité de calories consommées ni des mesures d'appétabilité, d'apparence, de goût, de texture et d'assaisonnement des deux plats. «Nous avons joué le jeu de la pub exagérée afin de voir si les perceptions des participants s'en trouveraient modifiées», résume Angelo Tremblay.
Les participants sont donc passés à table pour manger ce qu'ils croyaient être le macaroni rassasiant, mais qui était en fait le classique macaroni au fromage. Résultat? Les sujets ont attribué un meilleur score à tous les aspects touchant l'évaluation du plat et, dans les heures qui ont suivi le repas, ils se disaient plus rassasiés que lors des deux premiers tests, même si le nombre de calories consommées était comparable. «Cet effet placebo attribuable au contexte peut influencer à la hausse l'appréciation d'un plat et la perception de son pouvoir rassasiant», conclut le professeur Tremblay. Pour cette raison, il estime essentiel que toute allégation touchant les produits rassasiants repose sur des résultats convaincants obtenus en appliquant à la lettre les règles de la démarche scientifique. «À défaut de quoi, un fabricant de produits alimentaires rassasiants pourrait s'enrichir en vendant des illusions.»


























