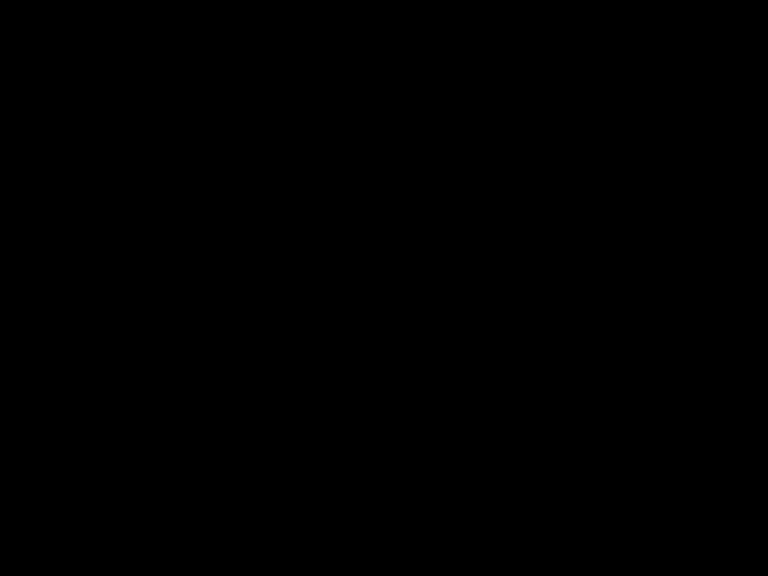
«Il y a eu des progrès sur certains points», indique Philippe Le Prestre, directeur de l’Institut EDS de l’Université Laval. Le jeudi 21 janvier, ce dernier a livré ses impressions sur la conférence de Copenhague, sur l’accord et ses conséquences, devant une salle comble au pavillon Gene-H.-Kruger. «L’accord, poursuit-il, prévoit des engagements financiers de 30 G$ pour la période 2010-2012 destinés aux pays les plus pauvres dans leur lutte aux GES. Il reconnaît aussi l’importance de la lutte au déboisement par la mise en place d’un mécanisme de transfert de technologies vers les pays en développement.» Précisons que le déboisement a pour effet de rejeter dans l’atmosphère le carbone préalablement stocké par les forêts.
Le professeur Le Prestre souligne qu’une certaine pagaille a caractérisé les discussions. «Il est vrai, explique-t-il, que le comportement de la présidence danoise et le manque de transparence ont accru les incertitudes quant au déroulement des négociations ainsi que la méfiance et les craintes des parties, particulièrement de nombreux pays en développement.»
Selon lui, il faut retenir de la conférence la visibilité politique de 119 chefs d’État et de gouvernement, ainsi que la forte présence de la société civile aux discussions, soit la moitié des quelque 45 000 personnes accréditées. «D’autre part, dit-il, le processus de négociations se poursuit, les populations s’attendent à des actions énergiques de leurs gouvernements et l’accord est considéré comme une feuille de route, un cadre général pour les négociateurs qui se retrouveront à Bonn en juin, la prochaine conférence ministérielle étant prévue pour décembre à Mexico.»
Au passif de Copenhague, il y a tout d’abord l’absence, dans l’accord final, de cibles de réduction des émissions de GES et l’absence d’échéances. Les négociations ont renforcé la méfiance entre les pays industrialisés et les pays en développement. Critiqué, le processus de négociations aurait de beaucoup miné la crédibilité de l’ONU. L’Union européenne, qui prônait des objectifs ambitieux, s’est retrouvée suffisamment marginalisée pour que Philippe Le Prestre se demande si elle continuera à aller de l’avant.
Selon ce dernier, Copenhague a signé l’arrêt de mort du protocole de Kyoto. «Kyoto, à mon avis, est bien mort, affirme-t-il. On n’a pas d’engagements.» L’accord vient en outre renforcer une dynamique à l’œuvre depuis quelques années qui consiste à négocier sur le changement climatique dans des forums parallèles en dehors de l’ONU. «Je pense qu’une approche caractérisée par des accords volontaires et régionaux est beaucoup plus probable pour la suite des choses que le modèle du protocole de Kyoto», soutient le professeur Le Prestre.


























