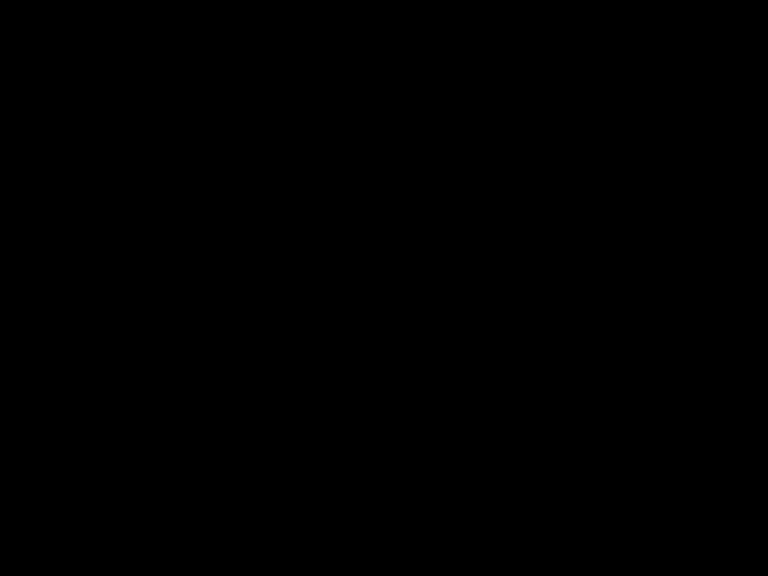
Contrairement à ce que croyaient plusieurs aménagistes de la faune, la martre n'est pas inféodée aux forêts matures.
— Jérôme Rioux
C’est en raquettes et muni d’un système GPS que l’étudiant-chercheur a sillonné le territoire de la forêt Montmorency, la forêt expérimentale de l’Université Laval située à 70 kilomètres au nord de Québec, à la recherche de pistes de martres. «Les empreintes laissées par les animaux sont nettes dans cette région parce que la neige est abondante et légère», précise-t-il. L’envers de la médaille est que, même en raquettes, on s’y enfonce jusqu’aux genoux de sorte qu’il est loin d’être commode de s’aventurer là où circulent les martres, des animaux de la taille d’un chat. «J’ai perdu une quinzaine de livres chaque hiver», souligne l’ingénieur forestier.
Le moment idéal pour étudier les pistes survient environ 24 heures après une chute de neige ou une période de vents violents parce que ces événements météorologiques «remettent tout à zéro, comme une brosse qui efface la craie sur un tableau», dit-il. S’il ne neige pas pendant une semaine, il y a tellement de pistes qui se croisent qu’il devient impossible de les distinguer. Pour s’assurer de ne pas interférer avec le comportement naturel des martres, l’étudiant-chercheur a effectué ses relevés dans le sens contraire de la direction de l’animal, s’assurant ainsi de s’en éloigner. «En deux hivers, je n’ai pas vu une seule martre à la forêt Montmorency», souligne-t-il.
Grâce à ses patients efforts, l’étudiant-chercheur a cartographié avec précision 34 pistes de martres couvrant un total de 57 kilomètres. «Je ne voulais pas étudier uniquement la présence de l’animal dans différents peuplements forestiers, mais aussi l’utilisation qu’il en faisait. Je me suis donc intéressé aux déplacements sinueux des martres parce qu’ils sont indicateurs d’un comportement de chasse.» Il a aussi cartographié toutes les pistes de proies (lièvres et écureuils) qui croisaient celles du petit carnivore. En transposant le tout sur la carte des peuplements forestiers de la forêt Montmorency, il a démontré que lorsqu’elle est en quête de nourriture, la martre fait peu de cas de l’âge de la forêt, cueillant plutôt le fruit où il se trouve. «La martre chasse là où ses proies sont abondantes, peu importe l’âge du peuplement», résume-t-il.
Ces observations, tout comme la thèse de doctorat de François Potvin déposée à l'Université en 1998, remettent en question la réputation de la martre comme spécialiste des forêts matures. Il ne faut pas conclure pour autant que ces peuplements forestiers ne sont pas importants pour cette espèce, prévient l'étudiant-chercheur. La martre se réfugie dans les arbres morts encore sur pied ou dans des troncs d’arbres couchés au sol pour se reposer ou fuir ses propres prédateurs, et c’est surtout en forêts surannées qu’on les trouve. Si l’on veut contenter tous les besoins de la martre, il faut aménager la forêt de façon à lui fournir nourriture, gîte et couvert. «Pour y arriver, explique Charles Vigeant-Langlois, il faut maintenir une diversité dans la structure d’âge des peuplements. La martre est l’une des espèces forestières les plus plastiques qui soient, mais si on ne fait que des coupes à blanc, elle va disparaître du milieu.»


























