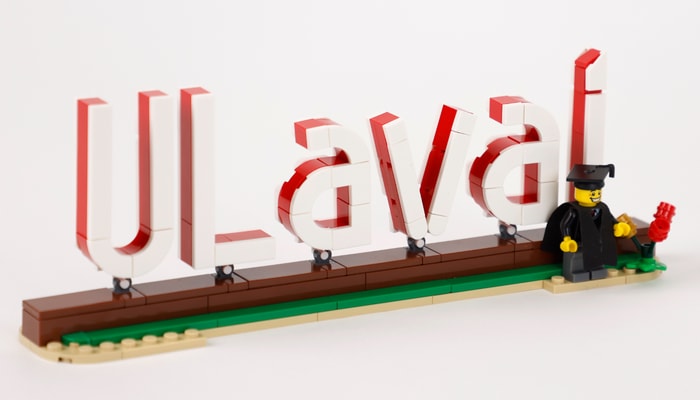L’allongement de la période active de la retraite, comme prolongement du travail régulier, est un phénomène social d’envergure. Il pose bien des défis institutionnels et l’Université n’y échappe pas!
Certes, la raison d’être de l’Université demeure inchangée: développer et transmettre, dans les différentes disciplines et dans une perspective critique, un savoir de haut niveau. Elle la réalise principalement avec le concours d’un personnel professionnel, en grande partie professoral, pleinement engagé dans des activités de recherche et d’enseignement, appuyé par du personnel administratif. Les programmes d’enseignement, eux-mêmes de différents niveaux, s’adressent dans leur ensemble à une population relativement jeune et le souci de préparer adéquatement les nouvelles générations au marché du travail est aussi très présent. Tel apparaît donc toujours le «noyau dur», l’activité dominante de l’Université.
Mais, font tout aussi intimement appel à la finalité même de l’Université les aspirations au savoir de cette population en période active de retraite; peuvent par ailleurs contribuer à réaliser cette finalité ces retraités de l’Université à la fois aptes et désireux de le faire. Il en est ainsi même si les éléments humains en cause peuvent paraître quantitativement secondaires par rapport à ce «noyau dur» précédemment évoqué.
Dans l’un et l’autre cas, l’Université Laval fait déjà montre d’heureuses initiatives. À titre illustratif, en plus d’accueillir, comme elle le doit d’ailleurs, dans ses programmes réguliers et d’études libres des étudiant(e)s sans égard à leur âge, son Université dite du 3e âge comptait quelque 7 300 inscriptions réparties entre ses différents cours et activités durant la dernière année universitaire. Pour ce qui est de la participation d’universitaires retraités à l’activité de l’Université Laval, mentionnons l’apport, en principe à titre gracieux, de quelque sept cents professeurs retraités et sans lien d’emploi avec cette dernière, dits «professeurs associés», dans ses différents départements et facultés. Cette dernière contribution, qui ne saurait pour autant se substituer à l’activité du corps professoral régulier, se manifeste de diverses façons: mentorat informel d’étudiants avancés et même de nouveaux collègues, participation à des jurys de thèse, à des comités d’évaluation de programmes de recherche et à des groupes de recherche, organisation de colloques scientifiques, rédaction d’articles ou d’ouvrages scientifiques, etc. De même, plus particulièrement, le quart des professeurs qui assuraient les cours de la précédente Université du 3e âge étaient des professeurs retraités de l’Université Laval. En ce qui a trait au personnel professionnel, il convient de mentionner sa participation bénévole à divers comités.
Mais, on ne peut dire pour autant que prévaut encore à l’Université Laval, pas plus d’ailleurs que dans les autres universités francophones du Québec, une solide tradition de mise à contribution et de reconnaissance institutionnelle d’universitaires retraités, encore actifs, à la fois aptes et désireux de contribuer à son activité, tradition que l’on retrouve, plus ou moins formellement ancrée, ailleurs dans des milieux universitaires nord-américains, pour ne pas parler d’Oxbridge… Certaines des principales universités canadiennes en sont même présentement à réaliser des projets qui faciliteront la participation active de leur personnel retraité à la vie du campus: une résidence pour ses retraités (et ceux d’autres universités) à l’Université de Colombie-Britannique; un centre établit avec le concours de son association de retraités à l’Université Queen’s de Kingston, et ce, «afin de faciliter l’implication de retraités dans la vie académique de l’Université».
Le présent contexte social impose donc à l’Université de tenir pour intimement liés à sa vocation première à la fois les besoins intellectuels et la participation active des retraités, en particulier les siens. Elle ne doit pas hésiter à intégrer ces aspects par des moyens innovateurs.
Une telle attitude d’ouverture de l’Université sur la mixité générationnelle ne peut qu’être source de vitalité intellectuelle. Ce qui est vrai de l’aspiration internationale de l’Université Laval et de ses répercussions sur ses membres étudiants et professoraux vaut aussi de sa composition intergénérationnelle. Comme dans les entreprises en général, il est nécessaire d’assurer un transfert intergénérationnel des connaissances et des valeurs: il y a là tout un patrimoine humain à préserver! Non seulement doit-il en être ainsi de l’Université, mais les contacts intergénérationnels entre ses membres et la confrontation positive des idées et des valeurs qu’elle engendre ne peuvent qu’y favoriser le développement d’un savoir adapté aux besoins de la société contemporaine. Il importe donc d’étudier, sur le plan de la recherche et sur le plan de l’administration, les moyens à mettre en œuvre pour que l’Université Laval soit encore plus intergénérationnelle.
PIERRE VERGE
Professeur émérite
Faculté de droit