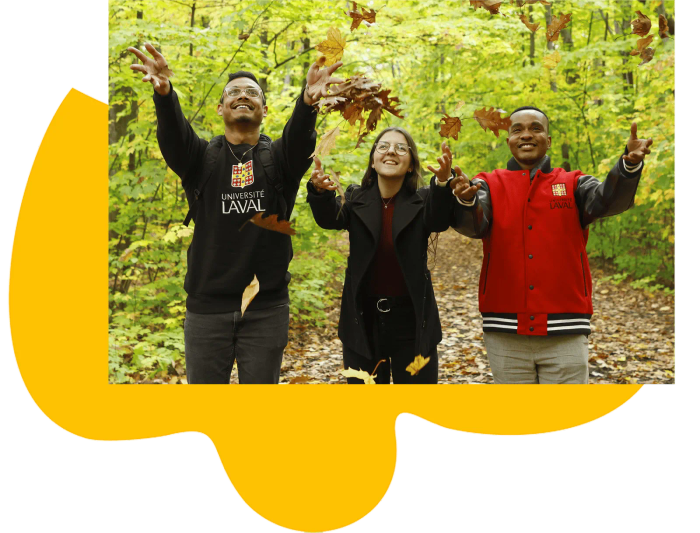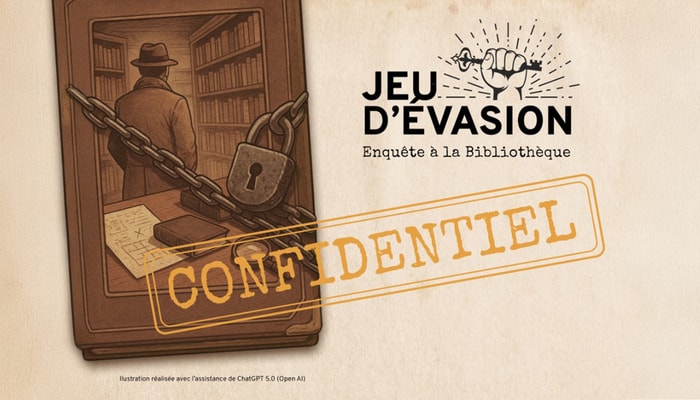Considérées comme les plus longues à l'est des Rocheuses, les grottes de Boischatel offrent près de 3 km de réseaux souterrains cartographiés.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval
En ce matin frais d'octobre, un petit groupe d'étudiants de la Faculté des sciences et de génie se prépare à pénétrer dans les grottes de Boischatel, un réseau souterrain rarement accessible au grand public.
Avec ses 2,5 kilomètres de passages tortueux, cette cavité est la plus longue grotte à l'est des Rocheuses. Son âge exact reste incertain: certaines analyses évoquent 10 000 ans, d'autres jusqu'à 35 000. Une chose est sûre, elle n'a pas encore livré tous ses secrets.
Encadrés par le professeur Richard Fortier et accompagnés d'une guide spéléologue, les étudiants ne participent pas à une simple sortie éducative. Leur mission: explorer les grottes à travers une série d'activités alliant observation, mesure et interprétation. Tout cela s'inscrit dans le cadre du cours Méthodes de terrain en génie géologique, offert chaque automne. «Selon les dires des étudiants, cette sortie à Boischatel est la plus belle de leur programme de baccalauréat en génie géologique», se réjouit le professeur Fortier, qui organise cette activité depuis 2013.

À l'extérieur de la grotte, l'attente se charge d'un mélange de tension et d'excitation.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval
Guide chez Spéléo Québec, Geneviève Lamarre donne les dernières instructions et consignes de sécurité. Casques bien ajustés, lampes frontales allumées, nous voici prêts à pénétrer dans la grotte. Les étudiants s'engagent un à un dans une petite ouverture au ras du sol.
L'entrée dans la grotte n'est pas une mince affaire: il faut ramper à quatre pattes dans un boyau étroit. La roche est froide, les parois sont boueuses et le matériel doit être poussé devant soi sur plusieurs mètres. Mais une fois le corps contorsionné à travers cette première étroiture, le décor change: de vastes salles apparaissent, entrecoupées de passages sinueux, sculptés par l'eau au fil du temps.
À un moment, la guide demande au groupe d'éteindre ses lampes. L'obscurité devient totale, le silence, saisissant. Privés de repères visuels et sonores, nous découvrons une autre dimension de la grotte, aussi impressionnante que déroutante.

Avec des noms de galeries et de passages comme la «Passe des taupes disloquées» ou l'«Étroiture des lamentations», les grottes de Boischatel pourraient faire frissonner les claustrophobes… Mais l'aventure reste parfaitement sécuritaire, à condition d'être bien encadrée par un guide expérimenté.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval
D'une galerie à l'autre, chaque arrêt permet d'observer différents phénomènes: stratification des roches, dépôts de calcite, traces d'érosion, stalactites. Les étudiants notent, observent, questionnent mais aussi s'émerveillent.
«Avec ce genre de sortie, on réalise concrètement ce qu'on voit en cours, souligne William Lortie, étudiant au baccalauréat en génie géologique. C'est bien plus parlant qu'un PowerPoint. C'est ce qui rend notre programme aussi intéressant: il est axé sur la pratique, avec plusieurs sorties terrain. On est vraiment privilégié.»
Pour la guide Geneviève Lamarre, accompagner un groupe d'étudiants en génie géologique offre une expérience différente des visites destinées au grand public. «Ce que j'aime avec les étudiants en génie géologique, c'est qu'ils attendent cette sortie avec impatience. Ils sont toujours très enthousiastes. Leurs questions et leurs observations ne sont pas les mêmes que celles du grand public. Ça me permet d'aborder d'autres aspects, d'expliquer des choses différentes.»

Avec leurs textures fascinantes, les roches se révèlent comme de véritables œuvres d'art façonnées au fil des siècles.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval
La visite ne s'arrête pas à l'intérieur des galeries souterraines: elle se prolonge à l'extérieur, dans les boisés, avec l'analyse de plusieurs phénomènes karstiques. Pertes d'eau le long de la rivière Ferré, lit asséché, dolines, résurgences en bordure de la rivière Montmorency: autant d'indices de l'activité souterraine. «Il y a bien sûr la grotte sous nos pieds, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour, rappelle Geneviève Lamarre. Les étudiants font un portrait complet des phénomènes, ce qui leur donne une vision d'ensemble du lieu.»

Christian Dupuis, directeur du Département de géologie et génie géologique, initie deux étudiants à l'utilisation d'un appareil pour détecter les variations de gravité.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval

Le professeur Richard Fortier a de la relève. On le voit ici avec son fils, Philippe, doctorant en sciences de la Terre, venu lui prêter mainforte pour animer un atelier.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval

Bien que la grotte ait été découverte en 1979, plusieurs aspects scientifiques restent méconnus. Pour les étudiants qui souhaitent creuser ces questions, il y a là diverses possibilités de projets de maîtrise ou de doctorat, a rappelé la guide Geneviève Lamarre aux participants.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval

Ces étudiantes participaient à la visite de l'après-midi dans les grottes. Une sortie qui restera assurément gravée dans leur mémoire, tant par sa richesse scientifique que par son intensité.
— Louis-Vincent Aubert - Université Laval