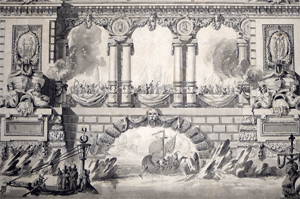
De la Fosse, Fête de la Paix, dessin, 1763, Musée du Louvre
Absence de rappel
Selon Alain Laberge, l’opinion de Voltaire témoigne non seulement de la distance géographique importante entre Paris et ses colonies d’Amérique du Nord, mais aussi d’une très grande distance affective. La fin de la guerre de Sept Ans ramène bien évidemment la paix et le bon peuple s’en réjouit. Mais la France vient tout de même de perdre gros en restituant à la Grande-Bretagne le Canada, l’Acadie et d’autres territoires. Lors des préparatifs et du déroulement des Fêtes de la Paix de juin 1763 à Paris, aucune allusion n’est ainsi faite sur les résultats de la guerre et sur la teneur du traité. Cette absence de rappel n’est pas surprenante en soi, mais montre à quel point Voltaire avait raison quand il affirmait que la France n’avait pas besoin du Québec pour être heureuse. Cela dit, malgré les énormes pertes qu’a connues la France, les Fêtes de la Paix de 1763, d’une durée de trois jours, battront leur plein dans les rues de la ville de Paris, comme le veut la coutume lorsqu’un conflit d’importance se termine. Selon Alain Laberge, ces fêtes diffèrent cependant quelque peu des autres. La première journée est ainsi mobilisée par une cérémonie d’inauguration d’une statue équestre du roi sur la nouvelle Place Louis-XV, à peu près où se trouve aujourd’hui la Place de la Concorde. Or, fait remarquer Alain Laberge, l’élaboration de cette place remonte à la fin de la guerre de Succession d’Autriche, en 1748, où la France avait été victorieuse.
«En procédant à cette inauguration, la France a peut-être voulu récupérer en quelque sorte la victoire de 1748, estime Alain Laberge. Comme si elle avait voulu mettre un baume sur l’immense défaite de la guerre de Sept Ans et en minimiser les pertes. Une chose est certaine, pendant ces trois jours de fête, on n’a senti aucune amertume chez les Français.»


























