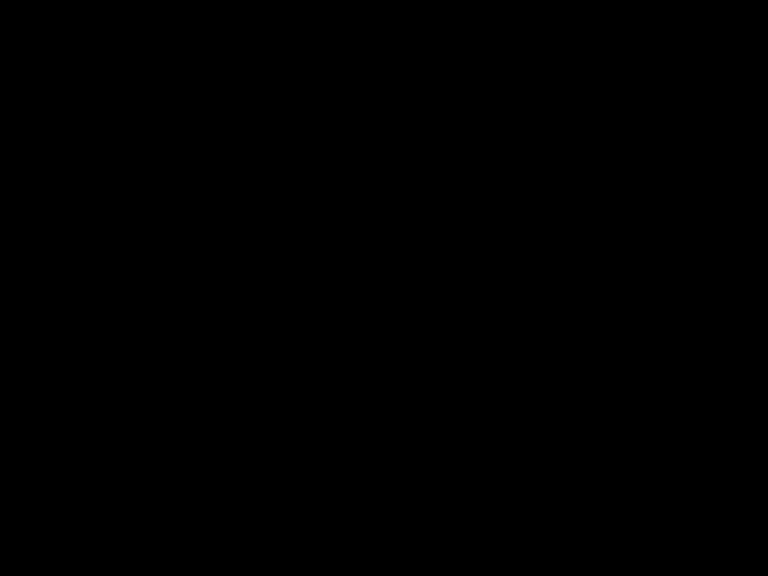
Les analyses effectuées par l'étudiante-chercheuse Sabrina Simard révèlent que l'eau des piscines contient de deux à cinq fois plus de matières organiques que l'eau du robinet.
Cette étude, qui s’inscrit dans les activités de la Chaire de recherche en eau potable, repose sur 5 800 analyses portant surtout sur la présence de sous-produits de désinfection (SPD) dans l’eau des piscines. Les SPD proviennent de la réaction chimique entre le chlore, utilisé pour détruire les microorganismes présents dans les piscines, et la matière organique qui s’y trouve. On pense principalement aux cheveux, à la sueur, aux saletés et tutti quanti introduits dans la piscine par les baigneurs.
Les deux principales classes de SPD sont les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques (AHA). En concentrations élevées, on les soupçonne d’augmenter les risques de certains cancers. En 2001, le Québec a adopté des normes pour les THM dans l’eau potable auxquelles les municipalités se plient progressivement. Quant aux AHA, ils ne sont pas encore réglementés au Québec, mais ils devraient l’être d’ici quelques années. Par contre, il n'existe aucune réglementation qui fixe une concentration limite pour ces deux familles de produits chimiques dans l’eau des piscines.
Les analyses effectuées par l’étudiante-chercheuse révèlent que l’eau des piscines contient de deux à cinq fois plus de matières organiques que l’eau du robinet. La situation est pire dans les bassins extérieurs, puisqu’on y retrouve deux fois plus de matières organiques que dans les piscines intérieures. La présence de matières organiques dans l’eau a une incidence directe sur la formation des SPD. Ainsi, la concentration moyenne annuelle des AHA atteint de 8 à 50 fois celle de l’eau potable. Il est plus difficile d’obtenir un chiffre précis pour les THM parce que ce sont des produits volatils.
Environ 30 % des variations dans la concentration des AHA s’explique par le nombre de baigneurs qui ont récemment utilisé la piscine. «C’est un facteur important, mais il ne raconte pas toute l'histoire», observe Sabrina Simard. La quantité de chlore ajoutée à l’eau des piscines a une incidence directe sur l’abondance des SPD. Les gestionnaires de piscines marchent sur une corde raide, reconnaît l’étudiante-chercheuse: pas assez de chlore et la qualité bactériologique de l'eau est menacée; trop de chlore et la production de SPD monte en flèche. «Présentement, leur préoccupation première, c'est la qualité bactériologique de l'eau. Il est même possible que certains gestionnaires ignorent l’existence des SPD. L’absence de cadre réglementaire pour ces produits ne facilite pas leur gestion dans l’eau des piscines.»
En attendant l’adoption de normes, il existe un outil auquel les gestionnaires pourraient avoir davantage recours pour équilibrer le risque bactériologique et le risque chimique: le renouvellement de l’eau des piscines. En effet, les données indiquent que les piscines qui font le moins de renouvellement d’eau sont celles qui ont le plus de SPD. «En procédant fréquemment au renouvellement d'une partie de l'eau du bassin, on obtient une eau contenant moins de microorganismes, ce qui évite de chlorer inutilement, explique Sabrina Simard. Comme on ajoute alors moins de chlore, ceci minimise également la formation de SPD.» Le seul frein à un recours plus régulier à cette procédure: la facture de pompage et de chauffage de la piscine entraînée par l’ajout d’eau fraîche. «Ces coûts n’ont pas été chiffrés, mais on pourrait tester différents scénarios de renouvellement pour les évaluer», propose Manuel Rodriguez.
Entre-temps, comme il n’y a pas de preuves épidémiologiques indiquant que plus de cancers frappent les baigneurs, le professeur Rodriguez croit qu’il est sécuritaire de fréquenter les piscines publiques. «Par contre, il faudrait quand même que les gestionnaires de piscines prennent conscience de l’existence des SPD et qu’ils utilisent les outils à leur disposition pour en abaisser la concentration, tout en maintenant la qualité microbiologique de l’eau.»


























