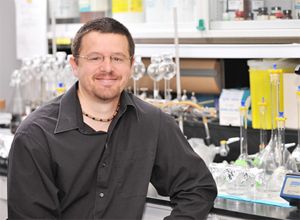
Sébastien Bonnet, professeur à la Faculté de médecine: «La DHEA ne coûte pas cher, elle n'est pas toxique et elle agit de façon sélective sur les cellules en cause dans certaines maladies vasculaires obstructives».
— Marc Robitaille
L'obstruction des vaisseaux sanguins survient à la suite d'une lésion ou d'une inflammation qui provoque la multiplication anarchique des cellules musculaires lisses que renferme leur paroi. «Ces cellules ne répondent plus aux signaux de régulation, et elles se multiplient comme des cellules cancéreuses», explique le professeur Bonnet. L'intervention chirurgicale pratiquée pour débloquer les artères, l'angioplastie – une dilatation effectuée à l'aide d'un ballon, suivie par la pose d'un tuteur vasculaire (stent) –, ne constitue pas une panacée. Dans les mois qui suivent la chirurgie, il y a récidive de l'obstruction chez 25 à 50 % des patients. «L'intervention cause des petites lésions qui réenclenchent le mécanisme responsable de l'obstruction», explique le chercheur.
À l'aide de cellules provenant de vaisseaux sanguins humains, le professeur Bonnet et ses collaborateurs ont démontré que la DHEA inhibe la multiplication et favorise la mort (apoptose) des cellules musculaires des vaisseaux malades, sans altérer les vaisseaux sains. Les chercheurs ont observé les mêmes effets in vivo chez des animaux de laboratoire à qui cette hormone a été administrée par voie orale pendant une semaine. La DHEA parvenait à bloquer le mécanisme conduisant à l'obstruction et même à dégager les artères obstruées.
La DHEA est une hormone stéroïdienne présente naturellement dans le corps humain, mais dont l'abondance décroît avec l'âge. «La DHEA ne coûte pas cher, elle n'est pas toxique et elle agit de façon sélective sur les cellules qui causent le problème. Ces caractéristiques en font un produit idéal pour prévenir ou pour traiter certaines maladies vasculaires obstructives», résume le professeur Bonnet. «Une étude clinique sur 12 sujets est présentement en cours et les résultats préliminaires sont très encourageants», ajoute-t-il.
L'article qui paraît dans Circulation est signé par Sébastien Bonnet, Roxane Paulin et Mélanie Roy, de la Faculté de médecine de l'Université Laval, et Gopinath Sutendra, Peter Dromparis, Kristalee Watson, Jayan Nagendra, Alois Haromy, Jason Dyck et Evangelos Michelakis, de l'Université de l'Alberta.


























