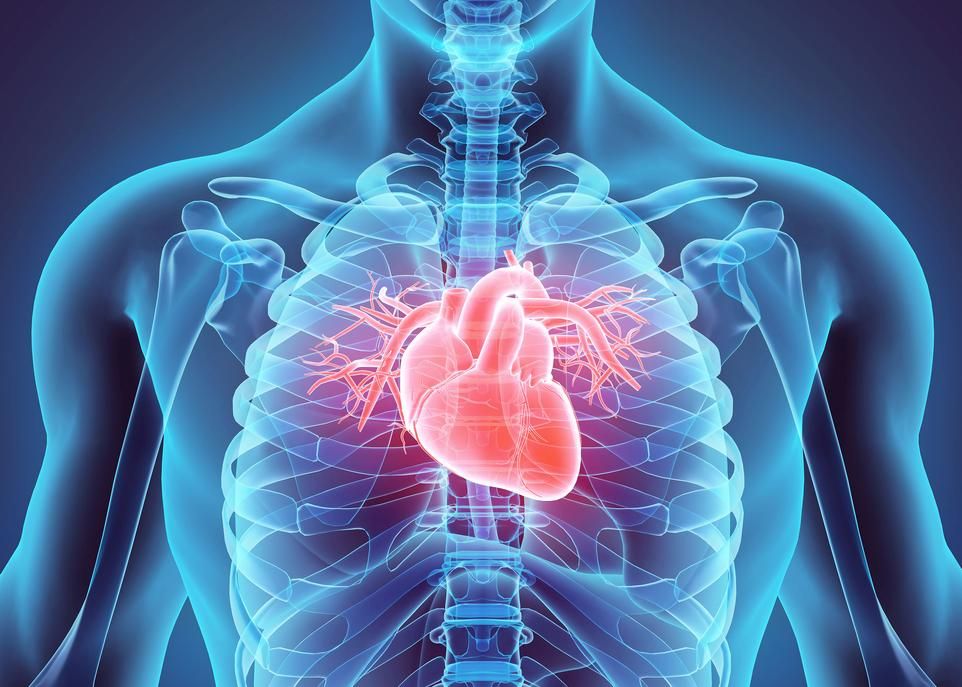
Environ 2% de la population souffre d'une maladie touchant les valves cardiaques. Chez les personnes de 75 ans ou plus, ce chiffre dépasse 10%. La plus grande partie des travaux de la nouvelle chaire portera sur l'amélioration des dispositifs et des interventions servant à traiter ces maladies.
Les cardiopathies structurelles regroupent les problèmes touchant le coeur, à l'exclusion de ceux liés aux artères. Elles comprennent notamment les anomalies congénitales et les problèmes de formation de caillots dans l'appendice auriculaire – une petite poche de l'oreillette gauche – chez les personnes qui souffrent d'arythmie. «La plus grande partie de nos travaux porte toutefois sur les valves cardiaques», précise le professeur Rodés-Cabau. Et pour cause. On estime, en effet, que 2% de la population souffre d'une valvulopathie; chez les personnes de 75 ans ou plus, ce chiffre se situe entre 10 et 15%.
Le coeur compte 4 valves cardiaques, des structures élastiques non contractiles qui contrôlent le passage du sang d'une cavité cardiaque vers une autre. Lorsque ces valves ne s'ouvrent pas complètement, on dit qu'il y a rétrécissement ou sténose. Lorsque leur fermeture n'est pas étanche, il y a insuffisance ou fuite. À partir des années 1960, le traitement des valvulopathies graves a consisté à remplacer une valve cardiaque en pratiquant une intervention à coeur ouvert. Il y a une quinzaine d'années, une procédure beaucoup moins invasive a été introduite: l'implantation de la valve est effectuée à l'aide de petits instruments que le médecin guide jusqu'au coeur du patient grâce à l'assistance d'appareils d'imagerie médicale, en empruntant un gros vaisseau comme l'artère fémorale, par exemple.
La première intervention du genre pour traiter une sténose aortique sévère a été réalisée en France en 2002. Cinq ans plus tard, le professeur Rodés-Cabau et ses collègues Robert De Larochellière, Daniel Doyle et Éric Dumont réalisaient la première implantation de valve cardiaque aortique par cathéter à Québec. Depuis, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a effectué près de 1 000 interventions du genre. «Cette approche a fait ses preuves, mais il y a moyen de faire mieux et c'est justement ce à quoi nous allons travailler. Il reste encore des aspects à raffiner, notamment pour adapter les techniques aux spécificités de chaque patient, souligne le professeur Rodés-Cabau. Par exemple, une proportion importante de patients qui reçoivent une valve aortique par cathéter présentent des anomalies du rythme cardiaque après l'intervention. Il faut donc déterminer les causes de ces anomalies afin d'en diminuer la fréquence et d'améliorer le traitement.»
Au cours des cinq dernières années, le professeur Rodés-Cabau a signé ou cosigné près de 200 publications scientifiques sur le traitement par cathéter des cardiopathies structurelles. À titre d'expert du domaine, il a aussi conseillé une dizaine d'entreprises dans la mise au point de dispositifs et de systèmes d'implantation avant-gardistes. «Mes recherches et mes collaborations avec l'industrie favorisent le développement d'innovations qui rendent les traitements plus efficaces, moins inconfortables et plus sécuritaires. Ce qui est essentiel pour moi est qu'elles conduisent à des avancées dans l'amélioration des soins qui peuvent être intégrées rapidement dans la pratique afin que les patients puissent en profiter.»
Jacques Larivière, fondateur de la Fondation Famille-Jacques-Larivière, s'est dit heureux que sa fondation «puisse contribuer de façon significative à l'avancement des connaissances et des méthodes procédurales dans le domaine des cardiopathies structurelles afin d'améliorer la qualité de vie des patients.» Le vice-recteur à la recherche et à la création, Angelo Tremblay, a souligné, pour sa part, que la création de cette chaire «renforcera le pôle d'excellence dans le domaine du traitement par cathéter des maladies structurelles cardiaques et qu'elle générera des retombées pour la population à risque.»

Le lancement de la Chaire de recherche sur le développement de traitements interventionnels des cardiopathies structurelles – Fondation Famille-Jacques-Larivière a eu lieu le 9 mai en présence de Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de médecine, d'Angelo Tremblay, vice-recteur à la recherche et à la création, de Josep Rodés-Cabau, titulaire de la Chaire, de Michèle Clavet, directrice administrative de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, du donateur, Jacques Larivière, et du président-directeur général de La Fondation de l'Université Laval, Yves Bourget.
Photo: Jacques-Beardsell


























