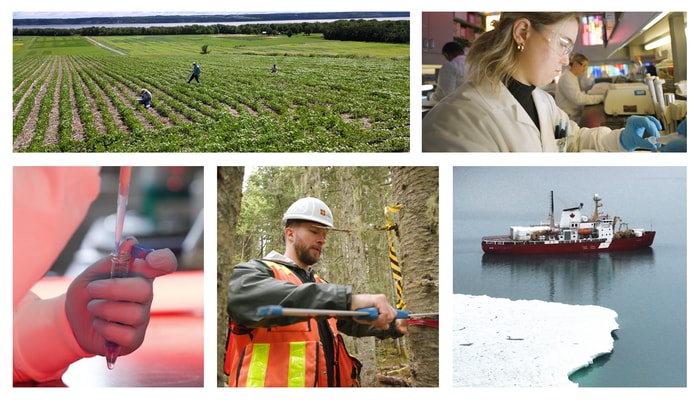Au moment de l'homologation du vaccin contre le virus du papillome humain en 2006, trois doses étaient prescrites par Santé Canada. Depuis, le Comité sur l'immunisation du Québec a recommandé à trois reprises des usages non conformes de ce vaccin. Aujourd'hui, les élèves du primaire n'en reçoivent qu'une seule dose, ce qui permet des économies substantielles, sans que l'efficacité du programme en soit diminuée.
— Getty Images/Suzi Media Production
Au cours des trois dernières décennies, il est arrivé à 11 reprises que le Québec autorise l'utilisation de vaccins dans un cadre autre que celui recommandé par Santé Canada. Ces usages non conformes ont permis une protection accrue de la population et une meilleure utilisation des fonds alloués aux programmes de vaccination, constatent deux spécialistes en santé publique, Philippe De Wals et Caroline Quach, dans un article publié par la revue Expert Review of Vaccines.
Ces deux scientifiques étaient aux premières loges lorsque les recommandations relatives à l'usage non conforme de ces vaccins ont été formulées par le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ). Créé en 1993, ce comité conseille le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec sur les actions à poser pour maintenir la qualité du programme québécois d'immunisation.
Philippe De Wals, professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université Laval, est membre du CIQ depuis sa création. Caroline Quach, de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, a été membre de ce comité de 2004 à 2025, avec une interruption entre 2017 et 2021, alors qu'elle siégeait au Comité consultatif national de l'immunisation, le pendant canadien du CIQ.
Au Canada, les programmes de vaccination sont sous la responsabilité des provinces et des territoires, mais l'homologation des vaccins relève de Santé Canada, rappelle Philippe De Wals. L'agence fédérale examine chaque demande d'homologation à la lumière des informations fournies par le fabricant du produit. C'est donc principalement le fabricant qui définit, entre autres, le nombre de doses, les intervalles entre les doses et la population cible de son vaccin.
«L'usage non conforme d'un vaccin fait référence à son utilisation dans un cadre qui s'écarte des autorisations de mise en marché décrites dans la monographie du produit, explique le professeur De Wals. Les usages non conformes sont envisagés lorsque des données probantes ou des principes de vaccinologie indiquent que les avantages d'une nouvelle utilisation sont supérieurs aux risques.»
Dans leur article scientifique, les professeurs De Wals et Quach passent en revue les 11 cas d'usage non conforme autorisés au Québec depuis 1992. Dans 10 des 11 cas, l'issue a été positive, permettant une meilleure protection de la population (3 cas) et/ou une utilisation plus judicieuse des fonds publics alloués à la vaccination (8 cas).
Le cas des vaccins contre la COVID-19
Deux de ces usages non conformes, qui concernent les vaccins contre la COVID-19, ont permis de réduire le nombre d'hospitalisations et de sauver des vies, estiment les deux scientifiques. En décembre 2020, Santé Canada avait autorisé deux vaccins à ARN messager. Leur homologation précisait que la dose de rappel devait être administrée trois et quatre semaines respectivement après la première vaccination. De plus, chaque personne devait recevoir deux vaccins du même fabricant.
«Considérant le nombre limité de vaccins disponibles, le CIQ avait recommandé un intervalle plus grand entre les deux doses de façon à pouvoir vacciner plus de gens, rappelle le professeur De Wals. Nous avons jugé qu'il valait mieux protéger plus de personnes avec une efficacité vaccinale de l'ordre de 70% que de protéger un plus petit nombre de personnes avec une efficacité vaccinale de l'ordre de 90%. Nous avons aussi recommandé de vacciner les gens en fonction de la disponibilité des vaccins plutôt que d'attendre qu'une deuxième dose du même fabricant soit disponible.»
Ces deux recommandations ont été mises en pratique par le MSSS. Leurs retombées n'ont pas été chiffrées au Québec. Par contre, en Angleterre, où ces mêmes mesures ont été appliquées quelques semaines après leur entrée en vigueur au Québec, elles ont permis d'éviter 58 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès.
Le cas des vaccins contre le virus du papillome humain
Un premier vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), servant à prévenir les cancers du col de l'utérus et différentes affections génitales, a été homologué au Canada en 2006. À ce moment, trois doses de ce vaccin devaient être administrées aux jeunes filles.
Entre 2007 et 2024, le CIQ a recommandé trois usages non conformes qui visaient à modifier le calendrier de vaccination et le nombre de doses requises. Ainsi, dès le début du programme de vaccination au Québec, en 2008, deux doses ont été administrées aux élèves de la 4e année du primaire. Depuis l'année scolaire 2019-2020, une seule dose est administrée. «Le programme de vaccination contre le VPH est aussi efficace qu'au départ et son coût est le tiers de ce qu'il aurait été sans ces changements», résume le professeur De Wals.
Résister aux pressions
Le seul cas d'usage non conforme d'un vaccin qui n'a pas produit de résultat positif est survenu en 1992, avant la création du CIQ. Le Québec était alors aux prises avec une épidémie de méningite à méningocoque qui frappait particulièrement les enfants de 6 mois à 23 mois et les adolescents. Un comité scientifique ad hoc, dont faisait partie le professeur De Wals, avait été mis sur pied pour répondre à la crise.
«Le vaccin avait été homologué pour les enfants de 24 mois et plus. En raison des pressions des médias et des autorités de santé publique, le comité ad hoc avait recommandé la vaccination de tous les enfants de 6 mois à 20 ans. Le suivi a indiqué que la vaccination des enfants de moins de 2 ans n'avait pas produit de bénéfices. Ce cas est un rappel de l'importance de savoir résister aux pressions, d'être rigoureux et de baser nos décisions sur les preuves scientifiques disponibles et sur les principes de la vaccinologie», conclut-il.
L'article paru dans Expert Review of Vaccines est signé par Philippe De Wals et Caroline Quach. Le professeur De Wals est rattaché au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval et au Centre de recherche de l'Institut universitaire en cardiologie et en pneumologie de Québec-Université Laval.