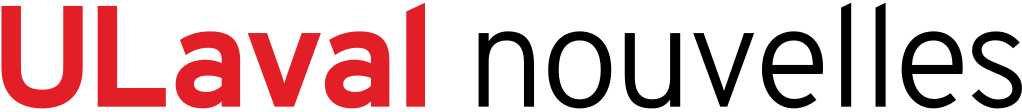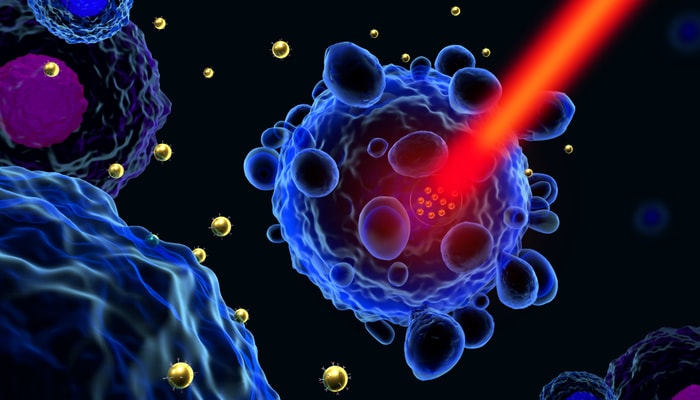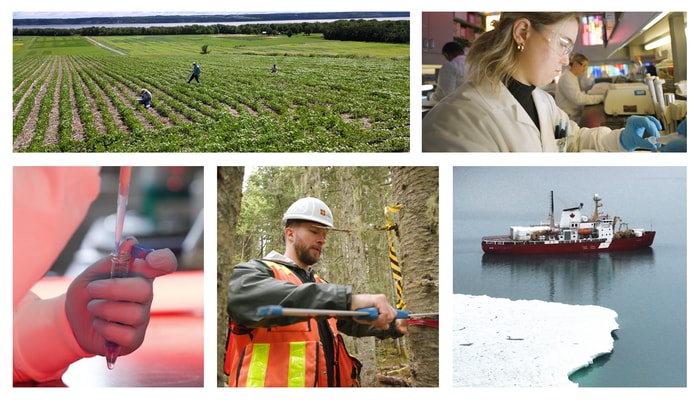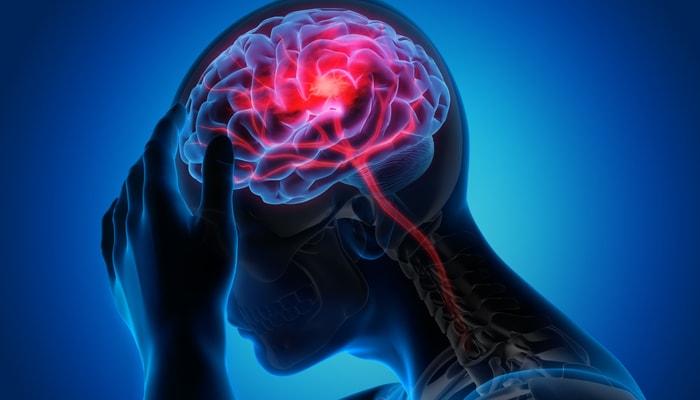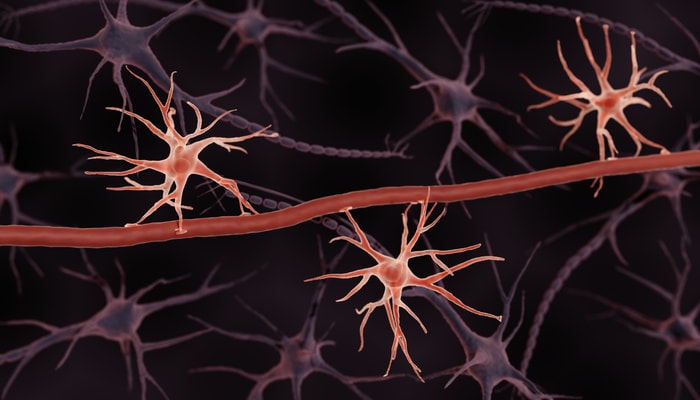— Getty Images/Fat Camera
L'an dernier, environ 7% des décès enregistrés au Québec sont survenus à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir, un pourcentage qui nous place au premier rang à ce chapitre dans le monde. Comment expliquer notre ferveur à l'égard de l'aide médicale à mourir? Parce qu'elle coche plusieurs cases de la liste des éléments qui constituent ce qui est maintenant considéré comme une belle mort au Québec, suggère une étude qui vient de paraître dans la revue Mortality.
L'équipe de recherche de l'Université Laval qui a réalisé cette étude a mené des entrevues auprès de 16 personnes – des personnes hospitalisées en gériatrie et leurs proches, des gériatres et d'autres membres du personnel soignant – afin de dégager les éléments qu'il faut réunir pour avoir une «belle mort».
«Aujourd'hui, la plupart des personnes meurent à l'hôpital après avoir épuisé tous les recours médicaux qui permettent de prolonger la vie, souligne le responsable de l'étude, Félix Pageau, gériatre, chercheur en éthique et professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval. C'est très différent de ce qui existait il y a un siècle à peine. Par la force des choses, ce qui est considéré comme une “belle mort” a beaucoup évolué au fil du temps. L'adoption de la loi qui légalisait l'aide médicale à mourir, en 2015, a également fait évoluer les attentes par rapport à la fin de vie.»
Les réponses des personnes qui ont participé à l'étude ont permis de dégager quelques éléments qui font consensus. Les personnes souhaitent une mort exempte de souffrances physiques et psychologiques, exempte de douleurs ou d'inconfort et exempte de détresse physique ou psychologique. «Ces éléments se recoupent, mais il y a une gradation dans leur intensité», précise le professeur Pageau, qui a lui-même réalisé les entrevues dans le cadre d'une maîtrise en philosophie.
Par ailleurs, les personnes qui ont pris part à l'étude jugent qu'il est essentiel de pouvoir compter sur le soutien de l'équipe soignante, de la famille et des proches. «Elles ne veulent pas mourir seules. Elles réalisent que ce qui importe réellement à la fin d'une vie ce n'est pas les richesses accumulées, mais les relations qu'elles ont nouées avec d'autres personnes», souligne Félix Pageau.
Enfin, l'autre élément qui fait consensus est le désir de terminer ses jours dans un environnement physique apaisant. Fait révélateur, certains membres du personnel soignant ont souligné que leur milieu de travail était un endroit horrible pour mourir. «Les unités de soins aigus ont été conçues pour assurer l'efficacité du travail des équipes soignantes, rappelle le professeur Pageau. Peu d'attention a été accordée à l'esthétique et au design. Ici encore, en fin de vie, les gens reviennent à l'essentiel et ils veulent être entourés de beau.»
Deux autres éléments ont été fréquemment évoqués par les personnes qui ont pris part à l'étude, mais les préférences exprimées allaient dans des directions opposées. Certaines personnes souhaitent demeurer conscientes jusqu'à la fin afin de pouvoir échanger avec leurs proches alors que d'autres préféreraient mourir dans leur sommeil ou sans en avoir conscience. Même divergence de vues pour ce qui est de la rapidité de la mort. Certaines souhaitent une mort qui survient abruptement, alors que d'autres préfèrent avoir le temps de se préparer et de dire au revoir à leurs proches.
— Félix Pageau, au sujet de l'importance accordée au fait d'être entouré de ses proches en fin de vie
«L'aide médicale à mourir réunit plusieurs des éléments qui font une “belle mort”, constate le professeur Pageau. C'est sans doute ce qui explique le fort appui populaire à sa légalisation. Culturellement, la population québécoise était rendue là.»
Il existe d'autres moyens d'aider plus de personnes à avoir une «belle mort», poursuit-il. «Si notre système de santé pouvait consentir davantage de ressources aux soins palliatifs et aux soins à domicile, on se rapprocherait de l'idéal de fin de vie d'une bonne partie de la population.»
Outre le professeur Pageau, les signataires de l'étude publiée dans Mortality sont Ariane Plaisance, qui était doctorante en santé communautaire à l'Université Laval au moment de l'étude, et Vincent Marchildon, qui était résident en médecine interne à l'Université Laval au moment de l'étude.