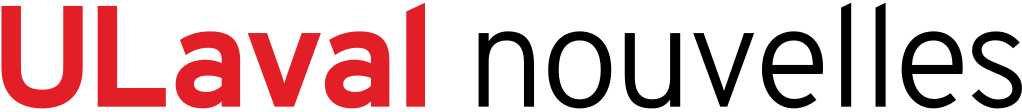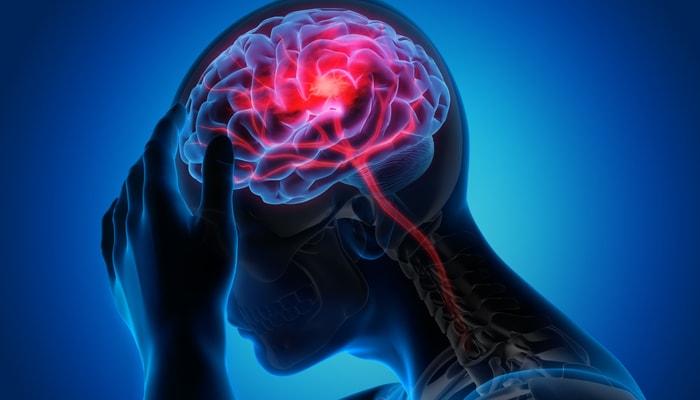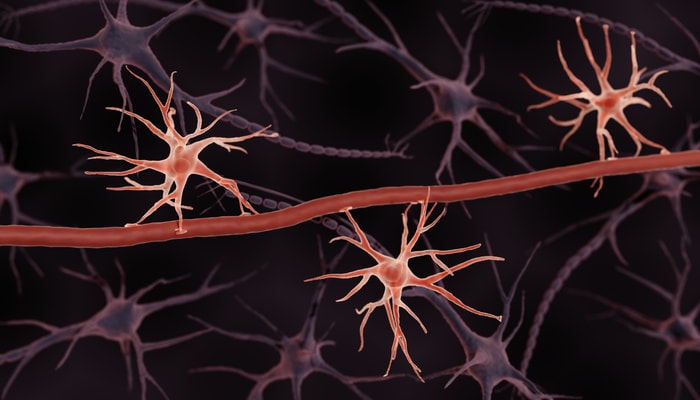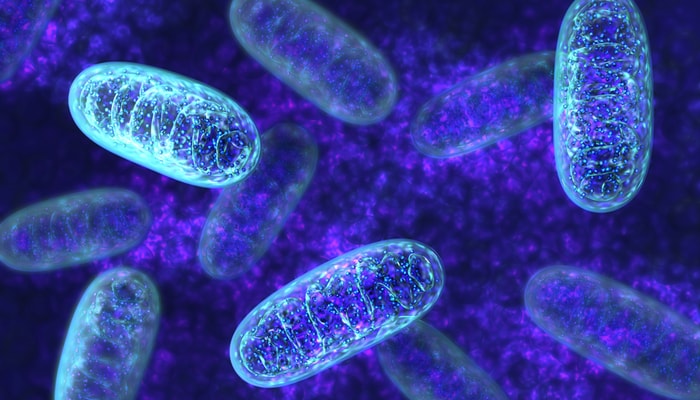De gauche à droite: Omar Bongo, président du Gabon de 1967 à 2009; Hugo Chávez, président du Venezuela de 1999 à 2013; Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie depuis 2014; Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie depuis 2012.
— Bongo: Bob Mieremet, Chávez: Bureau du président du Brésil, Erdoğan: Site officiel du président de l’Ukraine, Poutine: Service de presse du président de la Fédération de Russie
La scène est surréaliste. Le 21 février 2022, à trois jours du début de l’invasion de l’Ukraine, le peuple russe, par le truchement de la télévision, assiste médusé à une réunion du Conseil de sécurité de Russie. Dans une grande salle du Kremlin, autour d’une grande table, le président Vladimir Poutine anime la rencontre en questionnant ministres, hauts fonctionnaires, conseillers et responsables du renseignement au sujet des options politiques qui s’offrent à lui à l’égard de l’Ukraine. Résultat: ces hommes sont incapables de fournir de réponses correctes au président. Ils trébuchent dans leurs explications. Poutine, lui, se moque ouvertement d’eux.
«Ces gens qui entourent le président, on pensait qu’ils avaient énormément d’influence, de prise sur lui, explique le professeur Francesco Cavatorta, du Département de science politique de l’Université Laval. Or, cet exemple prouve qu’il n’en est rien. Poutine les traite comme des écoliers ignorants. Il leur fait deviner les réponses qu’ils devraient donner aux questions qu’il pose. Il voulait montrer qu’il est le seul homme aux commandes. Il les domine parce qu’ils sont assis sur de petites chaises, loin de lui, tout petits comme des élèves qu’on va interroger et potentiellement punir parce qu’ils ne connaissent pas les réponses.»
Selon lui, cette situation montre bien à quel point le régime politique russe s’est personnalisé. «Poutine est au centre de ce régime et ses proches collaborateurs le craignent, poursuit-il. Cela fait un peu peur que le système politique d’un pays de près de 150 millions d’habitants, qui dispose de près de 6000 ogives nucléaires, fonctionne de cette manière.»
Des chefs d’État puissants
Au début du printemps 2024, les Presses de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, publieront un ouvrage collectif de 342 pages sur les régimes politiques dits personnalistes. Ce néologisme désigne les systèmes politiques contemporains, souvent des démocraties jeunes et fragiles, d’autres plus stables, qui ont évolué vers une forme de gouvernement dans laquelle le chef de l’État a accumulé un tel pouvoir entre ses mains qu’il peut agir sans la contrainte de la constitution, des lois ou des partis d’opposition. Ce pouvoir quasi absolu fait de ces leaders des dictateurs modernes.
«Ces démocraties fragiles qui ont reculé, on en voit plusieurs exemples dans l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, souligne le professeur Cavatorta, par exemple en Asie centrale. À part un bref mouvement vers un changement politique pluraliste, ces pays sont redevenus des dictatures assez fortes et très personnalisées. La Russie aussi. Après une dizaine d’années de démocratisation, elle a conclu son expérience démocratique pour aller vers quelque chose d’autre.»
Avec deux autres chercheurs, le professeur a coédité l’ouvrage en question intitulé Personalism and Personalist Regimes. Avec eux, il a aussi signé l’introduction et la conclusion du livre. «Le dictateur a la capacité de dicter leur comportement aux institutions politiques et aux autres acteurs politiques d’un pays, indique-t-il. Dans notre ouvrage, nous disons que les institutions politiques, comme les systèmes présidentiels ou les systèmes électoraux, sont bien sûr importants. Mais, à la fin, on veut aussi voir quel est le rôle du chef de l’État lui-même avec sa psychologie, ses capacités, son réseau dans le monde.»
Selon lui, le modèle démocratique a perdu de son attrait depuis la fin de la Guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. «Les démocraties occidentales sont en crise depuis un moment, soutient-il. La majorité de ces pays vivent de grosses inégalités socioéconomiques, leurs économies ne performent plus aussi bien qu’à une certaine époque. Leur politique étrangère est de plus en plus hypocrite et antilibérale. Cette idée que la démocratie allait apporter les droits, l’égalité, la croissance économique, ce n’est plus vraie. Dans ces pays, les citoyens croient de moins en moins aux bienfaits des délibérations, de la confrontation démocratique et aux discussions dans le respect sur des visions opposées.»
Pas de Staline, de Mao ou de Castro
Selon Francesco Cavatorta, les dynamiques de gouvernance très personnalisées commencent à se voir aussi dans les démocraties occidentales. Un exemple est le système présidentiel américain où l’individu a toujours compté. «Pensons aux débats Nixon-Kennedy de la campagne présidentielle de 1960, dit-il. Ce fut très personnalisé. Ça éloigne un peu de ce que devrait être l’esprit démocratique où ce sont les idées du groupe qui comptent. Le jeu démocratique n’est pas une bataille entre deux personnalités, mais entre des projets, des visions de société différentes. L’individu, le leader d’un parti politique, était reconnu comme premier parmi les pairs. Il n’était pas une personnalité qui avait une valeur politique au-delà de son idéologie, au-delà de son parti. Les choses ont changé. On accorde aujourd’hui énormément d’importance au leadership.»
Les dictateurs d’aujourd’hui ne sont pas très idéologiques. «Il n’y a pas de Staline, de Mao ou de Castro parmi eux, poursuit-il. L’autocrate contemporain emprunte un peu d’éléments à droite de l’échiquier politique. Son idéologie est changeante. Ce qui l’intéresse, c’est le pouvoir. Son but n’est pas tellement de façonner une société différente.»
Le professeur déplore le retour à la notion d’«homme fort» en ce début de 21e siècle. «Si elle a jamais disparu, explique-t-il, cette idée veut qu’un homme seul avec de fortes capacités, dont celle de bien interpréter ce que le peuple attend, est capable de gouverner tout seul. Cela n’a jamais été le cas et ne doit jamais l’être. Mais dans des moments difficiles, c’est quand même quelque chose qu’une bonne partie des citoyens, parfois la majorité, soit attirée vers de telles personnalités, que l’on se trouve dans une démocratie ou pas.»
Les dynasties Bongo et Gnassingbé
Au fil des pages, différents spécialistes se penchent sur une quinzaine de chefs d’État contemporains dont le style de gouvernance correspond à celui d’un régime personnaliste. Parmi les plus anciens, mentionnons le colonel Kadhafi en Libye, Anastasio Somoza Debayle au Nicaragua et Ferdinand Marcos aux Philippines. Certains hommes de pouvoir, forts et autoritaires, comme le Russe Vladimir Poutine ou le Turc Recep Tayyip Erdoğan, sont toujours en fonction. D’autres, comme le Vénézuélien Hugo Chavez ou le Gabonais Omar Bongo, sont décédés.
Le cas d’Omar Bongo est particulier, car il implique une succession familiale au pouvoir. Dans un chapitre du livre, la professeure Marie Brossier, du Département de science politique de l’Université Laval, se penche sur deux longues dictatures familiales dans deux pays d’Afrique subsaharienne, le Gabon et le Togo. Dans un cas, Omar Bongo et son fils Ali ont dirigé leur pays successivement de 1967 à 2023. Dans l’autre cas, Gnassingbé Eyadéma et son fils Faure Gnassingbé ont été au pouvoir l’un après l’autre de 1967 à 2005.
«Le fait que des fils se révèlent aussi autoritaires que leurs pères, mais qui utilisent des stratégies parfois différentes, cela ne se passe pas aussi souvent qu’on pense, souligne le professeur Cavatorta. Bongo a été capable de faire en sorte que son fils puisse bénéficier des institutions qu’il a façonnées pour s’installer au pouvoir, en dépit de la constitution qui prévoyait quelque chose d’autre.»
Selon lui, le cas Bongo montre que les dynamiques de succession ne sont pas toujours aussi simples qu’on peut le penser. «Mais, ajoute-t-il, il faut admettre que, dans certains cas, elles ont eu du succès. Les fils Bongo et Gnassingbé ont réussi à succéder à leur père et ils n’ont pas été les seuls. Pensons à Bachar al-Assad qui dirige aujourd’hui la Syrie après avoir succédé à son père en 2000, lequel était au pouvoir depuis 1970. Ou à la dynastie Kim qui dirige la Corée du Nord depuis 1948.»
«C’est moi que le peuple veut»
L’ouvrage Personalism and Personalist Regimes montre que Vladimir Poutine a vraiment réussi à personnaliser les institutions russes depuis qu’il est au pouvoir. «Il est “le” décideur, affirme le professeur. Il a été capable de construire sur le long terme un système où personne ne peut avoir du succès sans lui, ni dans la vie politique, ni dans la vie économique. On pouvait dire: Poutine, ce sont les oligarques russes qui l’ont mis là. Aujourd’hui, c’est lui qui domine l’oligarchie. Depuis 1999, il a été capable de construire un régime très personnalisé qu’il domine.»
En Turquie, Recep Tayyip Erdoğan a d’abord été premier ministre de 2003 à 2014. Il est président de la république depuis cette date.
«Erdoğan arrive au pouvoir comme premier ministre avec comme objectif de renforcer la démocratie turque, rappelle Francesco Cavatorta, ce qu’il réussit pendant ses premiers mandats. Mais plus il gagne d’élections, plus il se dit: “C’est moi que le peuple veut.” Et à un moment donné ils se met à transformer le système politique, qui devient effectivement autoritaire.»
Selon le professeur, cette transformation s’est faite en utilisant les ressources de l’État qu’il contrôle comme premier ministre pour faire des lois qui vont l’avantager, pour donner des bénéfices économiques à ceux qui sont proches de lui, donc qui lui doivent des choses. Jusqu’à ce qu’il parvienne à transformer le système parlementaire turc en un système présidentialiste.
«Erdoğan n’a pas fermé le jeu démocratique, poursuit-il. Il l’a rendu très difficile à jouer pour les opposants. Son parcours montre qu’un leader qui est capable de personnaliser la politique de cette manière est aussi potentiellement capable de démanteler petit à petit les structures et les institutions politiques existantes. Ensuite, il est capable de façonner de nouvelles institutions qui lui garantissent de pouvoir rester au pouvoir et de devenir un acteur de plus en plus autoritaire.»
Le Vénézuélien Hugo Chávez, lui, suit d’une certaine manière les traces d’Erdoğan. Ses mandats présidentiels couvrent la période comprise entre 1999 et 2013, date de sa mort. Il prend le pouvoir de manière légitime en disant vouloir changer le système politique de son pays afin de réduire les inégalités socioéconomiques. Dès 1999, il fait adopter une nouvelle constitution par le Parlement.
«Au pouvoir depuis plusieurs années, Chávez commence à identifier le Venezuela et le bien-être de l’État à sa propre personne, explique le professeur Cavatorta. Il s’appuie de plus en plus sur d’anciens copains de l’armée. Il commence à marginaliser de plus en plus les médias d’information qui lui sont opposés. Il utilise de plus en plus les médias d’État pour projeter son image comme celle du seul véritable homme politique du Venezuela. Mais il va décéder avant que le système politique soit vraiment autoritaire. Son successeur Nicolás Maduro va vraiment fermer le système.»