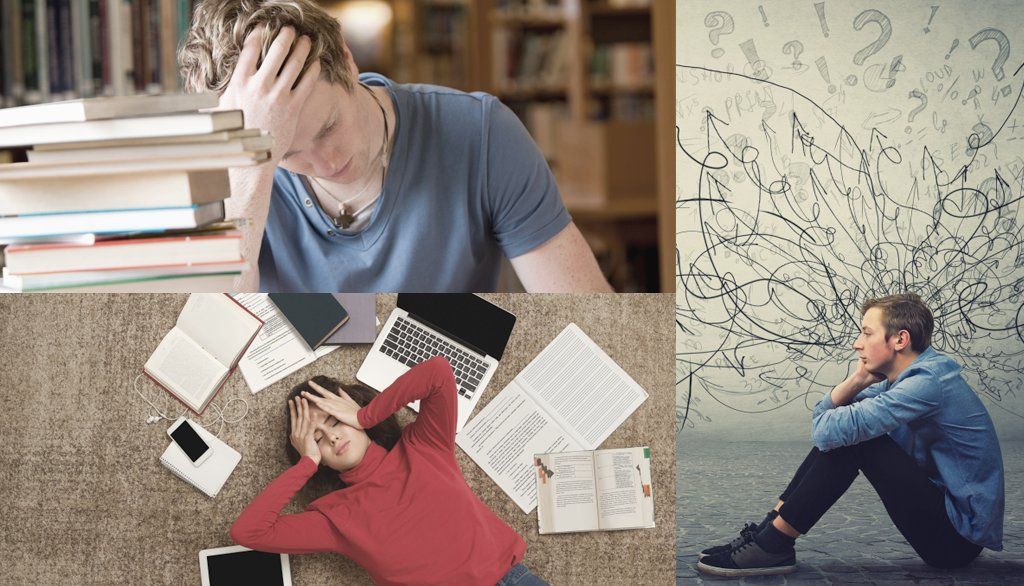
L’article des professeurs Cynthia Courtois, Maude Paré-Plante et Pier-Luc Lajoie a valu à ses auteurs le prix Outstanding Paper aux 2021 Emerald Literati Awards. Vingt-cinq étudiantes et étudiants au doctorat, inscrits dans des écoles de gestion au Canada, aux Pays-Bas, en Écosse et en Australie, ont été interviewés sur la façon dont ils construisent leur attitude face à la performance et quel en est l’impact sur leur réflexivité.
— Getty Images
Cynthia Courtois et Maude Paré-Plante sont deux jeunes professeures de l’École de comptabilité de l’Université Laval. Avec leur confrère Pier-Luc Lajoie, professeur au Département des sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières et doctorant à l’École de comptabilité de l’Université Laval, elles ont publié, en 2020, un article dans la revue spécialisée Qualitative Research in Accounting & Management. Intitulé Performance in neo-liberal doctorates: the making of academics, cet article a récemment valu à ses auteurs le prix Outstanding Paper aux 2021 Emerald Literati Awards. Emerald Group Publishing Limited est un éditeur britannique de revues savantes et de livres universitaires.
D’entrée de jeu, les auteurs expliquent que celles et ceux qui entreprennent des études doctorales se trouvent souvent propulsés au centre d’un univers dont ils doivent rapidement assimiler les règles et les attentes à leur endroit. Cela est d’autant plus important que le doctorat qu’ils visent constitue la clé d’entrée dans le système universitaire pour obtenir un poste de professeur et de chercheur. Leur performance comme doctorants doit donc être reconnue. Cet aspect est capital. Celles et ceux qui ne réussissent pas à s’affirmer comme tel voient leurs chances réduites de beaucoup de percer un jour dans le monde universitaire.
«Notre recherche, souligne Cynthia Courtois, s’intéresse aux doctorantes et doctorants, des sujets peu étudiés à ce jour comparés aux professeurs universitaires. Ce sont les chercheurs de demain. Ces étudiants offrent une perspective différente de celle du professeur aguerri. Nous avons voulu mieux comprendre comment ils construisent leur attitude face à la performance et quel en est l’impact sur leur réflexivité. Une personne réflexive est quelqu’un de critique qui tente de voir les choses sous différentes perspectives et qui tente de comprendre pourquoi il en est ainsi.»
Santé psychologique
Dans le cadre de leur recherche, les auteurs ont interviewé 25 étudiantes et étudiants au doctorat inscrits dans des écoles de gestion au Canada, aux Pays-Bas, en Écosse et en Australie. L’échantillon comprenait 70% de femmes et 70% de personnes en comptabilité. Dix entrevues ont duré plus de 100 minutes chacune.
«Ces dernières années, indique la professeure Courtois, plusieurs études ont révélé des problèmes de santé psychologique chez les doctorants. Pensons au stress, à la dépression, à l’anxiété, à la perte de confiance en soi. Une thèse est un exercice laborieux, envahissant, qui occupe tout l’espace. Certaines personnes interviewées pleuraient. Leur thèse, elles voyaient ça tout rose avant de se lancer, mais ça peut parfois devenir un cauchemar. Un superviseur peut mettre énormément de pression sur son doctorant.»
L’étude est axée sur les trajectoires des doctorantes et doctorants. Les entrevues ont servi à approfondir les différents parcours. Le texte est ponctué d’extraits. «Les participants, dit-elle, sont ressortis de l’expérience en prenant conscience de quelque chose de rassurant: ils ne sont pas seuls dans cette situation.»
Cynthia Courtois et Maude Paré-Plante se disent entourées de doctorantes et de doctorants qui vivent ce processus. Pour ces étudiants, l’article peut apporter du réconfort en plus d’aider à accepter, à s’activer et à progresser dans ce processus qui consiste, pour la plupart, à trouver sa place dans le milieu universitaire.
La performance à l’ère néolibérale
Pour une doctorante ou un doctorant, la performance est généralement mesurée par l’obtention de bons résultats ou par la capacité à accomplir son programme le plus rapidement possible. La performance se mesure aussi par la capacité à publier rapidement les résultats de ses projets de recherche.
«Les exigences en matière de performance peuvent conduire à différents comportements dysfonctionnels, soutient la professeure Courtois. Par exemple, on peut penser à un doctorant qui vise des projets peu innovants parce qu’il veut publier rapidement. Ainsi, il pourrait préférer faire des entrevues plutôt qu’une recherche-action ou une ethnographie qui exigerait plus de temps. Certains vont tenter de morceler leurs données à l’excès pour multiplier le nombre de publications à partir de la même collecte de données. Enfin, on pourrait aussi penser que certains vont éviter de choisir des sujets trop spécialisés afin d’être publiés dans des revues mainstream généralement plus citées.»
Selon Maude Paré-Plante, la performance est partout dans le monde universitaire. «Mais, ajoute-t-elle, l’internationalisation de la recherche dans les écoles de gestion fait en sorte que nous nous battons tous pour publier dans les mêmes revues, ce qui crée une compétition énorme entre nous. Or, nous sommes évalués sur nos publications.»
Les auteurs de l’étude rappellent que le contexte néolibéral a amplifié la mesure de la performance, ce qui a rendu possible la comparaison entre les établissements d’enseignement, les revues, les universités, les chercheurs et même les doctorants. «Il faut désormais mesurer la performance par le nombre de citations, le nombre de publications, etc., indique-t-elle. Maintenant, écrire un livre a peu de valeur dans les écoles de gestion parce qu’il s’agit d’un acte peu payant pour celui qui souhaite grimper dans les échelons universitaires. C’est ce genre de changement qui a modifié la manière avec laquelle nous faisons maintenant de la recherche. On passe ainsi parfois moins de temps à développer des idées et plus de temps à chercher à les rentabiliser.»
Selon Cynthia Courtois, ce phénomène affecte aussi les doctorants qui peuvent, par exemple, suivre les recommandations de leur superviseur pour ce qui est de la vitesse de croisière à suivre dans le programme, mais ne pas faire certains travaux ou certaines lectures qui ont moins de valeur. D’autres vont mettre beaucoup d’énergie sur la participation à des conférences afin de se faire reconnaître rapidement par le milieu. «Ce sont des façons de laisser transparaître une performance, explique-t-elle, et lorsqu’ils sont conscients de jouer le jeu, cela ne nuit pas nécessairement à leur réflexivité. Bref, plusieurs vont opter pour une approche pragmatique, c’est-à-dire faire ce qui est payant, et ce, même si cela peut contribuer à entretenir chez eux une certaine forme de cynisme face au processus doctoral qu’ils voyaient initialement comme un voyage plus intellectuel que commercial.»
Selon elle, la recherche souffre lorsque les gens adhèrent aux indicateurs de performance sans se poser de questions, à savoir s’ils aident à rendre la recherche plus vivante et innovante. «Les doctorants, soutient-elle, doivent rester dans le moule et respecter, dans une certaine mesure, les indicateurs de performance qui leur sont imposés s’ils souhaitent être admis dans le monde universitaire, mais ils doivent aussi être conscients des dangers de suivre aveuglément les indicateurs de performance – surtout pour ce qui est des conséquences sur leur réflexivité.»
L’étude a démontré l’assez grande plasticité de la notion de performance. «Plusieurs de nos participants sont parvenus à trouver un espace à l’intérieur du moule pour pouvoir manœuvrer parce qu’ils sont des conscious performers, précise la professeure Courtois. Certains vont être un peu plus en opposition, d’autres vont se conformer davantage. Mais au final, ils nous sont apparus comme étant généralement très réflexifs, malgré les pressions qui s’exercent sur eux.»


























