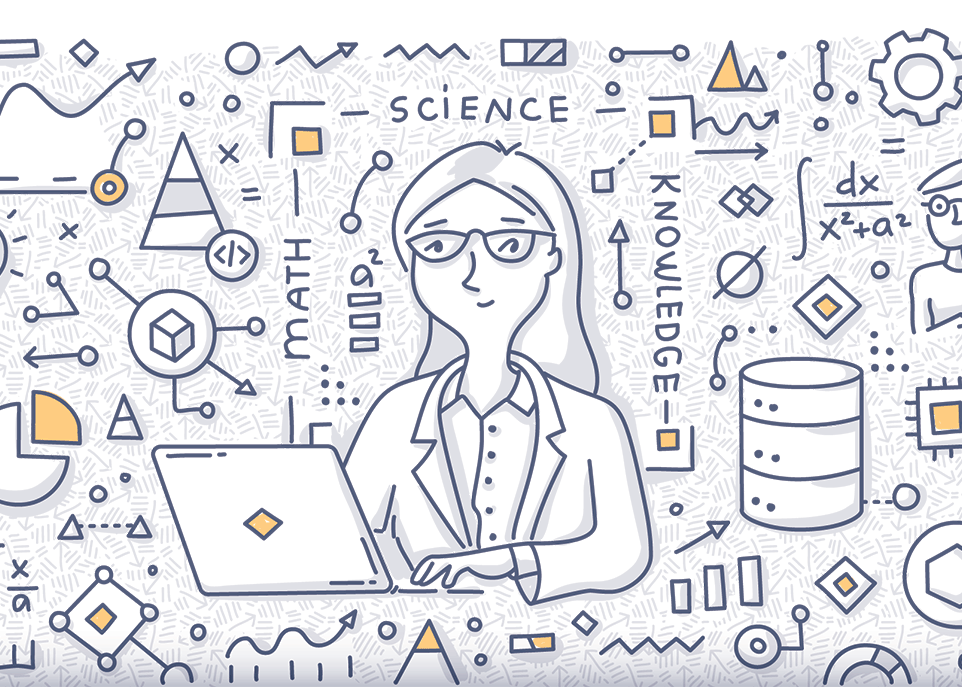
Les biais entre hommes et femmes dans l'attribution des fonds de recherche ont des répercussions individuelles et collectives et ils nuisent à l'optimisation des investissements publics en recherche, estime Holly Witteman.
Depuis, ce projet d'article a fait beaucoup de chemin. Un an jour pour jour après la diffusion d'un reportage du Fil sur cette étude et trois jours avant la Journée internationale des femmes et des filles de science, la professeure Witteman est à Londres aujourd'hui pour participer, à l'invitation de la revue The Lancet, au lancement d'un numéro spécial sur la place des femmes en sciences, en médecine et en santé globale. Son étude figure parmi les 11 articles de recherche et de synthèse sélectionnés par les responsables de cette publication. Considérant le thème du numéro ainsi que le sujet de l'étude de la professeure Witteman, ce choix éditorial se comprend facilement.
La chercheuse et ses collaborateurs ont profité d'un changement implanté en 2014 par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour étudier la question des écarts hommes-femmes dans l'attribution des subventions, un phénomène observé par la plupart des organismes subventionnaires dans le monde. Les IRSC avaient alors remplacé leur programme ouvert de subventions de fonctionnement par deux nouveaux programmes, l'un donnant prépondérance au dossier des candidats et l'autre à la qualité des projets soumis.
Les analyses de quelque 24 000 demandes de subventions ont révélé que le taux de succès des femmes est presque quatre points de pourcentage plus bas que celui des hommes au programme évalué prioritairement sur le dossier du demandeur. Par contre, au programme qui repose davantage sur la qualité du projet, le taux de succès des femmes est comparable à celui des hommes. Le plus faible taux de succès des femmes dans la plupart des programmes de subventions dépendrait donc, en partie ou totalement, de la façon dont est évalué leur dossier de réalisations et non de la qualité scientifique de leurs demandes.
Cette conclusion suggère qu'il existe des biais dans le processus d'évaluation des demandes de subvention et que ces biais pénalisent les femmes. «Les conséquences de ces biais sont que les fonds ne sont pas toujours attribués aux meilleurs projets de recherche, que des projets de recherche intéressants ne peuvent pas être réalisés, que des chercheuses ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel et que les organismes subventionnaires n'optimisent pas les investissements publics en recherche», commente la professeure Witteman.
The Lancet présente le 8 février une activité officielle pour marquer le lancement de son numéro spécial. La professeure Witteman a été invitée à exposer les grandes lignes de son étude et à partager ses réflexions sur les obstacles auxquels doivent toujours faire face les femmes en sciences. Deux autres membres de la Faculté de médecine, la professeure Joyce Dogba et la chercheuse postdoctorale Ruth Ndjaboué, comptent au nombre des 150 personnes qui participent à l'activité. Il est possible d'en suivre le déroulement en direct le 8 février de 5h à 11h.
Le contenu complet du numéro spécial Advancing women in science, medicine and global health sera accessible en ligne dès le 8 février sur le site de la revue The Lancet. Rappelons que le facteur d'impact de cette revue en fait la deuxième plus influente publication dans le domaine de la médecine.


























