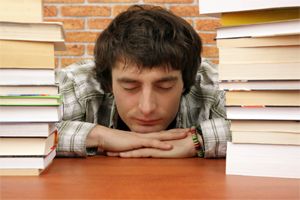
L'étudiant-chercheur Simon Beaulieu-Bonneau et le professeur Charles Morin, de l'École de psychologie, se sont intéressés à ce phénomène et ils ont profité de la Journée scientifique du Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard, qui avait lieu le 29 janvier, pour présenter des données sur sa prévalence et sur les facteurs qui prédisposent au coup de barre.
L'enquête qu'ils ont menée auprès de 1 362 Québécois révèle que la propension à la somnolence atteint un seuil clinique chez 27 % des répondants. «Dans leur cas, la somnolence interfère significativement avec l'accomplissement des tâches quotidiennes, précise Simon Beaulieu-Bonneau. C'est une prévalence plus élevée que celle rapportée dans des études menées ailleurs, même si nous avons exclu de notre échantillon les personnes souffrant d'apnée du sommeil ou du syndrome des jambes agitées» (deux troubles qui affectent la qualité du sommeil nocturne).
Les analyses des chercheurs ont mis en relief certaines caractéristiques qui favorisent la somnolence. Les plus significatives sont «être aux études ou occuper un emploi» et «dormir moins de 7 heures par nuit». L'inactivité physique, le surpoids et le fait de souffrir de douleurs chroniques entrent aussi en ligne de compte, mais leur impact est moindre. Les chercheurs n'ont noté aucun effet de l'âge ou du sexe. Par ailleurs, certaines situations, notamment regarder la télé, lire en position assise, être passager dans une voiture, pavent la voie à une visite éclair chez Morphée.
Le coup de barre frappe surtout en début d'après-midi. «C'est sûr qu'un repas copieux peut favoriser la somnolence, mais la cause première est que cette période correspond à une baisse naturelle dans le rythme circadien», souligne l'étudiant-chercheur.
De la fatigue
La fatigabilité est courante chez les personnes qui ont eu un traumatisme crânien cérébral (TCC) et elle nuit au retour à la vie normale. Lorsque le TCC est léger, la fatigabilité disparaît généralement dans l'année qui suit l'accident, mais elle persiste souvent chez les gens qui ont eu un TCC plus grave. Ceci a donné l'idée aux deux chercheurs de comparer la propension à la somnolence d'une vingtaine de personnes qui avaient eu un TCC modéré ou sévère (un à dix ans auparavant) à celle de sujets exempts de TCC. Bien que les tests n'aient révélé aucune différence significative générale entre les deux groupes, une tendance à une somnolence plus prononcée se dessine en après-midi dans le groupe TCC. «Les victimes de TCC devraient tenir compte de ce fait et structurer leur horaire de façon à éviter d'avoir à accomplir des activités exigeantes pendant cette période», suggère Simon Beaulieu-Bonneau.
Tous les gens sujets à la somnolence devraient envisager le recours à un remède éprouvé universellement contre la somnolence diurne: la sieste. Les recommandations pour une sieste réparatrice sont les mêmes qu'il y ait eu TCC ou non. «Sa durée idéale est d'une quinzaine de minutes et il faut qu'elle ait lieu avant 15 heures», recommande l'étudiant-chercheur. Si ces consignes sont respectées, elles devraient laisser frais et dispos sans affecter la qualité du sommeil nocturne.


























