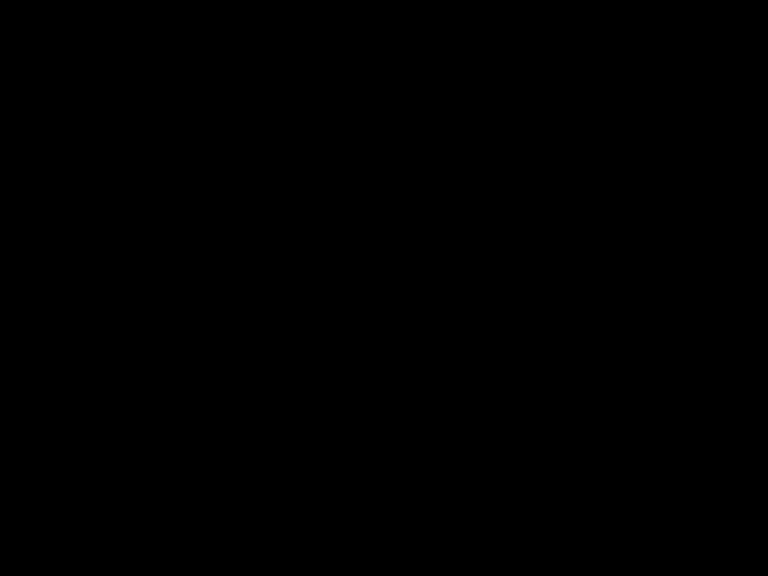
Les chercheurs ont étudié le pollen enfoui dans les sédiments de la tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy pour reconstituer l'histoire forestière de la région de Québec.
En 20 petites minutes, le professeur Lavoie a raconté l'histoire forestière de la région de Québec au cours des 11 000 dernières années, décryptée à partir des grains de pollen et de fragments végétaux enfouis dans les sédiments des lacs et des tourbières. Ses analyses s'appuient, entre autres, sur l'étude de la tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy, l'un des derniers sites où subsistent des archives naturelles qui permettent de reconstituer l'évolution du paysage végétal de Québec. «Les grains de pollen de chaque espèce retrouvés à différentes profondeurs dans les sédiments permettent d'estimer son abondance à différentes époques et de déduire quelles plantes dominaient alors le paysage», a-t-il expliqué.
Ces analyses lui ont permis de distinguer trois grandes périodes depuis la dernière glaciation. La première, marquée par la présence de plantes arctiques et d'arbustes typiques de la toundra, commence après le retrait du glacier, il y a 11 000 ans, et durera entre 500 et 1 000 ans. À la faveur du réchauffement du climat, les épinettes noires, les pins gris et les bouleaux blancs s'installent dans la région et forment des forêts très ouvertes. Cette phase de boisement, qui s’échelonne sur 1 000 ans, est suivie par la phase forestière. «On assiste alors à la fermeture des forêts, signale le chercheur. Les sapins et les pins sont dominants et les espèces qui ont besoin de températures plus chaudes, notamment le bouleau jaune et l'érable à sucre, arrivent à leur tour.»
Il y a 6 000 ans, les érablières atteignent leur limite nord et les grands traits du visage forestier de Québec se fixent. Après l'établissement de l'érablière, les choses bougent peu, exception faite des changements dans l'abondance relative des autres essences forestières. Cette longue période de relative stabilité prend brusquement fin il y a environ 300 ans alors que survient «une chute marquée de l’abondance du pollen d’arbres et une augmentation notable du pollen des espèces associées aux activités humaines, observe Martin Lavoie. L'érablière à tilleul demeure toujours le domaine bioclimatique de la grande région de Québec, mais il est clair qu’elle a été grandement fragmentée en raison de l'agriculture et du défrichement.»


























