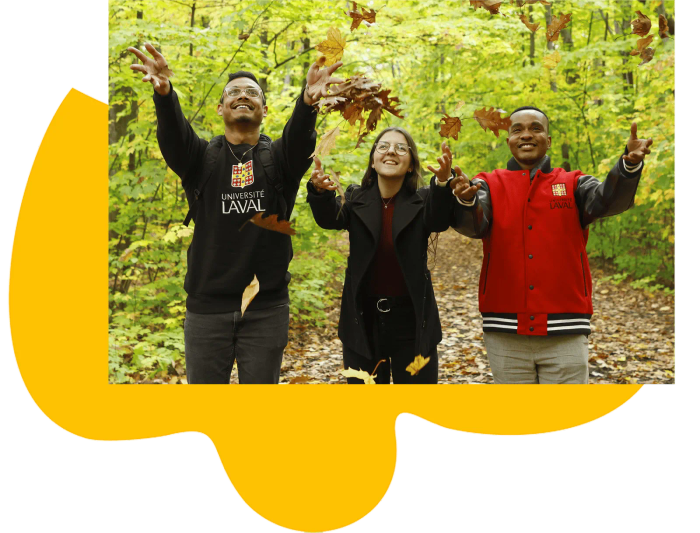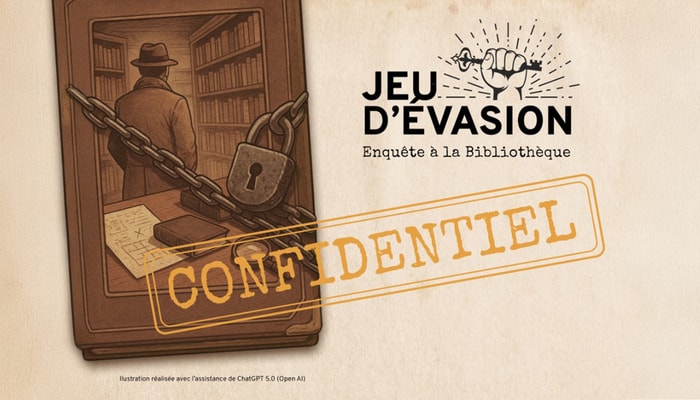Sur le quai du lac Saint-Augustin, les professeurs Reinhard Pienitz et Dermot Antoniades procèdent à l’extraction d’une carotte de sédiments.
— Yves Brousseau
Au Département de géographie, la pandémie a forcé le corps professoral à être particulièrement innovant. Une des nouvelles pistes d’enseignement mises de l’avant cet été est le tournage de capsules vidéo pédagogiques pour le cours Terrain et laboratoire en géographie.
«Nous offrons ce cours obligatoire chaque année à nos étudiants du premier cycle, explique le professeur Yves Brousseau, coordonnateur du cours Terrain et laboratoire en géographie. Dans le contexte de la COVID-19, nous avons choisi de le maintenir et de le présenter sous forme comodale. Une dizaine de professeurs collaborent à ce cours. Les capsules pédagogiques constituaient une première. Nous en avons tourné au lac Saint-Augustin, près de Québec, mais aussi dans le parc des Grands-Jardins, dans la région de Charlevoix et sur les plaines d’Abraham, à Québec. Avant la pandémie, nous amenions nos étudiants sur le terrain pour des présentations sur place.»
Le 29 juin, six membres du Département de géographie se sont déplacés au lac Saint-Augustin. Ils ont passé la journée à tourner du matériel pour six capsules sur autant d’aspects liés à la santé écologique du lac. Pour rappel, ce plan d’eau est situé en milieu urbain. Il a un périmètre de 4,5 kilomètres et une longueur maximale de 2,1 kilomètres.
L’équipe départementale comprenait, outre le professeur Brousseau, les professeurs Dermot Antoniades et Reinhard Pienitz, les techniciennes en travaux d’enseignement et de recherche Louise Marcoux et Sylvie St-Jacques ainsi que l’étudiante Sabrina Allard. Quelques bénévoles du comité de bassin versant du lac Saint-Augustin les accompagnaient. Les deux techniciennes ont réalisé les tournages. Ces vidéos ont par la suite été regroupées ou scindées en plusieurs capsules pédagogiques.
Reinhard Pienitz et Dermot Antoniades ont fait une seule sortie chacun sur le lac pour le tournage de quelques séquences vidéo. Une séquence supplémentaire à laquelle ont participé les deux professeurs a été enregistrée sur le quai.
«Le tournage s’est déroulé à bord d’une chaloupe éloignée du rivage, raconte le professeur Pienitz. J’étais à une extrémité. Je parlais de tel ou tel instrument et j’en montrais l’utilisation, notamment la sonde multiparamètres qui sert à mesurer les aspects physico-chimiques de la colonne d’eau. À l’autre extrémité de la chaloupe se trouvait la technicienne Louise Marcoux qui tournait.»
Les capsules montrent, entre autres, comment échantillonner un plan d’eau, comment faire un carottage de sédiments extraits du fond du plan d’eau et comment préparer les sédiments pour une analyse en laboratoire. Elles durent 10 minutes chacune en moyenne.
«Le lac Saint-Augustin est bien connu des chercheurs, souligne Reinhard Pienitz. Mon collègue du Département de biologie, Warwick Vincent, et moi avons mené des études sur ce plan d’eau depuis le début des années 2000. Nos articles scientifiques ont fait connaître le lac Saint-Augustin pour sa problématique de floraison d’algues. Diverses pressions s’exercent sur ce plan d’eau. Une autoroute passe à proximité. On trouve également des terres agricoles, un terrain de golf, beaucoup de chalets, des hydravions et un camp de vacances axé sur les sports nautiques. Ce contexte complexe constitue un très bon exemple pour l’apprentissage de tous les défis visant à maintenir la qualité de l’eau d’un lac.»
Un certain nombre d’étudiants seront autorisés à se rendre au laboratoire du pavillon Abitibi-Price pour le travail de microscopie sur les microorganismes prélevés dans le lac Saint-Augustin. «Les résultats d’analyse, indique-t-il, donneront une meilleure idée de l’ampleur des impacts humains à cet endroit. Ils contribueront à savoir comment et pourquoi la qualité de l’eau a changé.»