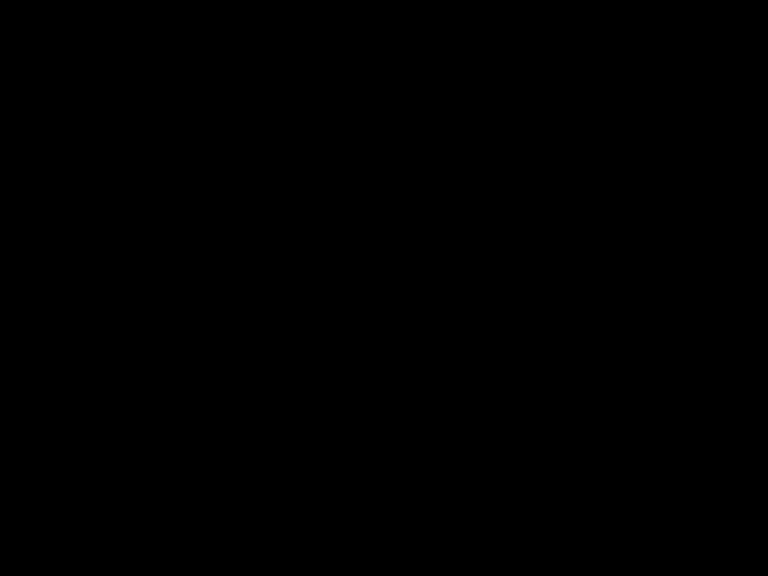
Les chercheurs ont reconstitué l’histoire du lac Dauriat grâce aux sédiments qui se sont déposés au fond de ce plan d’eau au fil des ans. Ces archives naturelles recèlent des informations qui permettent non seulement d’établir les concentrations d’éléments chimiques à diverses époques, mais aussi de déterminer la composition de certaines communautés d’algues qui vivaient dans ce lac. Les diatomées sont des algues unicellulaires recouvertes d’une coque de silice — non biodégradable — finement ouvrée et propre à chaque espèce. L’abondance relative des espèces de diatomées retrouvées à différentes profondeurs dans les sédiments témoigne des conditions physicochimiques du moment parce que chaque espèce prolifère ou se raréfie en fonction de ses préférences écologiques.
Grâce aux carottes de sédiments prélevées au fond du lac Dauriat, les chercheurs ont reconstitué son histoire naturelle entre 1882 et 1999. Les bouleversements occasionnés par les activités humaines à partir des années 1950 y sont manifestes. Le taux de déposition de métaux comme le plomb, le mercure, le cadmium, le bismuth, le cobalt, le cuivre et le zinc a augmenté par un facteur allant de 5 à 8 fois après le début de l’activité minière. «C’est sans doute le résultat d’une contamination atmosphérique parce que les eaux de la mine n’étaient pas rejetées dans le lac», signale Reinhard Pienitz.
Le taux de matière organique dans les sédiments, qui était de 7 % avant les années 1940, a grimpé à 32 % lorsque la population a dépassé 4 000 personnes, preuve d’une eutrophisation rapide attribuable au déversement des eaux usées municipales dans le lac. Les communautés de diatomées, constituées de 168 espèces dans la période pré-mine, se sont appauvries au point où une seule espèce, tolérante à la pollution organique, en est venue à représenter 80 % de toutes les diatomées du lac.
En 1975, la construction d’un système de traitement des eaux usées a eu un effet positif immédiat, révèlent les données des chercheurs. La fermeture de la mine en 1982 et l’exode de la population qui s’ensuivit (Schefferville compte à peine 200 citoyens aujourd’hui) ont accentué le rétablissement du lac. Malgré cela, les communautés d’algues diffèrent encore considérablement de celles qu’on retrouvait avant les années 1950. Le taux de matières organiques (15 %) et les concentrations d’une vingtaine de métaux sont en baisse, mais ils demeurent plus élevés qu’avant la période minière. Les taux d’arsenic, de cadmium, de chrome, de cuivre, de plomb, de mercure et de zinc dépassent encore les valeurs jugées acceptables pour les espèces aquatiques.
Même si l’eau qu’il contient est renouvelée une dizaine de fois par année, le lac Dauriat n’a toujours pas retrouvé son état naturel 20 ans après la quasi-fermeture de la ville. «Le brassage des eaux remet les sédiments contaminés en suspension, ce qui nuit au rétablissement du lac», explique Reinhard Pienitz. Selon le professeur du Département de géographie, il est très difficile de préciser dans combien de temps le lac retrouvera son état naturel, mais il faudra sans doute quelques décennies encore. «L’élimination de toutes les sources de contamination ne suffit pas pour assurer le rétablissement rapide d’un lac aussi contaminé que le lac Dauriat», dit-il.
La même conclusion s’applique aux lacs du sud du Québec, poursuit le chercheur. «Même si on cesse de polluer et qu’on plante des arbres sur les berges d’un lac, il faut de nombreuses années avant que les conditions redeviennent ce qu’elles étaient. Le recours à des procédés technologiques, comme le scellage des sédiments, peut accélérer les choses, mais ce n’est pas applicable à tous les plans d’eau. Croire que l’on peut retourner rapidement un lac à son état naturel est utopique et dénote une méconnaissance de l’écologie aquatique.»


























