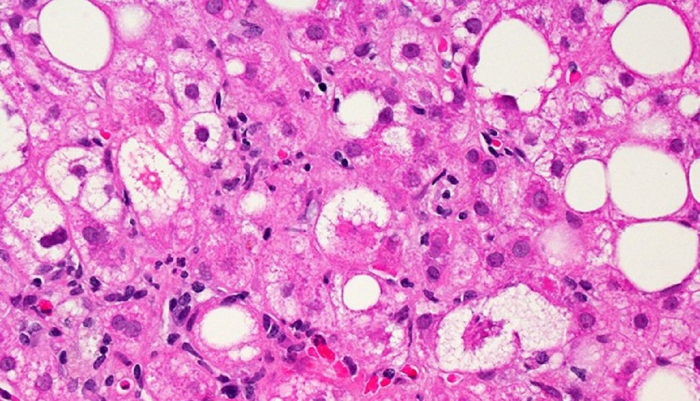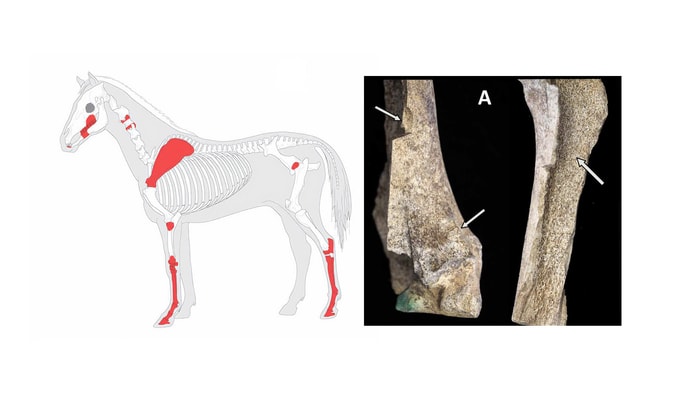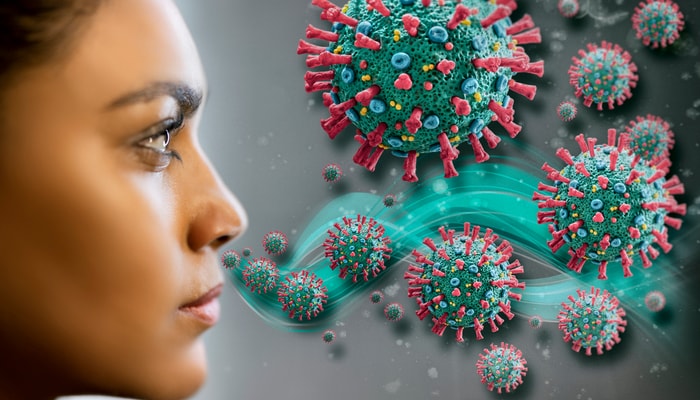Les nouveaux tests génomiques non invasifs pour dépister la trisomie 21 reposent sur la présence d'ADN d'origine foetale dans le sang de la mère. Ils permettraient de mieux cibler les femmes à qui l'amniocentèse est proposée.
À l'instar de nombreux autres États, le Québec dispose d'un programme de dépistage prénatal de la trisomie 21 qui est offert à toutes les femmes enceintes, peu importe leur âge. Ce programme comprend un test biochimique mesurant l'abondance de certains marqueurs dans le sang de la mère et une échographie, tous deux effectués à la 10e semaine de grossesse. Un second test sanguin a lieu au début du deuxième trimestre. «Les résultats de ces tests ainsi que certains facteurs de risques maternels sont combinés dans une équation qui sert à établir le risque que le foetus soit atteint de trisomie, explique François Rousseau. Lorsque ce risque dépasse un sur 300, un test diagnostique est offert aux parents. Comme ce test repose sur l'examen des chromosomes du foetus, il faut obtenir des cellules foetales en prélevant du liquide dans la cavité amniotique. Cette intervention, appelée amniocentèse, provoque des fausses-couches dans environ un cas sur 200.»
Chaque année, environ 2 000 des quelque 50 000 femmes qui participent au programme québécois de dépistage de la trisomie 21 se retrouvent dans le groupe de personnes à qui l'amniocentèse est proposée. Au final toutefois, à peine 100 d'entre elles portent un foetus atteint de trisomie. «Il serait avantageux de pouvoir mieux cibler les femmes appelées à subir une amniocentèse afin d'éviter des risques inutiles, fait valoir le professeur Rousseau. Les nouveaux tests génomiques qui reposent sur la présence d'ADN d'origine foetale dans le sang de la mère laissent entrevoir cette possibilité.»
Ces tests génomiques permettent d'établir avec un degré élevé de certitude si le foetus présente une anomalie chromosomique, mais ils ont toutefois un coût. Pour déterminer les répercussions de l'introduction de ces tests sur l'efficacité et sur les coûts du programme québécois de dépistage de la trisomie 21, les chercheurs ont réalisé des simulations sur le superordinateur Colosse de l'Université Laval. Les scénarios testés au cours de ces simulations s'inspiraient de différents programmes de dépistage utilisés à travers le monde, dont celui du Québec, auxquels était ajouté ou non un test génomique prénatal. Ces scénarios étaient appliqués à une population de femmes présentant les mêmes caractéristiques et faisant les mêmes choix que les quelque 113 000 Québécoises qui ont eu une grossesse en 2014.
Les analyses des chercheurs révèlent que le scénario le plus intéressant serait de conserver les deux tests biochimiques sanguins et, lorsque le risque auquel ils arrivent est supérieur à un sur 300, de recourir au test génomique non invasif. L'amniocentèse serait proposée aux femmes pour qui ce test conclut à un risque élevé. «Le coût d'un tel programme et son efficacité pour dépister les cas de trisomie seraient comparables au programme actuel, mais le nombre d'amniocentèses passerait de 2 000 à 260 par année.»
Les conclusions de cette étude ont été transmises au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. «Les tests génomiques non invasifs sont déjà offerts dans les cliniques privées au Québec et ailleurs au Canada. Nos travaux montrent qu'il serait avantageux de les inclure dans le programme public de dépistage de la trisomie 21», résume François Rousseau.
Les autres chercheurs de l'Université Laval qui ont participé à cette étude sont Léon Nshimyumukiza, Julie Duplantie, Jean Gekas, Yves Giguère, Daniel Reinharz et Jean-Alexandre Beaumont, de la Faculté de médecine, et Christian Gagné, du Département d'informatique et de génie logiciel.