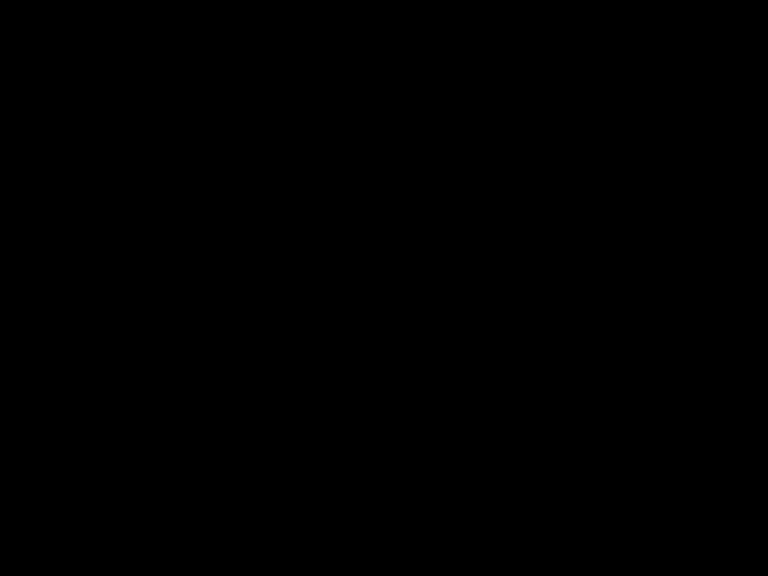
Les nanostructures (les spirales vertes avec le capuchon blanc) se fixent à une enzyme (les tés verts) surexprimée dans les membranes des cellules cancéreuses de la prostate (l'amas rouge). L'enzyme scinde les nanostructures et active ainsi leur pouvoir de perforation des membranes.
— Gertrude Fiset
Le chercheur et ses collègues Pierre-Luc Boudreault, Mathieu Arsenault et François Otis livrent les détails de leur découverte dans un article diffusé dans le site Web de la revue Chemical Communications, dont l’édition papier paraîtra en mai. C’est en misant sur une approche biomimétique qu’ils ont réussi à développer cet outil. «La nature fait de la nanotechnologie depuis des millions d'années avec une efficacité remarquable, dit Normand Voyer. Nous tentons de calquer sa façon de faire en assemblant des molécules qui agissent comme certains poisons naturels en perturbant la membrane des cellules.»
Cette équipe de recherche avait précédemment démontré le pouvoir perforant d’un peptide créé dans son laboratoire. «Le problème consistait à trouver une façon d’utiliser ce pouvoir contre les cellules cancéreuses sans que les cellules normales en souffrent», résume le professeur Voyer. Les chercheurs ont tiré parti du fait que la membrane des cellules cancéreuses de la prostate surexprime une enzyme (la PSMA) pour résoudre ce problème. Ils ont modifié leur peptide en lui ajoutant deux acides aminés, qui inhibent son pouvoir perforant et lui confèrent une affinité pour la PSMA. Lorsque la nanostructure croise une cellule cancéreuse, elle se fixe à la PSMA qui la scinde, réactivant le pouvoir perforant du peptide de départ. Des tests effectués in vitro ont démontré l’efficacité du procédé contre des cellules cancéreuses de la prostate.
«La prochaine étape consiste à trouver une façon de rendre la nanostructure inoffensive pour les autres cellules après son activation, souligne Normand Voyer. Nous croyons pouvoir y arriver en misant sur des enzymes, libérées par les cellules cancéreuses lors de leur destruction, qui la scinderaient en composés bénins.» La conception d’agents nanothérapeutiques ciblant d’autres cancers serait envisageable à condition que la membrane des cellules cancéreuses soit le site d’une activité moléculaire qui leur soit propre, précise le chercheur.


























