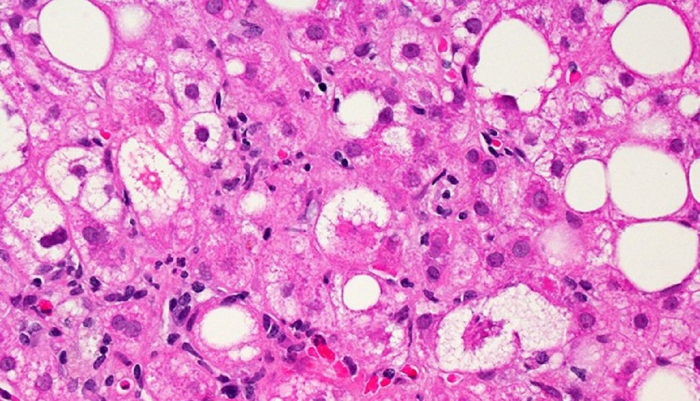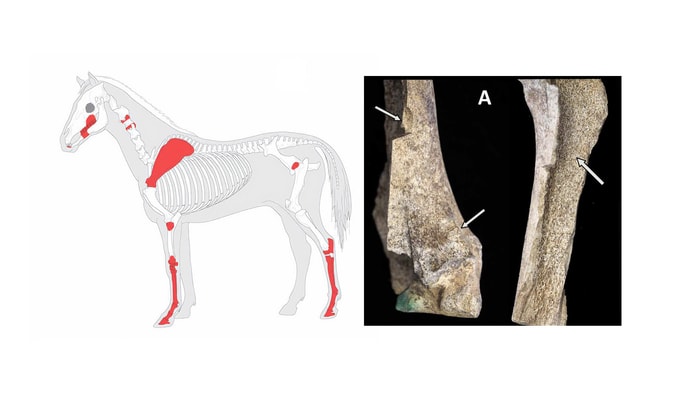«Nous ne savons pas encore si ces changements dans les communautés de phytoplancton se maintiendront, reconnaît Connie Lovejoy, mais si c'est le cas, ils risquent de se répercuter sur les espèces de zooplancton qui s'en nourrissent et sur le reste de la chaîne alimentaire dans l'océan Arctique.»
— Marc Robitaille
Connie Lovejoy, du Département de biologie, et ses collègues William Li, Fiona McLaughlin et Eddy Carmack, de Pêches et Océans Canada, arrivent à cette conclusion après avoir étudié l'évolution de communautés de phytoplancton pendant cinq ans dans l'océan Arctique. Les chercheurs ont parcouru, à bord du brise-glace Louis-Saint-Laurent, le bassin canadien de cet océan pour récolter à répétition des algues et des données physicochimiques en 23 points d'échantillonnage. Leur attention s'est portée sur le picophytoplancton (des algues dont la taille est inférieure à 2 microns) et sur le nanophytoplancton (de 2 à 20 microns) «parce que ces deux groupes sont responsables de la plus grande partie de la production primaire dans l'océan Arctique», précise Connie Lovejoy.
Entre 2004 et 2008, le picoplancton a prospéré alors que le nanoplancton a piqué du nez. Les chercheurs attribuent ces changements à trois facteurs environnementaux induits par le réchauffement climatique. D'abord, les eaux de surface se sont réchauffées. Ensuite, leur salinité a diminué en raison d'un apport accru d'eau douce provenant des rivières et de la fonte de la banquise. L'effet combiné de ces deux facteurs est que la couche supérieure de la colonne d'eau est moins dense qu'auparavant. Enfin, pour des raisons encore indéterminées, la concentration de nitrates (l'élément qui limite la croissance des algues dans ce milieu) a diminué à la surface de l'océan. Le picoplancton, en raison de son rapport surface/volume élevé, aurait tiré profit des nouvelles conditions qui prévalent en surface. En effet, cette particularité leur permet de mieux flotter et d'absorber plus efficacement les nitrates que les algues de plus grande taille.
Les chercheurs ont observé que la quantité de chlorophylle par mètre cube d'eau — un indicateur de l'abondance totale des algues —, est demeurée stable au cours des cinq années de l'étude. Ceci laisse supposer que les gains du picoplancton se sont faits au détriment du nanoplancton. «Nous ne savons pas encore si ces changements dans les communautés de phytoplancton se maintiendront, reconnaît Connie Lovejoy, mais si c'est le cas, ils risquent de se répercuter sur les espèces de zooplancton qui s'en nourrissent et sur le reste de la chaîne alimentaire dans l'océan Arctique.»