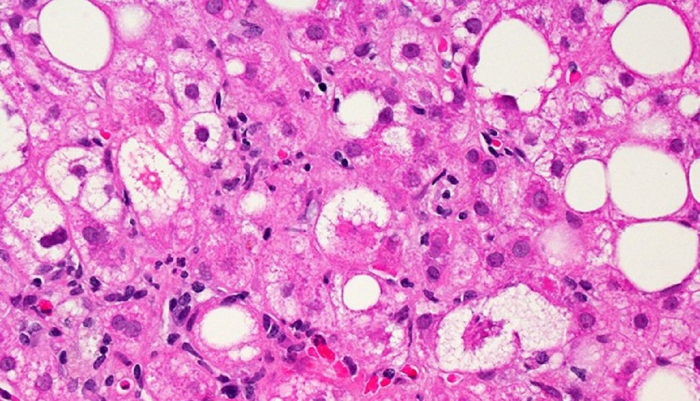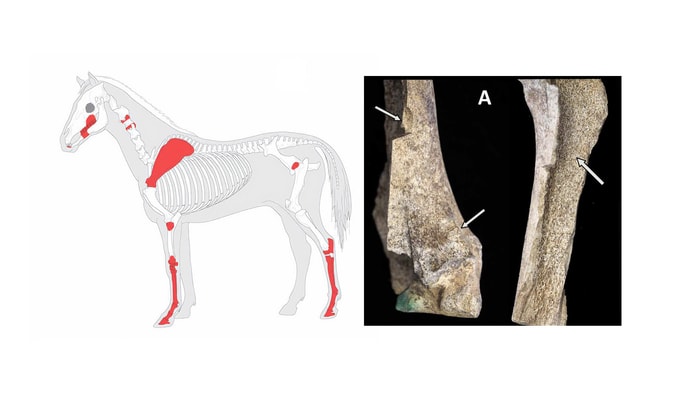Claire Deschênes, dans le Laboratoire de machines hydrauliques: «Nos partenaires s'intéressent aux données que nous allons leur fournir, mais ils souhaitent aussi participer à la formation de spécialistes qui pourront assurer la relève dans le domaine de l'industrie hydroélectrique».
Le consortium regroupe les compagnies hydroélectriques Hydro-Québec et le plus grand producteur d’électricité du Venezuela, CGV Edelca, les fabricants de turbines Alstom Hydro Canada, Va Tech Hydro et Voith Siemens Hydro, ainsi que Ressources naturelles Canada. Le CRSNG accorde 560 000 $ au projet alors que les autres partenaires y vont chacun d’une contribution de 300 000 $. «Je suis particulièrement fière d’avoir convaincu des entreprises qui sont habituellement en concurrence de s’associer au consortium», souligne la professeure Deschênes.
Les outils de conception et d’analyse de turbines hydrauliques sur lesquels travaillera le groupe de Claire Deschênes revêtent un intérêt stratégique pour les entreprises participantes. «Pour les fabricants de turbines, c’est une occasion d’obtenir des données qui leur permettront de concevoir des produits qui ont un meilleur comportement dynamique dans toutes les conditions d’opération. De leur côté, les compagnies hydroélectriques pourront utiliser les données recueillies pour optimiser la puissance électrique produite à partir de leurs installations et pour prolonger la durée de vie de leurs turbines», assure la chercheuse.
Unique au Canada
Les laboratoires indépendants voués à la recherche sur les turbines sont rares à travers le monde. Le Laboratoire de machines hydrauliques (LAMH), que Claire Deschênes dirige depuis son embauche à l’Université en 1989, est le seul du genre au Canada. L’imposant dispositif du LAMH, réparti sur trois étages du pavillon Pouliot, permet d’étudier le comportement dynamique d’une turbine placée dans un circuit où l’eau, poussée par une pompe, peut atteindre un débit de 1 m3 à la seconde. L’équipe du LAMH et les représentants des partenaires définiront conjointement les projets qu’ils désirent étudier. Les résultats des essais seront regroupés dans une banque de données qui sera mise à la disposition de tous les membres du consortium.
«Notre équipement est à la fine pointe de la technologie et notre expertise est reconnue, ce qui explique pourquoi nous avons réussi à intéresser ces grandes entreprises. Le fait que nous puissions entièrement consacrer nos installations à la recherche sur un sujet donné pendant une période prolongée et associer des étudiants-chercheurs au projet n’est pas étranger à leur intérêt», signale Claire Deschênes. Ce dernier point est un élément majeur qui a conduit à la création du consortium, ajoute-t-elle. «Nos partenaires s’intéressent aux données que nous allons leur fournir, mais ils souhaitent aussi participer à la formation de spécialistes qui pourront assurer la relève dans le domaine de l’industrie hydroélectrique.»
La professeure Deschênes estime que les travaux que mènera le consortium au cours des prochaines années constituent l’occasion de développer un centre de compétence en turbines à l’Université. «Par leur capacité à produire une énergie renouvelable à un prix très compétitif, les turbines gardent un grand potentiel de croissance dans un futur proche et le LAMH veut se positionner comme un acteur important dans leur développement.»