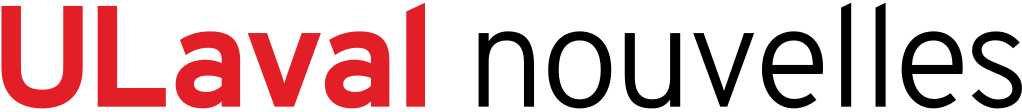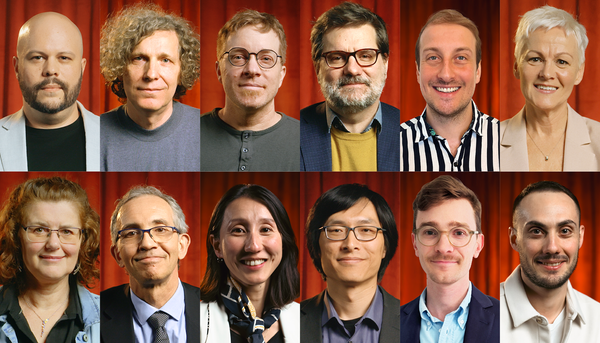— GETTY IMAGES/DAISY-DAISY
Lorsqu'elle donne de la formation au sujet de la polypharmacie et de la déprescription, Caroline Sirois utilise des bonbons pour montrer la quantité de médicaments ingurgités par une personne âgée. Leur nombre peut atteindre 10, 15, 20 comprimés, avalés trois ou quatre fois par jour. Si certains sont nécessaires, d'autres peuvent causer «plus de mal que de bien», souligne la professeure à la Faculté de pharmacie. Ses travaux de recherche convergent vers un but: comment faire le ménage dans le pilulier des aînés pour offrir un traitement global de meilleure qualité?
«Le problème, dit-elle, c'est l'accumulation de médicaments et leurs interactions. Plus on a de prescriptions, plus on a de risque d'avoir des médicaments potentiellement inappropriés, qui ont plus d'inconvénients que de bénéfices pour les patients. Les effets secondaires s'accumulent et les gens ne réalisent pas que ça a des impacts importants sur la cognition, sur les risques de chute, sur beaucoup d'éléments de la vie quotidienne.»
Elle pointe notamment les médicaments avec des propriétés anticholinergiques, une vaste catégorie qui comprend entre autres des produits pour traiter les allergies, les nausées, la dépression, l'insomnie et l'incontinence urinaire. Lorsqu'on les accumule, ces produits peuvent provoquer de la sécheresse à la bouche et aux yeux, de la constipation, des étourdissements et un ralentissement qui peut affecter la mobilité. «Notre objectif est de conscientiser les gens à tout ça.»

La professeure Caroline Sirois
Où se situe le Québec?
Les inquiétudes autour de la polypharmacie, la prise simultanée de plusieurs médicaments, ont émergé il y a une douzaine d'années, indique la professeure. C'est à ce moment qu'elle a été mandatée par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), duquel elle est devenue chercheuse associée, pour réaliser une surveillance populationnelle sur le sujet. Le Québec et le Canada ont mis sur pied le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription en 2015, soit un an après la première initiative du genre en Australie.
«Le réseau canadien est vraiment très actif au niveau politique. Il a aussi développé des outils pour les cliniciens, pour les patients, qui sont utilisés partout dans le monde. On est des leaders.»
En contrepartie, «on est pas mal des champions dans l'usage de médicaments potentiellement inappropriés», soulève la professeure Sirois. Mais la conscientisation fait son chemin, dit-elle, alors que la proportion de personnes qui ingèrent jusqu'à 20 médicaments différents dans une année s'améliore, c'est-à-dire décroît.
Une étudiante qu'elle supervise au doctorat a, par exemple, relevé une diminution de l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons, prescrits contre l'acidité gastrique. L'usage des benzodiazépines, qui aident à dormir, tend aussi à diminuer. «Il y a une compensation avec d'autres médicaments de remplacement, certains types d'antipsychotiques qui ont le même effet. Mais dans l'ensemble, on consomme moins d'antipsychotiques inappropriés qu'avant au Québec: il y a tellement eu de travail dans les centres de soins de longue durée pour réduire ça, il y a eu des initiatives provinciales et ça a porté fruit», se réjouit la professeure, aussi chercheuse au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec.
— Caroline Sirois, sur la difficulté à changer les habitudes
Le grand défi des chercheurs dans ce domaine est celui de la perception, poursuit Caroline Sirois. «C'est très difficile d'aller changer des habitudes. Par exemple, les gens ont un attachement profond aux médicaments pour dormir, bien qu'ils ne fonctionnent plus quand ils sont utilisés depuis trop longtemps, qu'ils sont associés à plein d'effets indésirables et qu'ils créent de la dépendance physique.»
Une étude qu'elle a publiée l'an dernier révélait que 85% des personnes âgées seraient disposées à abandonner au moins un médicament si leur médecin le recommandait. Par ailleurs, 94% des répondants se disaient satisfaits de leur médication. «C'est un beau paradoxe. On est allés sonder des personnes très âgées, de 85 ans et plus, leurs proches aidants, des professionnels de la santé pour essayer de comprendre. On se rend compte que les gens, autant les proches aidants que les patients, ont une confiance absolue envers leur médecin. Donc, ils se disent: “Si c'est prescrit, c'est bon pour moi!” Ils ne remettent jamais en question.»
Elle ajoute que les patients trouvent aussi normal de prendre plusieurs médicaments parce qu'ils sont âgés et cumulent les maladies.
«Tout le monde veut bien faire, le médecin veut tout traiter, mais on perd de vue la personne», analyse Caroline Sirois. Un taux de glycémie «encore un peu élevé» mérite-t-il vraiment qu'on prescrive un 13e médicament «pour faire mieux»? questionne-t-elle.
Discussions entre pharmaciens et médecins
La professeure remarque toutefois une ouverture d'esprit du milieu clinique au Québec. «Nos collègues en Europe tombent des nues quand on leur dit qu'on a appelé un médecin de famille pour établir un sevrage. Parfois, c'est même le médecin qui appelle. Ce n'est pas dans leur culture, alors que, pour nous, ce contact est plus facile.»
Elle ajoute que ces démarches ne sont pas improvisées et qu'avec le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription, il y a des données probantes sur lesquelles s'appuyer. «Il y a des lettres intégrées et standardisées dans les logiciels des pharmacies pour communiquer avec les médecins: ''On voudrait cesser tel médicament, pour telle raison, selon tels critères''», illustre la professeure.
Le but n'est pas de tout arrêter, mais d'optimiser, insiste-t-elle en faisant une mise en garde. «On ne peut pas décider d'arrêter soi-même un médicament du jour au lendemain. Il importe de suivre un plan déterminé avec le médecin et le pharmacien. C'est hyper important!»
Quel est le seuil à ne pas dépasser?
Avec ses étudiants aux cycles supérieurs, Caroline Sirois raffine les connaissances sur la polypharmacie et ses conséquences. «Les analyses statistiques ont montré que les patients avec les pharmacothérapies les plus lourdes, ceux qui ont le plus de médicaments potentiellement inappropriés, ont une probabilité plus grande d'aller en CHSLD dans les trois années qui suivent», dit-elle en parlant de données importantes pour les aînés, qui appréhendent cette étape dans leur vie.
Elle travaille aussi à trouver un seuil, c'est-à-dire un nombre de médicaments à partir duquel il faut se poser des questions «parce que les thérapies ne sont plus complémentaires, mais compétitives».
La surveillance se poursuit à l'INSPQ, indique la chercheuse. «Dès qu'il y a des initiatives mises en place, on est capables de voir l'évolution dans le temps, on peut mesurer les effets à l'échelle populationnelle.»
Brassage de connaissances
Caroline Sirois parle de recherche et d'enseignement avec une passion contagieuse. «J'ai toujours aimé partager mes connaissances», dit la pharmacienne qui, après quelques années de pratique dans le monde communautaire et le milieu hospitalier, a poursuivi une maîtrise et un doctorat en pharmacoépidémiologie à l'Université Laval, puis une formation postdoctorale à l'Université McGill. Elle a d'abord enseigné à l'Université du Québec à Rimouski, un poste où elle a côtoyé infirmières et infirmiers, travailleuses et travailleurs sociaux ayant des philosophies différentes. «J'ai appris plein de choses!»
En 2016, elle devient titulaire de la Chaire de recherche sur le vieillissement à la Faculté de médecine de l'Université Laval, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2019. Depuis, son parcours de professeure se poursuit et s'enrichit à la Faculté de pharmacie. «Avec l'intelligence artificielle, je rencontre des gens d'autres disciplines, de cultures de recherche différentes. On travaille avec des partenaires en génie, en acceptabilité sociale. Je trouve ça extraordinaire de faire fusionner tout ça, de regarder des problématiques avec des visions extérieures.»
Ce bagage, elle le partage avec ses étudiantes et ses étudiants à la maîtrise et au doctorat. Elle a d'ailleurs son «mur des célébrités» avec leurs photos dans son bureau. À leur niveau, dit-elle, ils sont déjà sensibilisés au phénomène de la polypharmacie et ils l'aident à le documenter.
Pour la première fois cette année, elle a eu l'occasion d'aborder le sujet avec des étudiantes et des étudiants au premier cycle. «Je fais des quiz, je leur demande quel est le pourcentage de la population qui prend cinq médicaments et plus dans une année. Ils sous-estiment, ils ne réalisent pas l'ampleur», note la professeure qui leur révèle que 75% des gens en prennent 5 et plus, et que 30% en prennent 10 et plus.
C'est une occasion pour elle d'intervenir, «d'inciter à traiter de façon optimale, à penser à l'individu, à ce que le patient veut, et non pas juste à la maladie».
«Pourquoi commencer un médicament contre le cholestérol avec une personne de 95 ans qui n'a pas d'antécédents? Est-ce qu'elle en profite? Est-ce qu'elle a des effets secondaires? Ce sont des médicaments qui coûtent cher. On a une population vieillissante, de plus en plus de traitements à donner, est-ce qu'on peut se le permettre? On a une réflexion de société à avoir», conclut Caroline Sirois, tout en pensant que le patient aura toujours le droit de choisir pour lui-même.