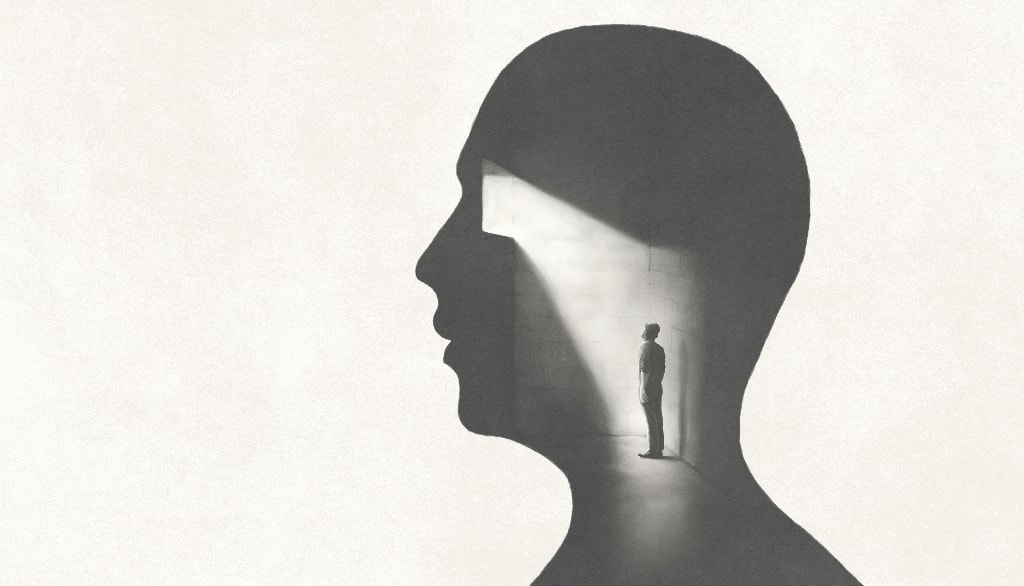
«Je ne pense pas qu'on puisse attribuer à une loi ou à une mesure en particulier la chute observée au Canada depuis les années 1970-1980; j'ai l'impression que c'est un ensemble de facteurs», commente le professeur Lussier.
— GETTY IMAGES/FRANCESCOCH
Nouvelle encourageante: entre 1940 et 2019, le taux de récidive des délinquants sexuels a chuté de près de 70% au pays, d'après une étude publiée dans la revue Criminology and Public Policy. L'amélioration des connaissances sur la délinquance sexuelle et la formation des intervenants du système pénal pourraient expliquer ces résultats, avance Patrick Lussier, professeur à l'École de travail social et de criminologie et responsable de cette méta-analyse.
Pendant deux ans, son équipe de recherche a fait un survol de toute la documentation scientifique canadienne sur le sujet. Elle a passé en revue 185 études qui avaient analysé le taux de récidive de 226 groupes de délinquants sexuels à travers le pays et au fil du temps, portant l'échantillon à 55 944 contrevenants.
Les résultats ont montré qu'entre 1940 et 1979, le taux de récidive moyen pondéré était de 23%, alors que de nos jours, il se situe autour de 7%. D'où la chute frôlant les 70%.
«Je ne pense pas qu'on puisse attribuer à une loi ou à une mesure en particulier la chute observée au Canada depuis les années 1970-1980; j'ai l'impression que c'est un ensemble de facteurs», commente le professeur Lussier. Le chercheur précise que cette baisse considérable s'est entamée au moins 20 ans avant la mise en place du registre canadien des délinquants sexuels, en 2004. «Ce registre non public, destiné essentiellement à faciliter le travail des enquêteurs, n'est pas la cause de cette chute; il faut regarder ailleurs.»
Une plus grande expertise
Parmi les hypothèses soulevées dans la méta-analyse, il mentionne une amélioration des connaissances pour comprendre la délinquance sexuelle, notamment les facteurs associés à la récidive. «Quand on comprend mieux les contextes qui poussent un individu à passer de nouveau à l'acte, on est peut-être en meilleure posture pour prévenir la récidive et, évidemment, adapter les programmes de traitement», suggère le professeur Lussier.
Il ajoute qu'il y a une plus grande collaboration entre les milieux correctionnels et universitaires, et que la pratique a évolué: les intervenants sont dorénavant formés. «Il n'y avait même pas de criminologie au Canada avant les années 1960!», dit-il en parlant de son domaine d'étude, qui se penche sur les causes et le processus du passage à l'acte criminel.
Les agents de probation et de libération conditionnelle, à cette époque, étaient souvent des enseignants à la retraite, des ex-militaires ou des policiers en réorientation de carrière, illustre le professeur. Alors qu'aujourd'hui, on peut se tourner vers des criminologues, des psychologues, des psychiatres, des sexologues, des travailleurs sociaux… Autant de professionnels qui se retrouvent dans les établissements de détention, les pénitenciers, les maisons de transition et les services de probation.
«Il y a vraiment une expertise qui s'est développée pour répondre aux besoins de cette clientèle et qui travaille de concert pour prévenir la récidive de crimes à caractère sexuel.»
Regard vers les États-Unis
L'équipe poursuit ses recherches et se tourne vers les États-Unis, où l'on mise sur l'incarcération et de longues peines pour combattre la criminalité. On y retrouve aussi des registres publics de délinquants sexuels, avec leur nom, leur lieu de résidence, voire leur lieu de travail et une photo. Une étude comparative avec la situation américaine est donc à venir.
«On a commencé à travailler avec une chercheuse américaine. Il y aura d'autres collaborations internationales. C'est vraiment un projet, une initiative qu'on entend continuer encore plusieurs années», indique Patrick Lussier, dont l'équipe a élaboré la nouvelle méthodologie de recherche.
La méta-analyse publiée dans Criminology and Public Policy, dont Patrick Lussier est le principal auteur, est cosignée par Julien Frechette et Stéphanie Chouinard Thivierge, de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, Jean Proulx, de l'Université de Montréal et du Centre International de Criminologie Comparée, et Evan McCuish, de l'École de criminologie à l'Université Simon Fraser.


























