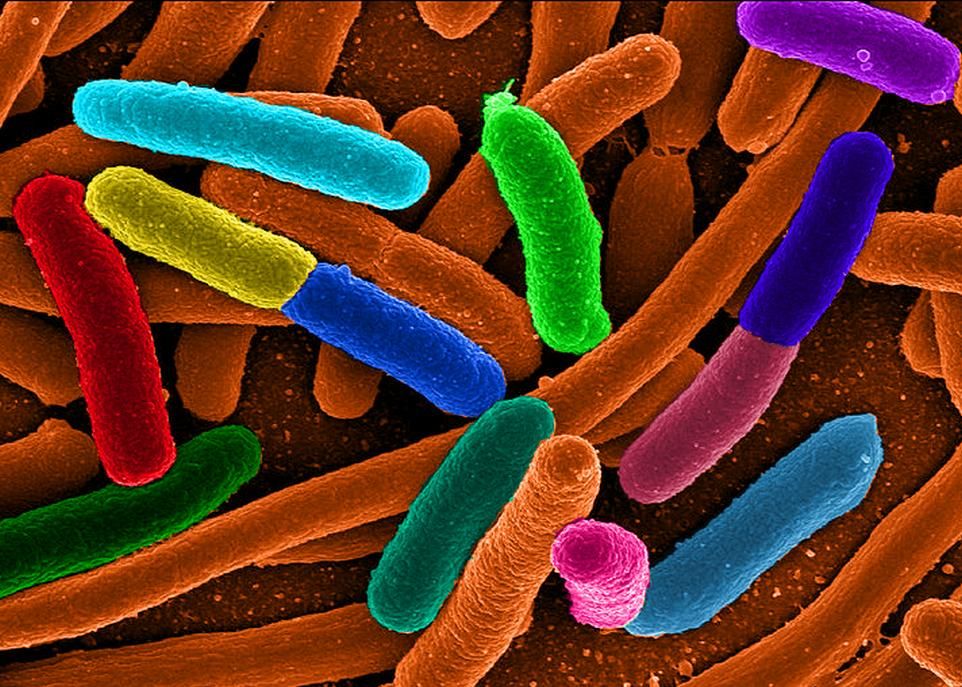
Les microARN du lait qui résistent à la digestion peuvent interagir avec le microbiote intestinal ou être assimilés par l'organisme, ce qui n'est pas forcément négatif. Chez les souris, par exemple, ils peuvent atténuer les symptômes de l'arthrite.
— Mattosaurus
Les chercheurs en ont fait la démonstration à l'aide d'un système artificiel qui imite le système digestif humain. «Ce système reproduit in vitro toutes les étapes biochimiques et biophysiques de la digestion, à l'exception de celles qui font intervenir les cellules humaines ou le microbiote, précise le responsable de l'étude, Patrick Provost. Nous l'avons utilisé pour déterminer si les microARN du lait pouvaient résister à la digestion dans l'estomac et l'intestin grêle.»
Les microARN sont de courts segments d'ARN qui interfèrent avec la synthèse protéique en bloquant la traduction des ARN messagers. Ils interviennent dans l'expression de 60% des gènes humains. «Chez les mammifères, les microARN sont très similaires d'une espèce à une autre, signale le chercheur. Par exemple, le degré de similarité entre les microARN de l'homme et ceux de la vache dépasse 99%. Les microARN d'origine bovine pourraient théoriquement interférer avec l'expression des gènes humains.»
Les tests effectués par les chercheurs montrent qu'un verre de lait peut contenir jusqu'à 1013 microARN de vache et qu'environ 20% de ceux-ci sortent indemnes de leur transit dans le système digestif artificiel. «Cette protection serait attribuable au fait qu'ils sont encapsulés dans des microparticules dont l'enveloppe de lipides est recouverte d'une couche de protéines. À l'opposé, les ARN libres – qui ne sont pas encapsulés dans des microparticules ou dans des exosomes – sont détruits lors de la digestion.»
Le protocole expérimental utilisé par les chercheurs est évidemment moins complexe que ce qui se produit dans l'estomac humain. «Un passage plus long dans le système digestif ou des interactions avec d'autres aliments conduisent peut-être à la dégradation d'un plus fort pourcentage de microARN, mais il y en a tellement au départ que, même là, une quantité appréciable de microARN fonctionnels pourraient échapper à la digestion», estime le professeur Provost. Des études antérieures ont montré que la présence de 1 000 copies d'un microARN dans une cellule suffit à produire un effet mesurable sur son activité biologique.
Pour l'instant, on ignore ce qu'il advient des microARN de vache dans l'intestin humain et si leur présence est bénéfique ou néfaste à la santé humaine, poursuit le chercheur. Ceux qui résistent à la digestion peuvent interagir avec le microbiote intestinal ou être assimilés par l'organisme. Les interactions entre les microARN d'une espèce et les gènes d'une autre espèce ne sont pas forcément négatives. Par exemple, des études publiées au cours des deux dernières années ont montré que les microARN du lait de vache pouvaient atténuer l'arthrite chez des souris et stimuler certaines fonctions immunitaires.
«Lorsque l'on s'alimente, on veut les protéines, les glucides, les lipides et les vitamines que nous fournissent d'autres espèces. Par contre, lorsqu'il est question de matériel génétique, on prend une autre position, qui incite davantage à la prudence. C'est pourquoi il est important de mieux documenter les effets positifs et négatifs des microARN de source alimentaire sur la santé humaine.»
L'étude publiée dans le Journal of Nutrition est signée par Abderrahim Benmoussa, Chan Ho C Lee, Benoit Laffont, Jonathan Laugier, Éric Boilard, Caroline Gilbert et Patrick Provost, de la Faculté de médecine, et par Patricia Savard et Ismail Fliss, du Département des sciences des aliments et de l'INAF.
Visionnez la présentation du système artificiel qui imite le système digestif humain.


























