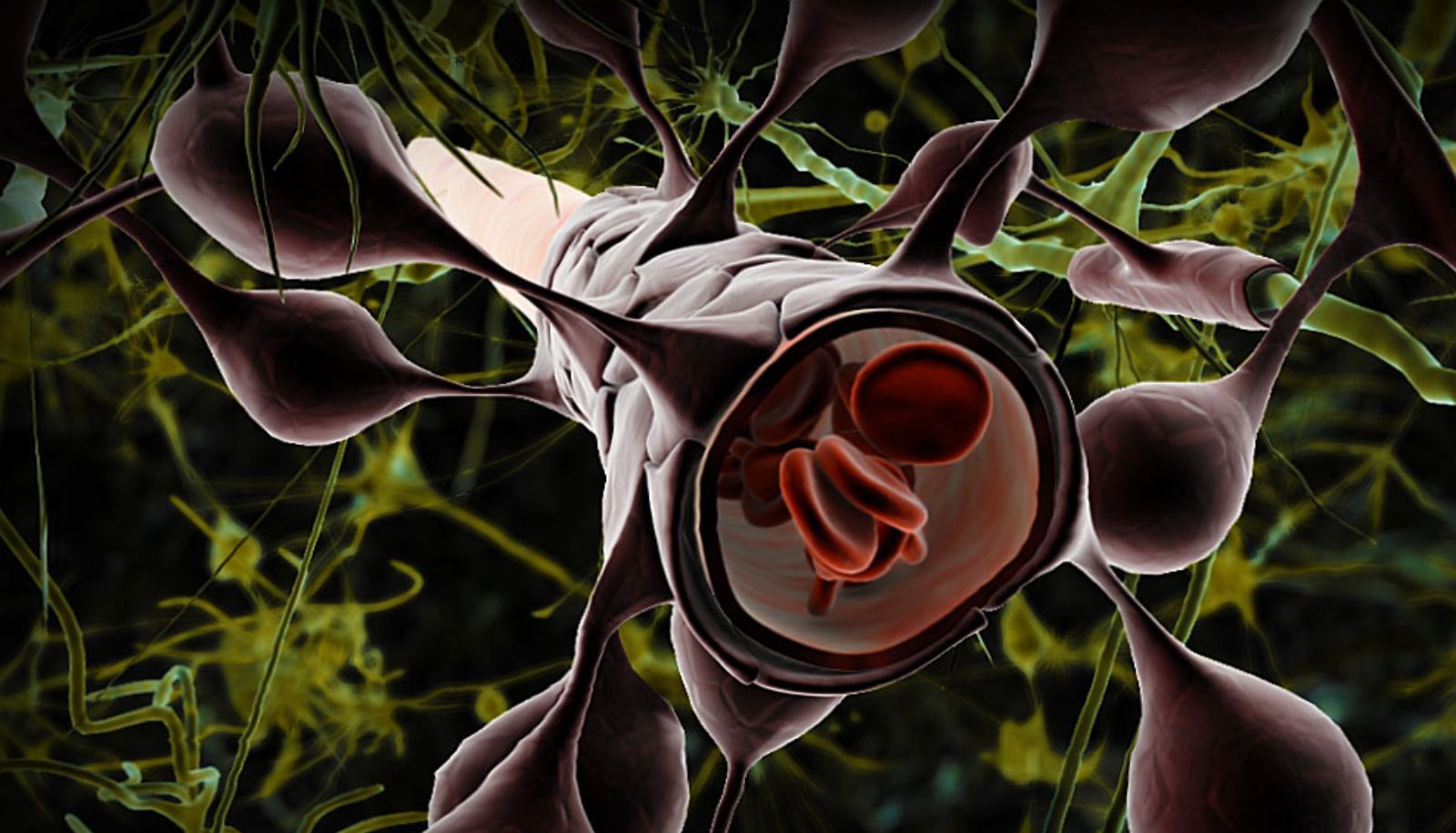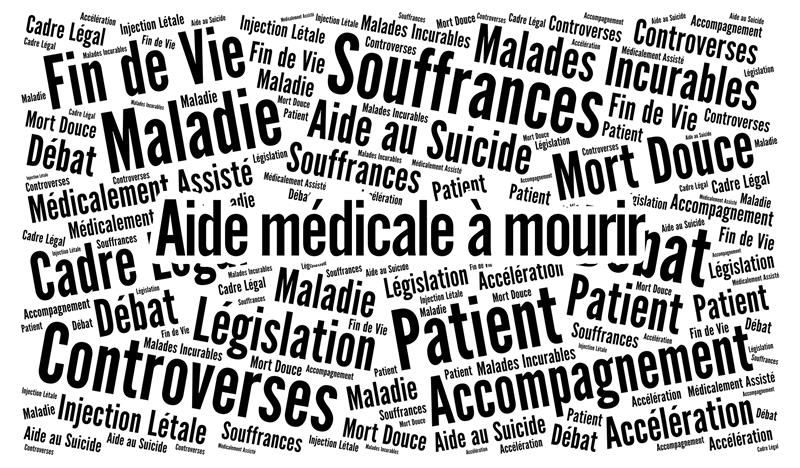Le glissement de terrain de La Grande, survenu en septembre 1987, a entraîné 3,5 millions de mètres cubes de matériau dans la rivière. La vague ainsi créée a cassé ou arraché tous les arbres de la rive opposée sur une distance d'environ 1 km.
— C. Locat
Le professeur Locat, Dominique Turmel et Jonathan Leblanc, du Département de géologie et de génie géologique, et leur collègue du ministère des Transports, Denis Demers, ont passé en revue quelques cas historiques de glissements de terrain survenus au Québec afin de savoir si un tsunami n'aurait pas suivi. «Nous avons fait une relecture des documents et des données existantes à la lumière de ce que nous savons maintenant sur les tsunamis», explique le chercheur.
L'ampleur des dommages causés par un tsunami dépend de plusieurs facteurs, notamment le volume de matériaux emportés par le glissement, la vitesse de ces matériaux au moment de leur entrée dans l'eau et la profondeur de l'eau. Les travaux de l'équipe du professeur Locat révèlent aussi le rôle d'un facteur négligé jusqu'à présent: la présence d'un couvert de glace. Ainsi, le tsunami le plus meurtrier survenu en sol québécois a eu lieu en Outaouais, à Notre-Dame-de-la-Salette, le 6 avril 1908. Cette catastrophe a fait 34 morts, mais seulement 6 décès ont été causés par le glissement de terrain lui-même, qui a frappé la rive ouest de la rivière du Lièvre; tous les autres ont été causés par l'onde qui a traversé la rivière pour venir s'abattre sur la partie la plus basse du village. «Le choc causé par les glaces emportées par la vague a sûrement contribué à alourdir les dommages», estime le professeur Locat.
Au total, une dizaine de tsunamis causés par des glissements de terrain seraient survenus au Québec depuis 400 ans. «C'est peu, mais c'est sûrement une sous-estimation parce que ceux qui se produisent dans des régions isolées passent souvent inaperçus, signale le chercheur. Somme toute, le risque n'est pas très élevé, mais, comme les tsunamis peuvent causer des décès, il y aurait lieu de déterminer les secteurs où des personnes ou des habitations seraient exposées à un tsunami advenant un glissement de terrain.»
Pour améliorer les connaissances sur ces phénomènes au Québec, le professeur Locat et son équipe ont entrepris de modéliser les tsunamis générés par des glissements de terrain. «À partir des prédictions de notre modèle, il sera plus facile de trouver des preuves qui témoigneraient qu'un tsunami a bien eu lieu à la suite d'un glissement.» Son équipe a d'ailleurs une cible de taille dans la mire: le méga-glissement survenu à Betsiamites sur la Côte-Nord, il y a 7 200 ans. «Ce glissement était d'une telle ampleur qu'il pourrait avoir laissé des traces de l'autre côté du fleuve, dans la région de Rimouski. Notre modèle nous aidera à déterminer à quel endroit il faut chercher les dépôts laissés par la vague du tsunami.»