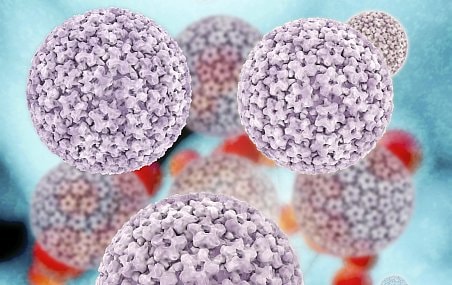
Le modèle développé par le professeur Brisson tient compte de nombreuses variables liées à la biologie du VPH ainsi qu'à la dynamique de la sexualité humaine. Il a fallu recourir au superordinateur Colosse de l'Université Laval pour effectuer les calculs.
Rappelons que le VPH compte parmi les infections transmises sexuellement les plus courantes. Certaines formes du virus causent des verrues et des lésions génitales ou anales. D'autres formes ont des répercussions plus graves puisqu'elles sont associées à certains cancers. Au Québec, par exemple, le VPH cause annuellement 400 cancers du col de l'utérus.
Depuis 2007, les provinces canadiennes et de nombreux pays ont implanté des programmes de vaccination contre le VPH. Comme les vaccins sont plus efficaces lorsqu'ils sont administrés à des personnes qui n'ont jamais été infectées par ce virus, les campagnes ciblent les jeunes filles de 9 à 13 ans. Depuis, plusieurs études ont montré que, à court terme du moins, l'immunité contre le VPH était comparable, peu importe si deux ou trois doses étaient administrées. «On ne connaît pas encore la durée exacte de protection du vaccin, mais si deux doses assurent une protection à long terme, la troisième dose pourrait être trop coûteuse pour les bénéfices en santé qu'elle procurerait. Le noeud du problème consiste donc à déterminer quelle doit être la durée de protection conférée par deux doses pour rendre cette stratégie coût-efficace», résume Marc Brisson.
C'est ce que son équipe et celle de Mark Jit ont fait en utilisant deux modèles de simulation mis au point de part et d'autre de l'Atlantique. Le modèle développé par le professeur Brisson tient compte de nombreuses variables liées à la biologie du virus ainsi qu'à la dynamique de la sexualité humaine, notamment le niveau d'activité sexuelle, le nombre de partenaires ainsi que la formation et la dissolution des couples selon les groupes d'âge. Il s'agit d'un modèle très complexe qui nécessite un grand temps de calcul sur des superordinateurs – dont le superordinateur Colosse de l'Université Laval – pour livrer ses fruits. Le modèle britannique emprunte une tout autre voie, mais la conclusion est la même dans les deux cas: deux doses du vaccin contre le VPH suffisent, à condition que la durée de la protection conférée par les deux doses soit d'au moins 20 ans.
«Les données disponibles ne semblent pas indiquer que l'efficacité vaccinale procurée par deux doses diminue dans les dix premières années, souligne le professeur Brisson. S'il devait y avoir une baisse, elle serait progressive. Les experts s'entendent sur le fait que la protection pourrait être d'au moins 20 ans, de sorte qu'une troisième dose ne semble pas procurer d'avantages. La protection offerte par deux doses couvrirait la période de vie pendant laquelle les femmes sont les plus actives sexuellement. L'économie de la troisième dose ne se ferait donc pas aux dépens de leur santé.»
Selon le chercheur, les conclusions des travaux qu'il a menés avec Mark Jit ont déjà une incidence sur les programmes de vaccination de plusieurs pays, notamment ceux du Canada et du Royaume-Uni, qui ont délaissé la troisième dose pour les jeunes de moins de 15 ans. «Cette stratégie pourrait représenter une économie importante qui se chiffre sans doute à plusieurs millions de dollars chaque année à l'échelle mondiale, avance-t-il. C'est encore plus important pour les pays en voie de développement qui disposent de ressources limitées pour mener des campagnes de vaccination contre le VPH.»


























