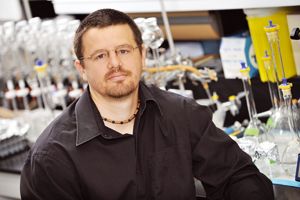
Sébastien Bonnet: «Notre découverte offre également de nouvelles possibilités thérapeutiques intéressantes pour d'autres maladies présentant les mêmes anomalies cellulaires, notamment certains types de cancers et de maladies vasculaires».
— Marc Robitaille
L’hypertension artérielle pulmonaire se caractérise par une multiplication excessive des cellules qui tapissent l’intérieur des artères menant le sang du cœur vers les poumons. Ce rétrécissement des artères pulmonaires entraîne un effort accru du cœur et en provoque la détérioration progressive. Il n’existe aucun traitement curatif efficace, et plus de la moitié des personnes atteintes succombent au cours des cinq années suivant le diagnostic.
Les chercheurs ont découvert qu’en accélérant le métabolisme des cellules, c’est-à-dire en stimulant l’ensemble des processus chimiques qui les maintiennent en vie, il est possible de stopper la multiplication cellulaire désordonnée à l’origine de l’hypertension pulmonaire. Pour y arriver, ils ont retiré du bagage génétique de souris le gène codant pour une enzyme appelée MDC, dont la fonction est justement de freiner le métabolisme cellulaire. Ils ont constaté qu’en l’absence de cette enzyme, les rongeurs ne développent pas d’hypertension artérielle pulmonaire.
Le DCA et la TMZ
Le professeur Bonnet et ses collègues se sont par la suite mis à la recherche de composés chimiques ayant le même effet que l’absence de l’enzyme MDC sur le métabolisme cellulaire. Ils ont ciblé deux substances connues pour leur effet stimulant sur le métabolisme des cellules, le dichloroacétate (DCA) et la trimétazidine (TMZ). Des tests sur des souris, des rats et des tissus humains ont permis de constater que ces substances permettent de rétablir le fonctionnement normal des cellules artérielles pulmonaires sans entraîner d’effets secondaires nocifs.
«Le fait que la TMZ soit déjà utilisée pour traiter l’angine de poitrine et que le DCA soit à l’étape de tests cliniques chez les humains pour le traitement du cancer du cerveau rend notre découverte encore plus intéressante, car cela implique que leur faible toxicité a déjà été démontrée, explique Sébastien Bonnet. Dans ce contexte, il devient raisonnable d’entrevoir le début rapide, d’ici quelques mois, de tests cliniques chez l’humain.» Outre Sébastien Bonnet, les auteurs de l’étude sont Gopinath Sutendra, Gael Rochefort, Alois Haromy, Karalyn D. Folmes, Gary D. Lopaschuk, Jason R. B. Dyck et Evangelos D. Michelakis, de l’Université de l’Alberta.


























