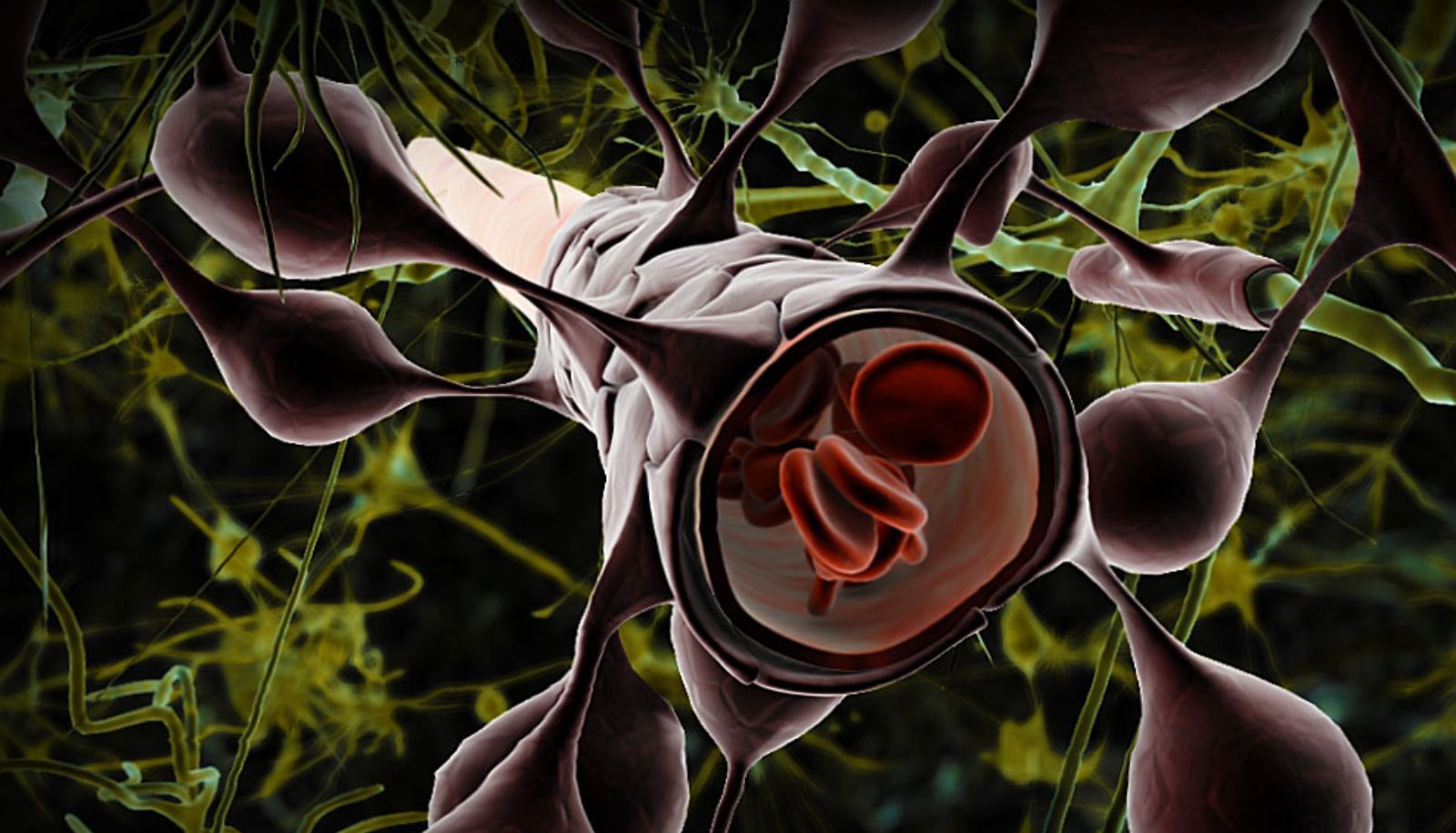Cette idée a plu au NIH (National Institutes of Health) des États-Unis qui vient de lui accorder un montant de 2,6 millions de dollars (US) pour la tester. De concert avec ses collègues Allison Harvey, de la California State University à Berkeley, et Chantal Mérette, de la Faculté de médecine, Charles Morin entend recruter près de 200 sujets insomniaques qui recevront soit le traitement cognitif, soit le traitement comportemental ou encore une combinaison des deux traitements.
«Dans les années 1980, les chercheurs ont découvert différentes techniques psychologiques pour lutter contre l'insomnie (relaxation, contrôle des stimuli, éducation sur les habitudes de sommeil, thérapie cognitive, etc.) et ils les ont combinées dans des traitements, rappelle Charles Morin. Aujourd’hui, il est temps de faire marche arrière et de les décomposer afin d’évaluer la contribution originale de chacune et d’étudier les mécanismes responsables des changements. En bout de ligne, on espère pouvoir proposer des traitements contre l’insomnie mieux adaptés à chaque cas.»
Comme l’insomnie et les problèmes de santé mentale font souvent leur couche dans le même lit – 40 % des insomniaques éprouvent aussi des problèmes psychologiques -, les chercheurs incluront dans le groupe expérimental des personnes insomniaques qui ont des troubles d’anxiété et de dépression afin de déterminer quel traitement s’avère le plus efficace pour elles. L’étude ne débutera que dans quelques mois, mais il est déjà possible de manifester son intérêt à y prendre part (656-2131, poste 6978).
Le professeur Morin est un habitué du NIH. «Ça fait maintenant 20 ans sans interruption que cet organisme subventionne mes travaux», souligne-t-il. Douze projets financés par le NIH sont présentement en cours à l’Université. Celui que dirige Charles Morin dispose de la plus généreuse enveloppe budgétaire.