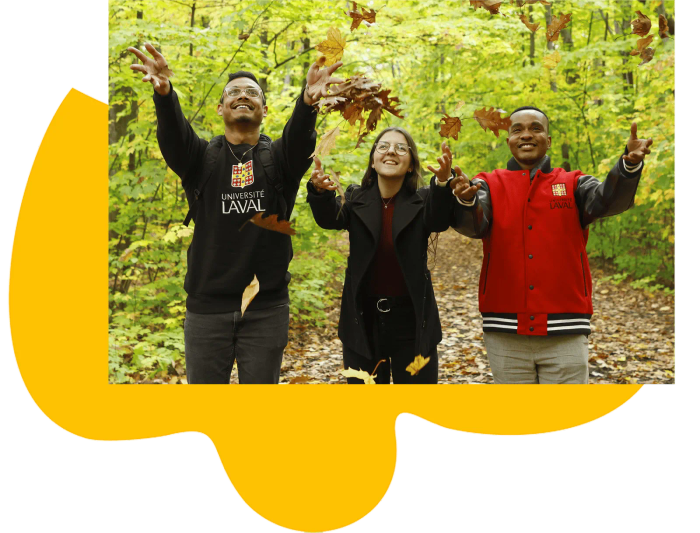Les étudiants réunis en duo ont choisi trois lieux dans la ville, trois lieux qu'ils ont classés dans la catégorie banale, exotique ou à la marge. De cette observation, ils ont tiré des photos ainsi qu'un texte en faisant appel aux théories anthropologiques. Pour la présentation publique du 3 décembre dernier, ils devaient choisir un extrait de leur prose ainsi qu’une ou deux illustrations graphiques insérées dans un diaporama commun. Trois anthropologues invités, Laurent Jérôme, doctorant et membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones, Bernard Roy, professeur à la Faculté des sciences infirmières, et Annie Laliberté, du Bureau international, commentaient leurs travaux.
Des étudiants se sont rendus, par exemple, au Marché du Vieux-Port. A priori un lieu banal, où promeneurs et acheteurs déambulent dans le calme devant les étalages. Pour Alfredo Ramirez, originaire du Chili, cet espace a toutefois des allures très exotiques. «C’est très différent des marchés de chez moi, souligne-t-il. En plus, comme étranger, on pense que cela fait partie de la tradition québécoise d’acheter des produits locaux comme les fromages artisanaux. En fait, c’est une identité en train de se construire.» Le duo qui a travaillé sur la rue du Trésor a eu la même impression. En voyant les touristes acheter des images du Château Frontenac reproduites ad nauseam, Jean-Dominique Hamel-Ratté et Ariane Roy Marin se sont interrogés sur l’authenticité de ce coin de la ville. «Nous avons découvert un monde préfabriqué, un monde artistique construit de toutes pièces afin de répondre aux fantasmes touristiques. Seulement, est-ce les visiteurs étrangers qui produisent ces images stéréotypées ou est-ce nous-mêmes qui participons à cette construction?», écrivent-ils dans leur présentation.
En faisant l’exercice de regarder leur propre ville, les étudiants ont réalisé une des difficultés de l’anthropologie, celle de réussir à prendre une distance, à s’observer soi-même. Ce faisant, comme le constate Bernard Roy, le rapport à l’autre se modifie, et ce qui pouvait sembler marginal au départ devient banal. Patricia Lamotte et Ariane Presseau ont rencontré, entre autres, un tatoueur. Au départ, tout dans son commerce semblait à la marge. Les dessins tatoués sur les corps des clients ou les implants sous-cutanés modifiant l’apparence de la peau parlaient d’une génération underground en milieu urbain. Pourtant, en discutant avec le propriétaire du salon, Jay, les étudiantes ont appris qu’il possédait une maison avec piscine et que la veille il jouait avec sa petite fille dans les feuilles d’automne. Une activité que n’auraient pas reniée des parents fonctionnaires, un profil davantage banal dans la capitale de la province.
Au fil de leurs déambulations dans la ville, les anthropologues en devenir ont donc appris à regarder d’un autre œil les quartiers. Plusieurs ont découvert des restaurants exotiques dans le quartier Saint-Roch, mais en creusant un peu ils ont compris que cet exotisme de pacotille constituait souvent une construction très québécoise. Une immense murale d’une plage ensoleillée ressemble beaucoup au fantasme du Sud de nordiques en manque de chaleur. «Au fond, c’est le stéréotype de la différence, car on est toujours l’extraterrestre de quelqu’un», fait remarquer Bernard Roy. Le passage de la marge à la différence intéresse aussi beaucoup Laurent Jérôme. Le doctorant fait remarquer que l’arrivée de nouveaux commerces dans le «nouvo Saint-Roch», par exemple, tend à transformer la marge en phénomène banal. Des vendeurs de produits d’ici, comme une fromagerie ou une boucherie, participent à la formation d’une nouvelle identité québécoise, car cela devient à la mode d’acheter local.