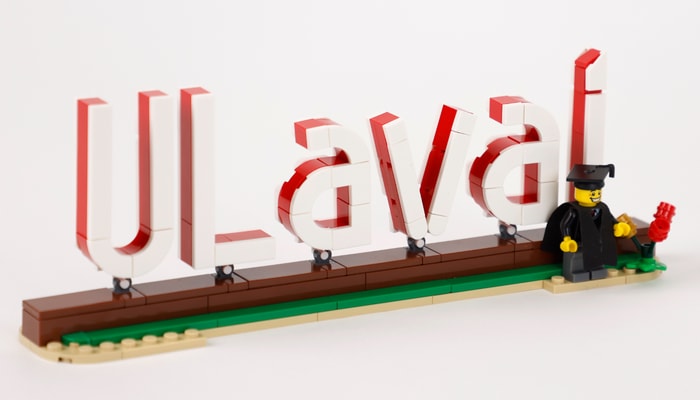Joël de la Noüe chez lui, où il profite d’une retraite bien méritée.
— Martin Roy
Joël de la Noüe nous accueille chez lui, à Saint-Antoine-de-Tilly, pour l’entrevue. C’est ici, dans cette maison entourée de fleurs aux abords du fleuve Saint-Laurent, qu’il profite d’une retraite bien méritée. Depuis les années 1960, le nom de Joël de la Noüe est intimement lié à l’histoire de l’Université.
«J’ai le privilège d’avoir travaillé dans une institution où il y a tellement de talents, lance-t-il d’entrée de jeu. C’est extraordinaire de constater à quel point il y a une concentration de richesses parmi les centaines de collègues rencontrés depuis le début: richesse intellectuelle, mais aussi richesse sur le plan de la passion et du cœur. C’est pourquoi je suis reconnaissant envers l’Université Laval de m’avoir toléré aussi longtemps!»
Le propos est à l’image de l’homme. À la fois intellectuel de renom et grand passionné, Joël de la Noüe s’est dévoué corps et âme pour l’Université. Son engagement a pris diverses formes. D’abord, il y a eu le professeur, celui qui a travaillé dans trois facultés: la Faculté d’agriculture à La Pocatière, la Faculté des sciences et de génie et la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.
Ensuite, il y a eu Joël de la Noüe le chercheur. Au fil de sa carrière, il a publié des articles et mené des travaux de recherche qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Son expertise, multifacette, touche des domaines aussi variés que la physiologie, la nutrition, l’aquaculture et la biotechnologie environnementale.
S’ajoute à cela Joël de la Noüe le bâtisseur. Entre autres organisations, il a contribué à créer l’Union des gradués inscrits à l’Université Laval, devenue l’AELIÉS, et le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval.
«La contribution de Joël de la Noüe est remarquable. Ses collègues ont eu la chance de côtoyer un leader intellectuel de très haut niveau. Des générations d’étudiantes et d’étudiants lui portent un respect hors du commun. Ce bilan de carrière universitaire est exceptionnel. Il rejaillit sur notre communauté encore aujourd’hui», souligne la rectrice Sophie D’Amours.
Né en Tunisie de parents français, Joël de la Noüe a entamé des études à l’Université Laval à son arrivée au Québec en 1956. Depuis, il n’a jamais quitté son alma mater. Devenu professeur émérite en 2005, il a assisté à tous les lancements de chaire de recherche, ou presque, et ne compte plus le nombre d’heures de bénévolat effectuées pour l’Université.
Jusqu’à tout récemment, il était président du Comité des prix et distinctions. Ce groupe anime et coordonne le travail de mise en candidature des membres du corps professoral et du milieu de la recherche à des distinctions, des prix, des médailles et des bourses d’excellence. «Les différents postes que j’ai occupés à l’Université m’ont permis de faire des rencontres qui m’ont donné un vaste réservoir de candidatures potentielles, indique-t-il. J’ai pu maintenir le contact avec des gens que j’estime. Le Comité des prix et distinctions permet de mettre à l’avant-scène des talents qui constituent un attrait pour recruter de nouveaux étudiants. Il joue un rôle très important pour l’institution.»
Lorsque la pandémie a éclaté, l’aventure universitaire s’est brusquement arrêtée pour Joël de la Noüe. Pour lui, une réunion avec des collègues est avant tout une affaire de contact humain, ce qui était impossible avec les mesures de confinement. Ayant peu d’intérêt pour les technologies permettant de tenir des réunions virtuelles, il a choisi de tirer sa révérence, non pas sans regret.
Marie Audette assure l’intérim depuis son départ du Comité des prix et distinctions. Elle l’admet: ce sont de grands souliers à chausser. «Monsieur de la Noüe est quelqu’un qui a un amour et une connaissance profonde de l’Université. Il était la meilleure personne pour être président du Comité des prix et distinctions. Il avait un plaisir manifeste à occuper cette fonction tout en ayant un contact quotidien avec la relève professorale et une connaissance de la réalité des facultés et des centres de recherche», dit-elle au sujet de celui qui a aussi été président de la Commission de la recherche pendant huit ans.
Si elle l’a côtoyé dans le cadre de ses fonctions administratives, c’est d’abord comme étudiante que Marie Audette a connu Joël de la Noüe. En 1978, elle était inscrite au baccalauréat en biologie. De ce professeur, elle retient une grande rigueur, mais aussi le fait qu’il était fort apprécié des étudiants. «Déjà à cette époque, une réputation le précédait.»
En plus de former plusieurs cohortes d’étudiants au premier cycle, Joël de la Noüe a dirigé ou codirigé plus de 90 candidats à la maîtrise et au doctorat. Plusieurs se sont tournés vers l’entrepreneuriat et ont fondé des organisations qui ont fait rayonner le Québec. D’autres sont devenus professeurs à leur tour… pour ensuite prendre leur retraite avant lui. «Ma priorité en tant qu’enseignant, dit-il, était d’éveiller les jeunes à l’importance de la connaissance. Je souhaitais aussi les conscientiser à l’importance d’avoir des références fiables et précises. Bref, nous étions loin de la philosophie des fake news qui fleurit actuellement.»
On l’aura compris, Joël de la Noüe a la relève à cœur. Jean-Paul Laforest peut en témoigner. En 1990, il était un professeur récemment embauché au Département des sciences animales. «Monsieur de la Noüe m’avait invité à joindre un jury d’examen de thèse d’un étudiant dont il était directeur de recherche. C’était l’une des premières thèses que j’avais à évaluer. Après la soutenance, il avait pris le temps, bien gentiment, de me faire parvenir des commentaires constructifs et un mot de félicitations. Pour le jeune professeur que j’étais, ce fut une belle tape dans le dos. C’est l’un des aspects que j’ai souvent retrouvé chez monsieur de la Noüe par la suite: ce côté bienveillant, malgré une aura et une stature qui en imposent», raconte celui qui est aujourd’hui vice-recteur adjoint aux ressources humaines.
Au fil des années, il a travaillé avec Joël de la Noüe dans les divers rôles qu'il a endossés. Après avoir été son collègue, Jean-Paul Laforest est devenu son directeur lorsqu’il a pris les rênes du Département en 1998. «Monsieur de la Noüe était extrêmement occupé, avec un centre de recherche à gérer, des cours à donner et un grand nombre d’étudiants-chercheurs à encadrer. Malgré tout, il était disponible pour me rencontrer à n’importe quel moment. Chaque fois que j’envoyais un courriel aux professeurs pour avoir leur avis sur tel ou tel élément, il était toujours parmi les premiers à répondre. Dans les réunions, il n’hésitait pas à s’exprimer, tout en ayant une très bonne écoute.»
Plus tard, Jean-Paul Laforest est devenu doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation. À ce titre, il a été appelé à participer à de nombreuses réunions de la Commission de la recherche, alors présidée par Joël de la Noüe. «Souvent, nous avions des tonnes de documents à lire, ce que je faisais avec beaucoup de plaisir. Monsieur de la Noüe avait une façon d’écrire absolument délicieuse. Grand érudit, il a une culture extraordinaire qui transparaissait dans ses rapports.»
De fait, le style littéraire de Joël de la Noüe détonnait dans les documents administratifs habituels. Ses rapports empruntaient des chemins poétiques plutôt que de se cantonner dans un langage formel. Ils fourmillaient de clins d’œil humoristiques, le tout dans le plus grand respect de la rigueur universitaire.
À l’instar de Jean-Paul Laforest, Marie Audette a été marquée par l’humour et la finesse d’esprit de son ancien collègue. «Monsieur de la Noüe est un grand amoureux de la langue française, qu’il manie avec brio. Il avait ce talent de pimenter nos rencontres d’un mot d’esprit ou d’un jeu de mots qui, chaque fois, nous faisait rire ou sourire.»
Toujours le feu sacré
À 82 ans, Joël de la Noüe n’a rien perdu de son regard aiguisé sur le monde. Son esprit demeure aussi vif et son amour pour l’Université, intact. «Pour moi, il est important que l’Université continue à jouer son rôle critique et à apprendre aux étudiants à s’adapter à un monde de plus en plus complexe, incertain et, à certains égards, violent.»
Par rapport à la pandémie, il y voit «un bouleversement qui va laisser des traces. De grands défis attendent les professeurs et les chercheurs. J’admire les directions universitaires qui doivent s’adapter à ce contexte qui requiert une réorientation de l’enseignement et de la recherche.»