13 avril 2016
Je suis DD en recherche!
Tout au long des prochains mois, nous vous présenterons les 10 grandes actions en développement durable que vise l'Université Laval pour les trois prochaines années et qui guideront nos gestes collectifs et individuels. Cette semaine: la recherche.
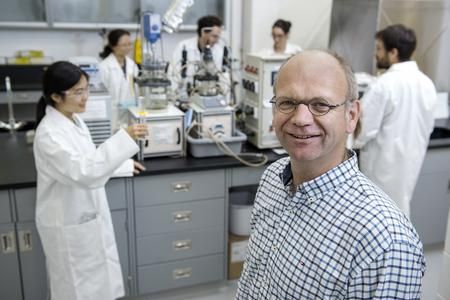
Plus d'une centaine de professeurs travaillent dans le domaine de l'eau sur le campus. On aperçoit ici Peter Vanrolleghem et son équipe dans un des laboratoires de CentrEau.
— Marc Robitaille
Le parcours de ce professeur du Département de génie civil et de génie des eaux est notable. Docteur en technologies environnementales de l'Université de Gand (Belgique), il est nommé titulaire de la Chaire de recherche du Canada en modélisation de la qualité de l'eau de l'Université Laval en 2006. Son équipe de recherche focalise sur la modélisation, particulièrement sur l'eau, à différentes échelles: la station d'épuration, le système intégré réseau d'égouts-traitement-rivière urbaine et les bassins versants. Auteur de plus de 375 publications à travers le monde et siégeant sur divers comités importants, ce bio-ingénieur devient directeur du centre de recherche CentrEau en février 2015. Il est également vice-président de l'Association canadienne de la qualité de l'eau représentant l'Est du Canada.
«L'eau est la ressource la plus fondamentale de la planète. Elle est en fait au coeur même de la vie en société et de la vie communautaire, affirme Edwin Bourget, vice-recteur à la recherche et à la création. Des infrastructures incroyables – telles que des réseaux d'aqueducs, des réseaux d'évacuation d'eau, etc. – nous permettent de vivre en harmonie dans des grandes villes et de bénéficier aisément de cette ressource si précieuse. Cependant, il n'en demeure pas moins que nous nous devons de veiller, en tant que société, à tout ce qui a trait à la qualité de l'eau que l'on boit et que l'on utilise tous les jours, mais aussi au bon fonctionnement de nos réseaux de distribution. Bref, l'eau, source de vie, demeurera toujours un enjeu sociétal».
Protection de la qualité de l'eau en général et des sources d'eau potable, débordement des rivières, problèmes de contamination, etc.: parce qu'il est vital, l'or bleu fait donc souvent et évidemment les manchettes. C'est justement ici qu'entre en jeu CentrEau. Ce centre de recherche interdisciplinaire «favorise la recherche, la formation et le transfert des connaissances dans le domaine des ressources en eau, et a pour mission de promouvoir une vision d'ensemble et transversale des problèmes de gestion de l'eau et d'identifier des solutions novatrices aux multiples défis posés, tant d'un point de vue de la gouvernance que du développement technologique et scientifique», peut-on lire sur son site. Villes et municipalités, gouvernement et entreprises privées: la clientèle de CentrEau est très diverse, tout comme le sont les nombreux projets de recherche en cours et les problématiques étudiées, d'ailleurs.
L'équipe de Peter Vanrolleghem a réalisé, il y a un an, un inventaire des chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'eau sur le campus pour constater que plus d'une centaine de professeurs de domaines très variés s'y intéressent. «On parle, oui, de génie des eaux, mais aussi de sciences sociales, d'économie ou encore, du droit. Et c'est justement notre force chez CentrEau, soit de rassembler divers partenaires et expertises sous le même toit. Cette interdisciplinarité donne non seulement lieu à de belles et grandes innovations dans le domaine, à des ententes et à des collaborations importantes ici et ailleurs sur la planète, mais aussi, conséquemment, à un réseautage incroyable et à des expériences des plus enrichissantes pour nos étudiants», soutient le directeur.
«À l'Université Laval, notre recherche se distingue notamment par plus de 270 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche. Un centre de recherche tel que CentrEau apporte énormément à notre université, poursuit Edwin Bourget. Entre autres, pour l'expertise qu'il génère, mais aussi pour son aspect multidisciplinaire. Aujourd'hui, des ingénieurs, des biologistes, des chimistes, mais aussi des économistes et des juristes sont rassemblés autour d'une table pour mieux comprendre les enjeux sur l'eau. Nos chercheurs ont donc une vision, une analyse des problèmes beaucoup plus holiste, beaucoup plus macro, que dans le passé. Par conséquent, nos étudiants acquièrent donc aussi un spectre de compétences beaucoup plus large qu'auparavant.»
Sur quel genre de projet concret peut travailler CentrEau? Le dossier populaire de sauvegarde du lac Saint-Charles en est un exemple. Désireuse de mieux informer la population sur la situation actuelle de l'eau, mais aussi sur les mesures préventives que celle-ci pourrait prendre dans l'avenir, l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord a fait appel aux experts de CentrEau. «Une équipe du centre s'est donc rendue sur place pour rencontrer les citoyens. Lors d'une séance d'information, nos spécialistes ont expliqué en quoi consiste le traitement des eaux usées, l'impact sur les écosystèmes, l'entretien d'une fosse septique, le remplacement de celle-ci par un autre système, etc.», rapporte Peter Vanrolleghem. Toujours dans le dossier du lac Saint-Charles, l'équipe de CentrEau travaille également ces jours-ci – en collaboration avec la Ville de Québec et l'Unité mixte de recherche en sciences urbaines (UMR-SU) – sur un projet qui vise la surveillance de la qualité de l'eau et la protection à la source. Soutenue financièrement par le gouvernement du Québec, l'UMR-SU est un laboratoire réunissant des chercheurs qui s'intéressent aux technologies intelligentes. L'Université Laval, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), le Parc technologique du Québec métropolitain, la Ville de Québec, Thales Canada et plusieurs entreprises du milieu sont au nombre des partenaires. Chose certaine, les projets ne manquent pas pour CentrEau, qui vise à devenir la référence en matière d'expertise sur l'eau au Québec!
Maintenant, pour conclure de façon plus générale, que nous réserve l'avenir dans le domaine de la recherche, en ce qui concerne les tendances et les perspectives en développement durable? «Je dirais des formations beaucoup plus larges et éclatées. Ce qui implique donc que les organismes subventionnaires, les ministères et autres, doivent commencer à penser qu'ils font de moins en moins affaire à des ultra-spécialistes, mais plutôt à des gens qui sont capables de regarder les choses d'une manière très différente, qui ont une vision très large, beaucoup plus englobante, précise Edwin Bourget. Nos trois grands projets en cours actuellement à l'Université en sont d'ailleurs d'excellents exemples.
D'abord, l'Alliance santé Québec, ce regroupement unique qui comprend des dirigeants d'établissements et des chercheurs provenant de l'Institut de santé publique du Québec, du CHU de Québec et de l'Université Laval – incluant une dizaine de facultés telles que Médecine, Sciences sociales, Sciences de l'administration et Sciences de l'agriculture et de l'alimentation –, des gestionnaires du milieu de la santé et des praticiens de centres hospitaliers, des représentants de l'industrie pharmaceutique de Québec et Québec International. Tous ces intervenants ont d'ailleurs un seul souhait en commun: celui d'innover en santé et de mieux prendre en compte les besoins de la population.
Ensuite, il y a aussi le projet Sentinelle Nord. Un programme phare qui est le fruit d'une réflexion stratégique sur la recherche transdisciplinaire et transsectorielle, et qui met en valeur des domaines stratégiques dans lesquels l'Université est reconnue pour son leadership national et international: les sciences nordiques et de l'Arctique, l'optique et la photonique, la santé cardiométabolique et le cerveau.
Une autre initiative majeure est l'Institut nordique du Québec. Réunissant l'Université McGill, l'Institut national de la recherche scientifique et notre université, ce nouvel institut veillera à fournir les connaissances scientifiques et le savoir-faire technique nécessaires au développement éthique et harmonieux du Nord québécois. Bref, je crois que tous doivent retenir que l'approche du développement durable, c'est-à-dire un «développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs» (rapport Brundtland, 1987), doit non seulement correspondre à une approche très englobante, mais doit aussi toujours viser, au centre, l'individu, puis les populations», de conclure le vice-recteur à la recherche et à la création.
La recherche à l'Université Laval, c'est…
- 1 650 professeurs de toutes disciplines
- 6 principaux établissements de formation clinique
- 325 M$ en fonds de recherche, soit au 6e rang des 50 premières universités de recherche au Canada
- 98 M$ octroyés par le gouvernement du Canada pour développer le projet Sentinelle Nord
- Plus de 270 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche dont
- 3 chaires d'excellence en recherche du Canada
- 81 chaires de recherche du Canada
- 68 chaires de recherche en partenariat
- 39 centres de recherche reconnus par le Conseil universitaire
- Plusieurs stations de recherche en milieu nordique
- Hôte d'ArcticNet, l'un des 14 réseaux de centres d'excellence du Canada
- Au coeur de l'Alliance santé Québec, qui regroupe les acteurs de la recherche en sciences de la santé de la grande région de Québec
- Grand partenaire de l'Institut nordique du Québec, qui vise à fournir les connaissances scientifiques et le savoir-faire technique nécessaires au développement éthique et harmonieux du Nord québécois


























