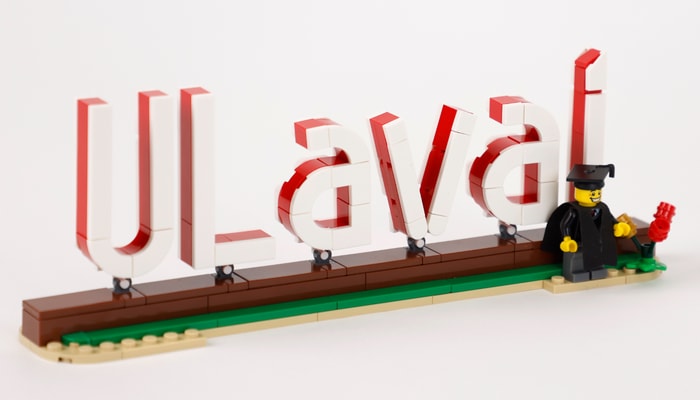Cela fait déjà six ans que les étudiants exposent leurs maquettes au public dans le cadre de leur cours, ce qui a éveillé l’intérêt de plusieurs organismes. La Commission des champs de bataille les a ainsi sollicités pour témoigner des constructions anciennes sur les plaines d’Abraham. Les six maquettes réalisées se trouveront dans une exposition soulignant l’an prochain le centenaire du parc fédéral et les 400 ans de Québec. Une équipe fait ainsi revivre un des bateaux anglais qui a attaqué Québec en 1759, copie conforme d’ailleurs d’un vaisseau français de l’époque. Mathieu Coulombe a eu fort à faire pour tendre des cordages réalistes sur ce navire à voiles. «Cela nous a demandé beaucoup d’efforts, reconnaît-il. C’était passionnant aussi de comprendre comment la vie se déroulait à bord puisque le bateau constitue une véritable ville flottante.»
«Finalement, chaque équipe devient spécialiste d’un type d’habitat particulier», remarque Michel Bergeron. Cet ethnologue-maquettiste a aidé les étudiants à choisir les meilleurs matériaux pour leurs maquettes et les a conseillés sur l’assemblage et la façon de sculpter le bois ou le carton pour obtenir certains effets. Par exemple, il a suggéré à Julie Fournier, Valérie Blais et Catherine Royer-Valiquette d’utiliser du papier pour le revêtement de leurs baraques militaires situées autrefois en arrière du manège militaire. Elles ont dû accomplir un véritable travail de détectives pour les construire à échelle réduite, car elles ne disposaient que de quatre photos en noir et blanc. Bâties dans les années 1940 pour loger temporairement les soldats partant combattre en Europe, ces constructions très sommaires ont été converties en logements sociaux dans les années 1960. «Les articles de l’époque les décrivent comme le «Faubourg de la misère» ou «Punaiseville», raconte Julie Fournier, ce qui donne une idée de la qualité de vie dans ces baraques en planches isolées au papier feutre.» Le trio d’étudiantes en architecture a découvert que des traces de ces bâtiments subsistaient encore à Québec. En effet, des morceaux de ces baraques ont servi à bâtir des maisons unifamiliales sur le boulevard Champlain. Les jeunes femmes ont donc rencontré les propriétaires actuels et pris des photographies afin de dénicher les structures remontant à la construction dans les années 1940.
Marquer l’environnement ou s’y fondre
De leur côté, Marie Panier et Chloé Codron pourraient elles aussi exposer leur maquette qui intéresse le Musée de la mytiliculture à Royans, en France. Les deux Françaises ont remonté le temps pour comprendre comment les carrelets s’accrochent aux côtes de l’estuaire de la Gironde, non loin de Bordeaux. Depuis un siècle, ces constructions en bois sur pilotis se composent d’une passerelle d’une trentaine de mètres et d’une cabane tout au bout. Les pêcheurs s’y installent pour la journée pour plonger leur filet dans l’océan et en retirer du carrelet, autrement dit de la plie, un poisson plat, et des crevettes. «Ce type de construction fait désormais partie du paysage dans le coin, souligne Marie Panier. D’ailleurs, elles ont été reconstruites après qu’une tempête les a endommagées, il y a quelques années.» D’autres maquettes racontent la façon dont les humains s’adaptent à leur environnement, entre autres en érigeant des cabanes extérieures sur les façades de grands bâtiments en Asie pour gagner de la place, ou encore en utilisant les matériaux de la nature.
Ainsi, les maisons en pierre d’un État du centre du Mexique arborent un toit en feuilles de maguey, l’agave américain, une plante grasse utilisée pour la production de tequila et de mezcal. Anciennement, les paysans vivant de la production de ces boissons fortes utilisaient un four extérieur, à l’intérieur de leur propriété délimitée par des cactus. «C’est une façon intelligente d’utiliser l’environnement», remarque Alejandra Perez, qui a construit la maquette. «Aujourd’hui, les gens ont quitté ces vallées pour travailler aux États-Unis, achève son compagnon Abraham Balderas. Quand ils reviennent, ils construisent à l’américaine et abandonnent l’habitat traditionnel.» Ce travail lui a fait prendre conscience de la richesse culturelle de son pays, et de la nécessité de transmettre certaines caractéristiques du passé dans les édifices modernes. «Au début du cours Architecture vernaculaire, j’insistais beaucoup sur la diversité des façons d’habiter partout sur la planète, conclut le professeur à l’École d’architecture André Casault. Aujourd’hui, c’est davantage la parenté de ces différentes constructions qui me frappe, qu’il s’agisse, par exemple, de la manière de creuser des fondations ou de concevoir le faîte d’un toit pour qu’il ne coule pas. Finalement, même la maison la plus banale a des racines longues comme l’histoire de l’humanité.»