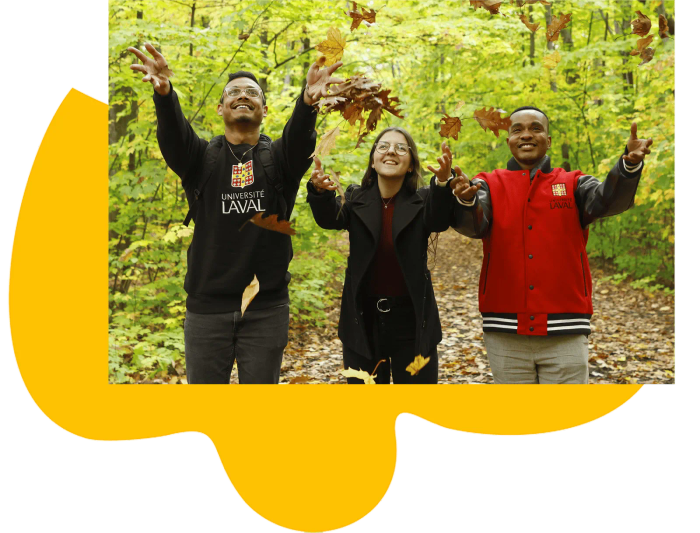Elias Djemil, réalisateur, Richard Fortier, professeur au Département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval, et Éric Légaré, spéléologue chez Spéléo-Québec
— Rachel Trudeau
Avec leur longueur de plus de 2,5 kilomètres, les grottes de Boischatel ont tout pour fasciner les amateurs de spéléologie. Situées à quelques minutes de Québec, près de la chute Montmorency, elles offrent un vaste réseau de galeries souterraines à explorer.
Pour Richard Fortier, professeur au Département de géologie et de génie géologique, l’intérêt des grottes et de leurs environs réside dans le fait que l’on peut y observer divers phénomènes karstiques. «Les pertes d’eau de la rivière Ferrée dans les grottes de Boischatel et son lit asséché au nord du Club de golf Royal Québec font partie de ces phénomènes. Au printemps, lors de la fonte des neiges, les grottes ne peuvent absorber le fort débit d’eau et la rivière Ferrée réoccupe son lit abandonné. L’eau qui s’infiltre dans les galeries souterraines et creuse très lentement d’immenses cavités fait résurgence dans le parc le long de la rivière Montmorency. Il y a aussi d’immenses affaissements de terrain dans le secteur de Boischatel qui sont des signes évidents de l’activité karstique.»
Chaque automne depuis 2013, le professeur Fortier invite les étudiants du cours Méthodes de terrain en génie géologique à visiter les lieux. Plongés dans la peau de géophysiciens qui répondent à un appel d’offre de services fictif, les étudiants doivent effectuer un levé gravimétrique au sol pour détecter les cavités souterraines. L’activité comprend aussi une visite des grottes en compagnie d’un guide-spéléologue, Éric Légaré, de Spéléo-Québec.
«La sortie, chaque année, est parmi les plus appréciées du programme, constate le professeur Fortier. Nos étudiants n’ont pas souvent l’occasion de visiter une grotte. Ils adorent l’expérience. De retour en laboratoire, ils doivent traiter et interpréter les données qu’ils ont récoltées afin de déterminer la localisation et les dimensions des grottes. Cette activité leur permet de toucher plusieurs notions géophysiques et de les préparer à leur carrière professionnelle.»
Lorsque la pandémie a frappé, le professeur s’est tourné vers un plan B. Pour lui, il était hors de question d’annuler cette activité du cours. Il a fait appel à un réalisateur, Elias Djemil, pour filmer une série de capsules vidéo dans les grottes. Les étudiants n’auront qu’à se connecter sur le logiciel Teams, où seront diffusées les vidéos cet automne, pour effectuer une visite virtuelle.
«Dans le contexte de la pandémie, mes collègues et moi avons beaucoup réfléchi sur la façon d'adapter nos cours sur le terrain, raconte Richard Fortier. Certaines sorties se font plus tôt dans la session, mais celle à Boischatel a lieu vers la mi-octobre. Je n’ai pas de boule de cristal sur ce qui peut arriver lors d’une deuxième vague de la pandémie, mais j’ai voulu prévenir le coup et organiser une sortie à distance plutôt qu’en présentiel.»

Filmer dans une grotte, on s’en doute, représente son lot de défis techniques. À commencer par l’éclairage. «Mon but était que les images aient l’air naturel, explique Elias Djemil. Après quelques tentatives d’éclairage, nous avons simplement utilisé les lampes frontales, beaucoup plus efficaces. L’autre défi, c’était l’humidité de l’endroit. Il y avait constamment de l’eau qui tombait sur mon équipement. Parfois, l’objectif de la caméra embuait. Il n’y avait rien à faire à part changer de lieu et attendre.»
Le vidéaste, pourtant habitué de filmer dans différents contextes, a dû sortir de sa zone de confort. «Pour entrer dans les grottes, il fallait ramper à quatre pattes en poussant l’équipement. La claustrophobie était à son comble. Sur le coup, mon corps a figé, mais mon esprit m’a poussé à continuer. Puis, l’angoisse a fait place au plaisir.»
C’est une immersion fort impressionnante qui est proposée dans les vidéos. Outre la visite des galeries souterraines, Richard Fortier et le guide Éric Légaré offrent des explications détaillées du site et de sa topographie. D’autres capsules, filmées par le professeur et son collègue Christian Dupuis, portent sur l’utilisation des instruments de mesure. En tout, une vingtaine de vidéos sont disponibles dans Teams. «Les étudiants peuvent visionner les vidéos à leur rythme et ont toutes les données nécessaires pour effectuer leurs travaux en prenant le contrôle à distance d’ordinateurs dans le laboratoire d’informatique départemental, dit Richard Fortier. De mon côté, je suis disponible en tout temps dans Teams pour les aider s’ils ont des difficultés. En quelques minutes, on peut partager nos écrans et régler le problème.»
Tout ce projet aurait été impossible à réaliser sans le travail d’informaticiens et de responsables des études de la Faculté des sciences et de génie. Avec l’arrivée de la pandémie, ils ont rendu disponibles tous les laboratoires informatiques à distance. Ainsi, les étudiants ont pu finaliser leurs cours en ayant accès, de chez eux, aux logiciels spécialisés. «Ce fut tout un défi. Nous avons changé de paradigme, mais nous avons réussi à nous adapter. Même si la pente d’apprentissage était abrupte, les étudiants se sont appropriés rapidement ces nouveaux outils», se réjouit le professeur Fortier.