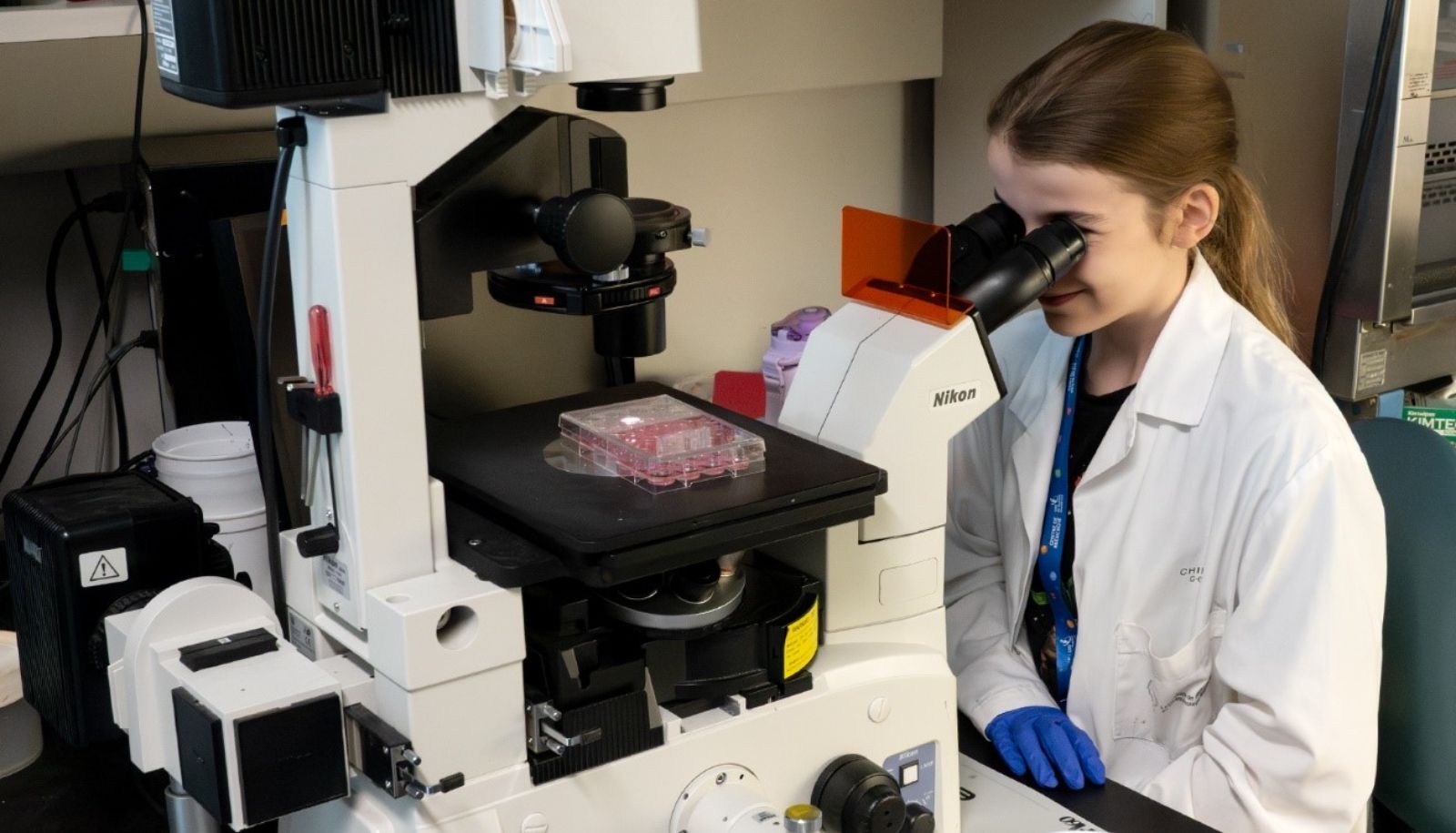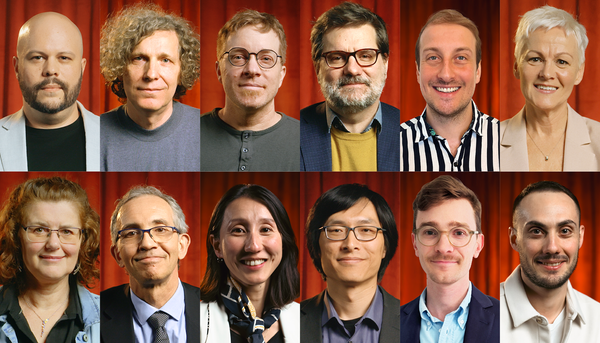Jeanne-D’Arc Astrida fera la présentation du projet d'intervention «Mesure d’adhésion au programme de traitement antirétroviral chez les enfants au Rwanda, cas de la clinique du Trac» le mercredi 12 novembre, à 12 h, au local 3115 du pavillon de l’Est. Ce projet est dirigé par Maria De Koninck. Cette étude de mesure d'adhésion au programme de traitement antirétroviral (ARV) a pour finalité de contribuer à améliorer l'adhésion à ce traitement chez les enfants. Ses objectifs sont de déterminer le pourcentage d'enfants qui ont une adhésion jugée satisfaisante et de décrire les facteurs sous-jacents à ce comportement. Cette étude évaluative a été réalisée auprès de 107 enfants en traitement ARV depuis plus de 2 ans et de 7 professionnels de santé. L'analyse des résultats a montré que 70 % des enfants avaient une bonne adhésion. Elle a aussi permis de dégager les facteurs d'une bonne adhésion ainsi que les barrières à l'adhésion au programme de traitement ARV chez les enfants. À l'issue de cette étude, des interventions visant la promotion de la santé des enfants séropositifs ont été recommandées.
Conférence sur les troubles cognitifs légers
Sylvie Belleville, du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, prononcera la conférence «Évaluation et prise en charge des troubles cognitifs légers» le vendredi 28 novembre, à 12 h, à l’auditorium de l’IRDPQ (525, boul. Wilfrid-Hamel). Certaines personnes âgées présentent des troubles cognitifs légers qui sont détectés lors de l’évaluation neuropsychologique dont la sévérité et l’ampleur sont insuffisantes pour justifier un diagnostic de maladie d’Alzheimer. Or, une importante proportion de ces personnes avec trouble cognitif léger (ou mild cognitive impairment) développe une démence, ce qui en fait une population à haut risque de déclin cognitif. Lors de cette conférence, Sylvie Belleville présentera les données de son équipe portant sur l’évaluation et la prise en charge des troubles de la mémoire chez cette population. Elle parlera également des modifications neuronales associées au trouble cognitif léger et divulguera des données portant sur la façon dont les interventions cognitives modifient les patrons des activations cérébrales associées aux tâches de mémoire dans cette population. Il n'est pas nécessaire de réserver et, pour toute information, on joint Isabelle Argall (isabelle.argall@cirris.ulaval.ca) au 529-9141, poste 6651. Cet événement est organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
La notion du mal de Plotin à Augustin
À l'occasion des Midis du laboratoire de philosophie ancienne et médiévale de la Faculté de philosophie, David Piché, professeur de philosophie médiévale à l'Université de Montréal, viendra donner la conférence «L’ontologie du mal dans l’Antiquité tardive et au haut Moyen Âge» le vendredi 14 novembre, à 11 h 30, au local 078 du pavillon Félix-Antoine-Savard. C’est un lieu commun de l’historiographie d’affirmer que la visée prédominante, voire exclusive, de la réflexion antiquo-médiévale sur le mal aura été de le réduire à néant. La pensée philosophique sur ce thème aurait été définitivement scellée par la thèse augustinienne du mal comme privatio boni: «le mal n’est rien, si ce n’est une privation du bien, sans lequel il ne pourrait pas plus subsister qu’être défini». Or, lorsqu’on examine de près les textes clés qui ont jalonné l’histoire du concept de malum de Plotin à Denys en passant par Augustin et Proclus, on constate que, s’il est vrai que tous ces philosophes pensent le mal sous la notion de non-être, leurs doctrines respectives à ce sujet comportent néanmoins des divergences notables. Le but de cette communication est précisément de mettre au jour les différences conceptuelles qui séparent les thèses de ces auteurs sur la question du mal. La conférence sera suivie d’une période de questions.
Journée des stands internationaux
Le vendredi 21 novembre, à l'Agora du pavillon Alphonse-Desjardins, se tiendra, de 10 h à 16 h, la Journée des stands internationaux. Cet événement annuel, qui reflète bien la richesse multiculturelle des résidences de l'Université, aura pour thème «400 ans d’échanges culturels». Par cette activité d’envergure, le Service des résidences souhaite offrir aux étudiants étrangers l'occasion de représenter leur pays en le faisant connaître à la communauté universitaire et à la population de Québec. Les Antilles, la Chine, le Liban, le Mexique, la Tunisie, l’Égypte ainsi qu’une vingtaine d’autres pays seront représentés cette année. Sur l’heure du dîner, un spectacle de danse et de musique permettra de s'imprégner des rythmes et des sonorités de plusieurs pays. Les commanditaires de l'événement feront aussi tirer de nombreux prix parmi les responsables des stands et leurs bénévoles vers la fin de la journée.
Séminaire REDD-régime post-Kyoto
L’Institut EDS, en collaboration avec le Centre d’étude de la forêt (CEF), organise un séminaire d’introduction à l’initiative REDD, soit la réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement. Ce séminaire aura lieu le vendredi 21 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30, à l'auditorium Hydro-Québec du pavillon Charles-Eugène-Marchand. L'événement, qui vise à initier les étudiants et les chercheurs à la problématique du déboisement évité, réunira trois experts: Catherine Potvin, professeure au Département de biologie de l'Université McGill et spécialiste du déboisement évité; Alison Munson, professeure à la Faculté de foresterie et de géomatique de Laval et spécialiste en séquestration du carbone; Paul Thomassin, professeur en économie rurale à l'Université McGill et spécialiste du marché du carbone. Outre l’état des négociations en cours pour inclure l'initiative REDD dans le futur régime sur le climat post-2012, les participants du séminaire pourront se familiariser avec la nature, le potentiel et les obstacles théoriques et pratiques à l’implantation de REDD de même qu’avec les aspects scientifiques, économiques et politiques de la mise en œuvre de REDD.
Thérapie de groupe pour personnes timides et anxieuses
Le Service de consultation de l’École de psychologie offre, à compter de janvier 2009, une thérapie de groupe s’adressant à des personnes qui se sentent timides et anxieuses dans différentes situations sociales. Cette thérapie sera précédée d’une évaluation individuelle approfondie. L’évaluation et la thérapie seront effectuées par des étudiants qui complètent leur programme de doctorat en psychologie sous la supervision de Martin D. Provencher, psychologue et professeur à l’École de psychologie. Les coûts sont de 40 $ par séance. Les candidats intéressés doivent présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: gène, anxiété dans les relations interpersonnelles, peur d’être jugés par les autres, difficulté à exprimer leurs émotions, leurs besoins ou leurs idées à certaines personnes (ex.: autorité, parents, personnes du sexe opposé, amis ou étrangers), difficulté à amorcer, maintenir ou terminer une conversation, difficulté à accepter ou à faire des compliments ou des critiques, incapacité à faire respecter ses droits et faible estime de soi dans les situations sociales. Pour s'inscrire, il faut communiquer le plus tôt possible avec Chantal Desmeules au 656-5490 du lundi au vendredi entre 9 h à 12 h et entre 13 h 30 à 16 h 30. Le nombre de places est limité.