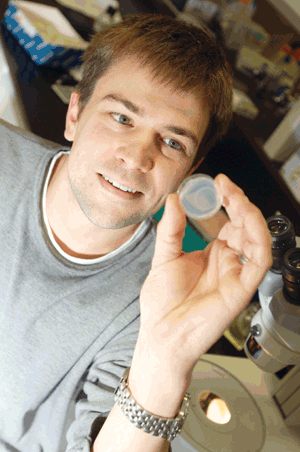
Cette collaboration entre les deux hommes, qui dure maintenant depuis quatre ans, tire son origine d’une petite bête au nom étrange: Caenorhabditis elegans. Ce vers nématode hermaphrodite, qui fait à peine un millimètre de long, a été le premier organisme pluricellulaire à déballer tous les secrets de son bagage génétique. «Mon doctorat faisait appel à des techniques de biologie moléculaire in vitro et je voulais profiter de mon post-doctorat pour diversifier mes connaissances en travaillant avec du vivant, explique Martin Simard. Le génome complet C. elegans avait été séquencé en 1998 et ça me semblait un modèle animal intéressant pour poursuivre mes travaux.» Des confrères lui recommandent d’aller faire un tour du côté de la University of Massachusetts Medical School, où un jeune chercheur, Craig Mello, fait des choses prometteuses avec C. elegans. «Nous étions en décembre 2000. Craig Mello avait publié deux ans plus tôt l’article qui allait lui valoir le Nobel, il était à la tête d’une petite équipe et il n’avait pas encore dirigé beaucoup de post-docs. Il n’avait pas la réputation qu’il a aujourd’hui, mais il était excessivement dynamique et très enthousiaste. Comme mon expertise est en biochimie et que personne dans son équipe n’était spécialiste dans ce domaine, il m’a offert un poste.»
Un an plus tard, en janvier 2002, les deux chercheurs entreprennent leur collaboration sur les ARN non codants de C. elegans, le sujet qui a valu le prix Nobel au professeur Mello et à Andrew Fire. Les ARN non codants, qui comprennent les microARN (miRNA) et les coARN interférents (siRNA), sont de courts segments de nucléotides, qui se trouvent aussi bien chez la levure que chez l’homme, une preuve de leur rôle fondamental chez tous les vivants. Ils interagissent avec l'ARN messager qui transporte l'information génétique entre le noyau et le site de production des protéines et, ce faisant, ils modulent l'expression des gènes, allant jusqu’à en bloquer l’expression. On leur attribue également des fonctions dans la stabilité du génome et dans la protection contre les virus. La synthèse d'ARN non codants en laboratoire a fait exploser l'étude de la fonction des gènes depuis cinq ans puisqu’ils permettent d’atteindre des gènes cibles et ainsi de déterminer leur rôle dans la cellule. On envisage même leur recours pour interférer avec la progression de certaines maladies, notamment les cancers. «C’est devenu tellement gros depuis quelques années que nous savions que ce n’était qu’une question de temps avant que le professeur Mello reçoive le Nobel. Dans le laboratoire, on avait même ouvert des paris pour deviner l’année.»
L’article qui paraît dans Cell – la troisième publication qui portent les noms de Mello et Simard - vient préciser le rôle d’une famille de protéines, appelée Argonaute, qui interagissent avec l’ARN non codant pour empêcher l’expression de certains gènes. «Chez C. elegans, cette famille compte 27 protéines, souligne Martin Simard. Nos résultats suggèrent que non seulement ces protéines interviennent dans plusieurs sentiers métaboliques, mais que certaines agissent aussi de façon séquentielle, une stratégie qui permet de diversifier les étapes au cours desquelles l’ARN messager peut être contraint au silence.»
Martin Simard n’a pas seulement appris à maîtriser des techniques de laboratoire pendant son séjour de trois ans dans l’équipe de Craig Mello. Il en a aussi rapporté une méthode de travail et une façon d’être qui stimulent la créativité. «Le professeur Mello encourage ses collaborateurs à toujours appliquer les résultats positifs ou négatifs de leurs expériences à un modèle, de sorte que chaque étude génère de nouvelles questions et des expériences qui permettent d’avancer, explique-t-il. Sur le plan humain, il réussissait à maintenir un contact quotidien avec les 23 membres de son équipe. J’essaie d’être aussi accessible aux membres de ma propre équipe. Je crois que ça crée une ambiance de travail très stimulante pour les étudiants.»


























