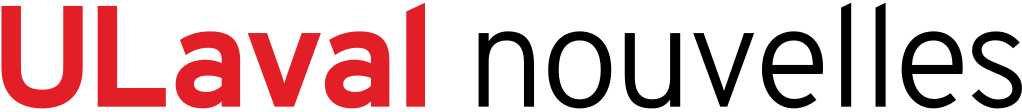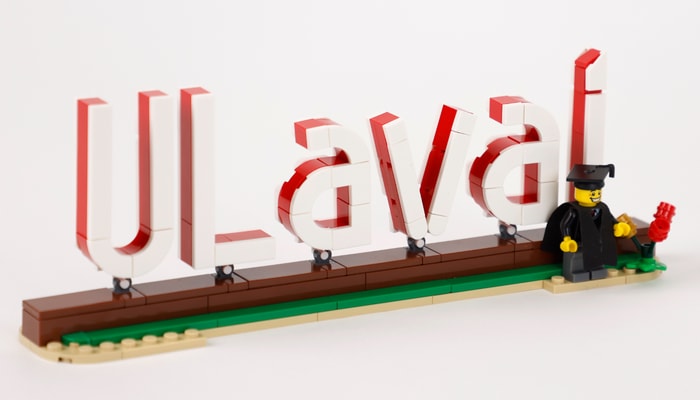Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, en compagnie de sa collègue, la juge Suzanne Côté, le 16 septembre au Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack.
— Étienne Boisvert
C’était salle comble le vendredi 16 septembre, en avant-midi, au Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack. Quelque 400 personnes étaient réunies pour voir et entendre les neuf juges de la Cour suprême du Canada. Cette rencontre a mis un terme à un séjour d’une semaine à Québec, au cours duquel le tribunal d’appel de dernière instance au pays a entendu deux causes en plus de participer à des activités visant un rapprochement avec les citoyens. Il s’agissait de la seconde visite de l’histoire de la Cour suprême hors de la capitale fédérale. Sur le campus, les magistrats du plus haut tribunal au pays ont échangé durant près de trois heures avec des professeurs et des étudiants en droit sur différents aspects de leur réalité professionnelle particulière.
«Vous recevoir à l’Université est un honneur immense», a déclaré, d’entrée de jeu, la doyenne de la Faculté de droit, Anne-Marie Laflamme. Selon elle, les décisions rendues par la Cour suprême, toujours plus complexes, retiennent l’attention. «Elles sont décortiquées dans nos facultés de droit, par segments, au gré des enseignements, a-t-elle poursuivi. Elles sont de plus en plus discutées par les médias et le processus de nomination des juges attire l’attention de manière croissante.»
La rencontre comprenait trois parties, chacune sous la forme d’une table-ronde avec un thème propre. La première table-ronde portait sur le fonctionnement de la Cour suprême et le travail des juges. La professeure Marie-Claire Belleau en assurait l’animation avec l’étudiant au baccalauréat Nima Shareghi.
Le juge Malcolm H. Rowe a expliqué que presque tous les appels entendus par la Cour suprême visent des décisions des cours d’appel provinciales, territoriales, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour d’appel de la cour martiale. «En moyenne, environ 500 demandes d’autorisation sont examinées chaque année et environ 10% sont accueillies, a-t-il précisé. Notre tâche est une combinaison de résoudre des questions spécifiques en même temps que de développer la loi, compte tenu des circonstances et des attitudes des citoyens. C’est un rôle dynamique.»
Lorsqu’il est devenu juge en chef de la Cour suprême en 2018, Richard Wagner a instauré la préconférence. «Auparavant, a-t-il raconté, les neuf juges se réunissaient à 9h30 pour attendre le dossier. On ne se parlait pas à l’avance ni pour explorer formellement ce que sont les véritables enjeux, quelles questions l’on devrait poser aux avocats, identifier ce qui est important. Bref, c’est ce qu’on faisait quand j’étais à la division de Montréal de la Cour d’appel. J’ai instauré ça et je pense que c’est très utile. Cela permet que tout le monde soit au courant de tout ce qui se dit sur un dossier.»
Qui peut soumettre des mémoires, qui peut intervenir? À ces questions, le juge en chef a d’abord rappelé que les parties déposent chacune un mémoire. «Une grande partie du travail des juges de la Cour suprême est de lire, a-t-il dit. On rédige, mais on lit beaucoup. Et on lit tout. Donc les mémoires des parties et la jurisprudence, cela prend une bonne portion de notre temps. Et on lit aussi les mémoires des intervenants. Les intervenants sont des tiers qui ne sont pas partie aux procès comme tels, mais qui peuvent apporter à la Cour une perspective nouvelle et différente de celles de l’appelant et de l’intimé.»
L’importance des auxiliaires juridiques
Le déroulement de la table-ronde a été interrompu par l’arrivée de l’ex-juge à la Cour suprême et juge en résidence à l’Université Laval, Louis LeBel et de sa conjointe Louise Poudrier-LeBel, professeure à la retraite de la Faculté de droit de la même université. Tous deux ont été chaleureusement applaudis à la fois par les personnes sur la scène et par l’assistance. Ils figuraient parmi plusieurs invités de marque, dont la juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec, Catherine La Rosa ainsi que la juge en chef du Québec, Manon Savard.
Dans son allocution, le juge Nicholas Kasirer a rappelé avoir effectué, à la fin de sa formation universitaire, un stage d’un an à la Cour suprême comme auxiliaire juridique. S’adressant directement aux étudiantes et aux étudiants en droit présents dans la salle, le magistrat a mentionné que c’était «une source de bonheur pour nous les juges à la Cour de travailler avec une petite équipe de jeunes juristes qui viennent nous aider à préparer les dossiers, le précis d’audience, et par la suite dans la préparation des motifs, de donner un coup de main en cours de route».
Lorsqu’il était auxiliaire juridique, le juge Kasirer travaillait au sein d’un groupe de 18 jeunes juristes. À partir de l’an prochain, chaque cabinet de juge de la Cour suprême sera doté de trois auxiliaires, soit un total de 27. Aujourd’hui, les jeunes collègues d’autrefois du juge Kasirer sont juges, professeurs de droit, grands avocats et hauts fonctionnaires. La professeure Marie-Claire Belleau et son collègue de la Faculté de droit Pierre Rainville sont du nombre. Quatre autres professeurs de la Faculté ont aussi vécu cette expérience formatrice. Ce sont Fannie Lafontaine, Sylvette Guillemard, Monica Popescu et Louise Langevin.
«Vous vous dites: ce n’est pas pour moi, a-t-il poursuivi. C’est tout le contraire. Les diplômés de droit civil du Québec, qui ont des talents linguistiques que d’autres n’auront peut-être pas, sont exceptionnellement prisés. Techniquement les trois juges du Québec qui siègent à la Cour suprême sont des juges de droit civil. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous des civilistes quelque part. J’ai des collègues qui ne sont pas du Québec et qui ont une formation en droit civil. Et tout le monde travaille en français. Alors vous êtes avantagés. Cette année, j’ai deux diplômés de l’Université Laval dans mon groupe. Les dés ne sont pas pipés en faveur de votre université. Mais c’est pour dire tout le talent qu’il y a dans cette faculté. Quand même, vous êtes bons. Je m’empresse de dire que vous êtes représentés à la Cour suprême par ma collègue la juge Suzanne Côté, diplômée de votre université.»
À cela, le juge Wagner a ajouté que les facultés de droit du Québec procuraient «une grande richesse», celle du bijuridisme composé du Code civil français et de la Common Law britannique.
La plaidoirie écrite, le point d’entrée dans le sujet
La deuxième table-ronde avait pour thème «Les qualités d’une bonne plaidoirie». Étaient présents sur scène, en plus du juge Wagner, ses collègues Russell Brown, Suzanne Côté et Mahmud Jamal. Le professeur Richard Ouellet et la doctorante Salomé Paradis animaient les échanges.
La juge Côté a d’abord expliqué que la plupart des demandes d’intervention sont accueillies favorablement par la Cour et que chaque personne dispose de cinq minutes pour exposer son point de vue. «Ce qu’on souhaite durant ces cinq minutes, a-t-elle souligné, ce n’est pas que la personne lise son mémoire. Elle doit profiter du temps qui lui est imparti pour parfois, par exemple, répondre à une question qu’un juge a pu lui poser et qui a été plus ou moins bien posée par l’appelant ou l’intimé. Évidemment, l’intervenant n’a pas le droit d’apporter des faits nouveaux, ni d’apporter de la preuve nouvelle, ni de soulever une nouvelle question devant les juges.»
Le juge Jamal a pour sa part abordé la question de la durée des audiences. «Cela dépend de la nature de la cause, a-t-il indiqué. La durée est d’une demi-journée à environ deux jours.»
La coanimatrice a ensuite rappelé que certains sont des plaideurs-nés, d’autres développent ce talent avec le temps.
«Les plaidoiries écrites, comme les plaidoiries orales, sont très importantes, a précisé le juge Brown. Les plaidoiries écrites sont le point d’entrée dans le sujet. Les juges de la Cour lisent les mémoires, les auxiliaires juridiques aussi. Nous les discutons entre nous.» Selon lui, «la rédaction juridique est la compétence la plus importance d’un avocat».
Le magistrat a souligné que les meilleurs mémoires ont des qualités certaines. «Il faut, a-t-il dit, sélectionner pas plus de trois arguments parmi ceux que vous avancerez. Le fait que nous permettions 40 pages n’est pas une invitation ou un commandement. Juste une autorisation. À mon avis, la plupart des mémoires sont tout simplement trop longs. Les meilleurs plaideurs écrivent de manière économique, précise mais convaincante. Franchement, la raison pour laquelle les mémoires sont trop longs est fonction de la peur. Nous avons peur de dire trop peu, nous avons peur d’omettre quelque chose. Mais la concision est souvent un produit de votre confiance dans la justesse de votre argumentation. Cela signifie aussi une familiarité avec ce qui est important dans les questions de droit et de faits. Autre point: la franchise. Cela s’applique également aux plaidoiries orales. Je vois souvent deux façons dont les mémoires manquent de franchise. Premièrement en déformant le dossier ou au pire la loi. Deuxièmement, les hyperboles. Évitez les hyperboles.»
Plaider est-il un art ou une science?
La juge Suzanne Côté a renchéri sur la plaidoirie orale. «Je ne pourrai pas m’empêcher de référer à toutes ces années où j’ai été un plaideur, a-t-elle expliqué. J’ai enseigné les techniques de plaidoirie à l’École du Barreau. On se fait souvent demander: plaider est-il un art ou une science? Je dis oui, pour être un bon plaideur, il faut avoir du talent. Mais le talent ne suffit pas. Je dis toujours aux auxiliaires juridiques qu’on a à la Cour que la préparation est essentielle. Si vous n’êtes pas préparé de façon adéquate, vous ne gagnerez pas votre cause. Vous n’arriverez pas à convaincre le juge d’adopter votre position. Parce que quand on plaide, c’est aussi un exercice de conviction, de persuasion.»
Selon le juge Jamal, peu de causes sont gagnées avec la qualité de la plaidoirie orale. «Elles sont gagnées avec les mémoires», a-t-il affirmé. Pour lui, l’avocate ou l’avocat doit se mettre à la place des juges et tenter d’aider la Cour à trancher l’affaire. «Ils doivent aussi aider la cour à développer le droit, a-t-il ajouté. Alors les meilleurs avocats ou avocates gardent en tête les deux fonctions de la Cour suprême.» Les plaideurs doivent aussi répondre aux questions. «Les questions sont une fenêtre sur l’esprit des juges, a soutenu le magistrat. Si un juge soulève une question, il faut répondre immédiatement et de façon claire et directe. Vous n’êtes pas là pour présenter votre argumentation préparée. Les meilleurs plaideurs pensent en avance avec les questions les plus complexes qui peuvent être posées. Pour moi, a souligné le juge Jamal, une plaidoirie orale est surtout une conversation avec les juges. La persuasion implique l’interaction et l’engagement avec les juges, pas simplement la lecture d’un discours.»
La Cour suprême à l’ère des médias sociaux
La troisième table-ronde a réuni les juges Andromache Karakatsanis, Sheila L. Martin et Michelle O’Bonsawin, ainsi que le juge en chef Richard Wagner. Le thème était «La primauté du droit et l’indépendance judiciaire à l’ère des médias sociaux». Le professeur Khashayar Haghgouyan et l'étudiante à la maîtrise Alexane Picard ont coanimé la table-ronde.
«Il y a quelque chose de positif avec les médias sociaux, a expliqué, d’entrée de jeu, la juge Karakatsanis. Il y a, par contre, un problème avec les chambres d’écho de sources d’information souvent anonymes. Les médias sociaux sont un moyen pour informer et la Cour les utilise, notamment pour l’éducation du public. Les gens sont mieux informés aujourd’hui.»
«Est-ce que les juges sont influencés par la réaction potentielle sur les médias sociaux? a-t-elle poursuivi. La réponse doit être: bien sûr que non! Nous avons tous juré d’aborder les questions, avec un esprit ouvert, avec indépendance, avec impartialité. C’est la raison pour laquelle nous avons l’indépendance de la magistrature. Nous sommes les gardiens de la Constitution et de la primauté du droit. Ce n’est pas un concours de popularité.»
Selon la juge Karakatsanis, l’avènement des médias sociaux, comme n’importe quel gros changement sociétal, a touché le travail de la Cour suprême. «En premier, il y a les faits, les enjeux qui se présentent devant nous, a-t-elle indiqué. La croissance des médias sociaux a parfois demandé à la Cour d’ajuster les cadres. Cela veut dire des attentes raisonnables en matière de vie privée qui s’attachent à un ordinateur, à un téléphone cellulaire, aux textos. Je dois dire, moi, toute ma vie est dans un ordinateur!»
Pour sa part, la juge Sheila L. Martin a insisté sur les inconvénients et les risques inhérents aux médias sociaux. «Internet, a-t-elle dit, présente une grande occasion pour communiquer sur ce qu’on fait. Nous avons un site Web pour cela. Nous avons un compte Twitter. Pour moi, c’est un avantage. Pour la Cour, c’est une autre manière de communiquer avec la population. Cela dit, notre travail est basé sur la réflexion. Nous avons 40 pages pour nuancer nos décisions. Or, les médias sociaux, c’est urgent, c’est immédiat. Nous avons rédigé un jugement de 40 pages parce que ça a pris 40 pages pour expliquer les enjeux. D’avoir l’idée qu’on peut exprimer dans sept ou neuf mots la complexité qu’on veut communiquer, ce n’est pas une bonne chose.»
La juge Michelle O’Bonsawin a mis l’accent sur l’importance pour la Cour suprême de bien expliquer ses décisions. «Oui, c’est essentiel que les parties qui comparaissent devant la Cour comprennent les raisons de notre décision, a-t-elle expliqué. Mais plus que ça, une décision de la Cour a un impact national. Nos décisions sont utiles aux différents avocats relativement aux enjeux, à la jurisprudence. Nos jugements détaillés sont également importants pour les cours de paliers inférieurs, les cours supérieures et les cours provinciales.»
Dans son discours de clôture, la rectrice Sophie D’Amours a souligné la chance qu’a eue l’Université Laval de pouvoir accueillir les juges de la Cour suprême. «Ce fut une occasion unique pour les étudiantes et les étudiants de la Faculté de droit qui auront la possibilité, plus tard, de changer le droit et la société», a-t-elle mentionné.

Quelque 400 personnes étaient réunies pour voir et entendre les juges de la Cour suprême.
— Étienne Boisvert