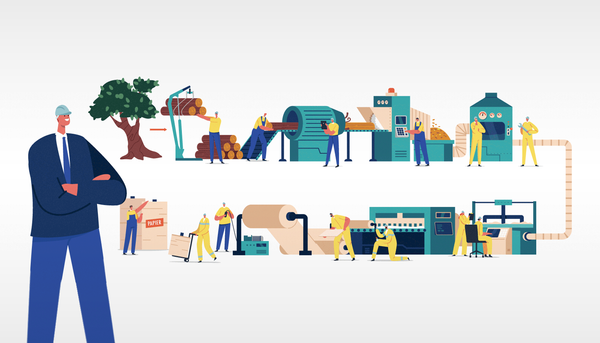Tournage du film Schnidi, le fantôme du Néolithique. Plusieurs films présentés durant le Festival portaient sur la préhistoire et l’archéologie glaciaire. Celui-ci raconte la découverte, sur un glacier suisse, de l’équipement complet d’un homme d’il y a environ 5000 ans. Ses vêtements et ses armes comprennent un arc et des flèches, mais aussi des chaussettes en peau animale assez fine et une combinaison de paille aux vertus thermiques.
— Festival international du film d’archéologie de Nyon
Anne-France Morand est professeure de langue et littérature grecques à l’Institut d’études anciennes et médiévales de l’Université Laval (IEAM). Fin mars, elle a fait partie du jury au Festival international du film d’archéologie de Nyon (FIFAN), en Suisse. Sa présence comme jurée virtuelle s’explique par les liens qui se sont tissés ces dernières années entre l’IEAM et le Festival.
«Dans le cadre de l’Institut, dit-elle, nous avons développé un axe thématique qui aborde les questions de pillage et de destruction de sites archéologiques, notamment par l’organisation terroriste État islamique, et du vol de pièces archéologiques dans des musées. Dans ce cadre, mon collègue Thierry Petit, professeur au Département de sciences historiques, et moi avons été appelés à collaborer à quelques reprises avec un archéologue suisse, professeur à l’Université de Genève et directeur du FIFAN, Christophe Goumand.»
La programmation de cette année comprenait une trentaine de films documentaires, essentiellement de langue française, provenant notamment de France, d’Italie et de Suisse. Leur durée variait de 4 à 5 minutes jusqu’à 90 minutes pour ceux destinés à la télévision et dotés de plus gros budgets. Le Festival a présenté plusieurs films sur l’époque biblique, de même que sur des sujets tels l’Arche d’alliance, Palmyre, Pompéi et le Vatican. Plusieurs autres portaient sur la préhistoire et l’archéologie glaciaire, dont Schnidi, le fantôme du Néolithique.
«Ce film de 92 minutes a comme point de départ la découverte, sur un glacier suisse à l’été 2003, d’un morceau de carquois du Néolithique, raconte Anne-France Morand. Par la suite, une équipe d’archéologues met au jour l’équipement complet d’un homme d’il y a environ 5000 ans. Ses vêtements et ses armes comprennent un arc et des flèches, mais aussi des chaussettes en peau animale assez fine et une combinaison de paille aux vertus thermiques. Le corps, lui, n’a pas été retrouvé, d’où le titre du film.»
La voix de Tarām-Kūbi
Le prix du meilleur film a été décerné à Ainsi parle Tarām-Kūbi, correspondances assyriennes de Vanessa Tubiani-Brun et Cécile Michel. «Ce film d’une grande qualité esthétique, explique-t-elle, donne une voix aux femmes, en l’occurrence à Tarām-Kūbi, une Assyrienne d’il y a environ 4000 ans qui correspondait au moyen de tablettes d’argile cunéiformes avec son frère et son mari, des marchands ayant établi un comptoir commercial en Anatolie centrale, la Turquie d’aujourd’hui. Tarām-Kūbi est très touchante. Elle exprime son désespoir et ses difficultés d’être séparée de son mari. C’est une voix venue directement du lointain passé.»
Le professeur Thierry Petit est un spécialiste de l’archéologie grecque et de l’archéologie romaine. Pendant plusieurs étés, il a effectué des fouilles sur le site du palais royal d'Amathonte, une très ancienne cité-État chypriote située en bord de mer. Au FIFAN, il a présenté le film consacré à la découverte, en 2017, d’un important sanctuaire dédié à la déesse Artémis situé sur l’île d’Eubée en Grèce.
Mentionnons que le prix du meilleur film d’archéologie à petit budget a été attribué à une réalisation québécoise, Trous de mémoire, de Pier-Louis Dagenais-Savard. Le jury a été sensible à son approche introspective, poétique et sincère, ainsi qu’à son questionnement sur le rôle de l’archéologie, sa relation à la terre, à la mémoire et aux ancêtres.
«Les membres du jury ont eu accès aux films avant le Festival, poursuit la professeure Morand. Chacun a fait un classement. La discussion sur le classement final s’est faite par visioconférence. Nos étudiants ont eu accès à ces films. Au total, il y a eu 6700 connexions durant le festival. Les lieux de connexion étaient, par ordre d’importance, en France, en Suisse, au Canada, aux États-Unis et en Belgique.»
À ce jour, Anne-France Morand et Thierry Petit ont organisé à l’Université Laval quelques tables rondes liées aux questions de pillage archéologique et de destruction de sites. En décembre 2019, en présence du directeur du FIFAN, l’Institut a organisé une projection du film Trafic au musée d’Adolfo Conti sur le pillage archéologique et le marché international des objets archéologiques. La discussion qui a suivi a fait l’objet d’un balado.
«Notre collaboration avec le FIFAN se poursuit, souligne la professeure Morand. En mai 2021, Christophe Goumand, Thierry Petit et moi-même présenterons un film sur la notion de génocide culturel lors du colloque annuel de la Société canadienne des études classiques. Nous discuterons de la destruction de la mémoire, soit celle de Palmyre.»