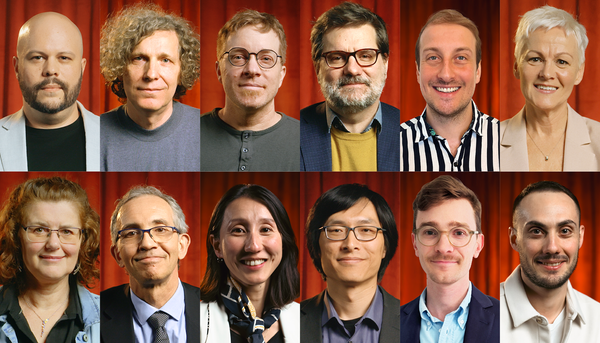Le village de Salluit, au Nunavik. Le cours Initiation à l’inuktitut permettra aux participants de découvrir la culture inuite au moyen de l’étude du vocabulaire et de la structure polysynthétique de la langue.
— Louis Carrier
Ullaakkut. En inuktitut, la langue du peuple inuit habitant le Grand Nord du Québec, ce mot signifie «bonjour». Il fera partie des premiers éléments de vocabulaire du cours Initiation à l’inuktitut, qui débutera le mardi 14 janvier au pavillon Charles-De-Koninck. D’une durée de 15 semaines, ce premier cours sur une langue autochtone offert à l’École de langues de l’Université Laval est ouvert à tous. Il s’adresse en particulier à ceux et à celles qui voyagent dans le Grand Nord, qui y séjournent ou qui travaillent avec des personnes inuites.
«La réponse est extraordinaire, affirme la directrice de l’École, Rachel Sauvé. Environ 75 personnes se sont inscrites en formation créditée ou non créditée. Nous avons également une liste d’attente d’environ 50 personnes. Offrir pour la première fois un cours sur une langue autochtone parlée au Québec et au Canada était presque une nécessité. La demande montre que nous avons vraiment touché un public.»
Les personnes inscrites à ce cours sont autant des professionnels que des étudiants. Il y a notamment des médecins, des infirmières et des professeurs, ainsi que des étudiants en anthropologie ou en médecine. Tous découvriront la culture inuite par l’étude du vocabulaire et de la structure dite polysynthétique de la langue.
Les rênes du cours ont été confiées à la chargée de cours Justyne Chamberland-Poulin. Cette diplômée en enseignement du français langue étrangère s’intéresse depuis des années aux langues vivantes. Son coup de foudre pour l’inuktitut, elle l’a eu lors de son premier stage au baccalauréat, qu’elle a effectué au Nunavik.
«Je suis tout de suite tombée en amour avec la langue et la culture inuites, dit-elle. Les gens sont tellement chaleureux et émotifs. Ils sont attachants, généreux, loyaux. L’inuktitut est ma langue préférée. Je l’adore. Elle comporte beaucoup de sonorités et j’aime les symboles qui en constituent la base. Dans cette langue plutôt concrète, les mots représentent des éléments de leur réalité. Par exemple, on va appeler un chien par un adjectif ou une couleur qui le décrit.»
La chargée de cours travaille comme professeure de langue à la mine Raglan située près de Salluit, à la limite nord du Québec. Elle y enseigne le français aux travailleurs inuits de la mine, qui sont plus de 200. Elle revient très régulièrement à Québec. Cet emploi du temps fait en sorte que, pour les participants, les séances en classe alterneront avec un travail autonome à distance.
«Justyne est une enseignante passionnée, souligne Rachel Sauvé. Grâce à la vie qu’elle a choisie, elle bénéficie d’une immersion constante dans le milieu inuit, un atout formidable.»
La culture inuite est immémoriale. D’abord essentiellement orale, l’inuktitut possède sa propre écriture syllabique depuis le 19e siècle. De nos jours, cette langue est parlée par quelque 30 000 personnes non seulement au Nunavik, mais aussi à l’île de Baffin et au Nunavut.
Le cours vise à initier les participants à l’interaction orale et écrite en inuktitut dans des situations simples de communication de la vie courante. Les objectifs de communication sont de comprendre, de demander et de donner des renseignements simples, qu’il s’agisse de poser des questions pour se renseigner à propos d’une personne ou s’informer sur les conditions météorologiques.
La formation comprend des éléments de vocabulaire et de grammaire. Le lexique inclut les salutations, des adjectifs de description comme «petit» et «jeune», les sentiments et les couleurs. Le volet grammatical touche notamment aux temps verbaux, aux déclinaisons et aux pronoms.
«Cette langue est polysynthétique, ce qui se traduit par des mots souvent très longs, explique Justyne Chamberland-Poulin. Par exemple, l’idée «J’ai bien dormi» s’écrit en un mot composé des éléments dormir, bien et moi.»
En savoir plus sur le cours Initiation à l'inuktitut