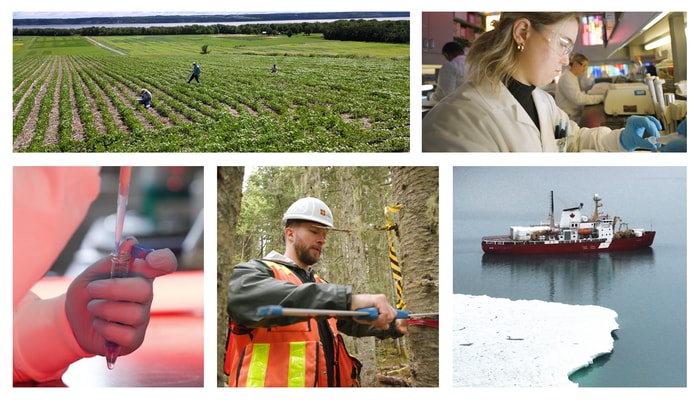Au Québec, le doublage des films étrangers représente un enjeu à la fois politique, économique et identitaire. Sauf exception, le Québec ne peut exporter ses doublages en France en raison de la législation française.
Voici l'un des constats d'une étude réalisée sous la direction de Kristin Reinke, professeure au Département de langues, linguistique et traduction. Ce projet, qui sera présenté ce jeudi durant un séminaire de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord (CEFAN), a pour but de décrire la langue du doublage fait au Québec et de vérifier si les Québécois sont en mesure de l'identifier.
Dans un premier temps, les chercheurs ont déterminé une série d'éléments linguistiques permettant l'identification d'un doublage québécois. Pour ce faire, ils ont analysé les versions française et québécoise de onze longs-métrages récents, soit quatre comédies, quatre films à suspense et trois films d'animation. Par la suite, ils ont invité 42 personnes à écouter 292 extraits présentés de façon aléatoire. À l'aide d'un logiciel, ces participants devaient indiquer si la phrase entendue avait été produite par un Français ou par un Québécois. En moyenne, sur les 292 extraits diffusés, seulement 72 ont été identifiés correctement. «Le test de perception démontre que les Québécois ont du mal à identifier un doublage comme étant fait au Québec. Les traits typiquement québécois ne semblent pas les aider. Ce qui semble les aider, ce sont les voix des comédiens. Les Québécois reconnaissaient la voix de certains doubleurs très connus, et ce, même si l'énoncé ne contenait aucun trait québécois», explique Kristin Reinke.
Parmi ces traits typiquement québécois, la professeure donne en exemple la prononciation des noms propres anglais, qui n'est pas francisée, contrairement à ce qui est fait en France. Or, d'une façon générale, on peut dire qu'il y a très peu de marques distinctives dans les films doublés de ce côté-ci de la frontière. Parfois, on y retrouve même des mots ou des expressions associés à la France, comme «casse-pied», «causer», «boulot», «bousiller» et «se tirer».
La professeure voit là une attitude contradictoire par rapport à la langue. «D'un côté, les Québécois sont fiers de leur langue et, de l'autre, les doublages se font dans un français neutre. Cela pourrait s'expliquer par l'argument économique: selon certains, un doublage sans traits québécois est plus facilement exportable dans la francophonie. On peut également y voir des traces de l'ancienne insécurité linguistique des Québécois, qui ont pendant longtemps dévalorisé leur propre façon de parler. Dans les années 1950, à une époque où l'on corrigeait beaucoup le français québécois, les doublages étaient souvent réalisés par des comédiens français. Aujourd'hui, les Québécois vivent mieux avec leurs différences linguistiques, mais cette insécurité a peut-être implanté des habitudes d'écoute.»
Luc Ostiguy, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Caroline Émond, chargée de cours au Département de langues, linguistique et traduction, ont collaboré à la réalisation de l'étude. Lors du séminaire de la CEFAN, ces chercheurs présenteront leurs observations en compagnie de deux doubleurs professionnels, Sébastien Dhavernas et Benoit Éthier.
Plus d'information sur l'événement