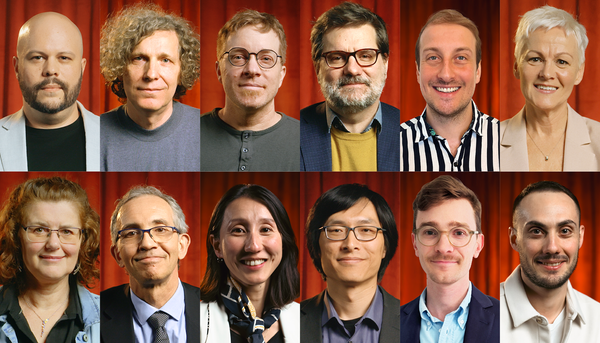Les étudiants prennent la pose en compagnie de l'ingénieur agronome Mario Contreras dans la région d'Ica, au Pérou, devant un arbre de plus de 600 ans.
— Josselin Beaulieu
«Nous sommes passés par plusieurs grands habitats, explique l'étudiante Émilie Carrier. L'observation de la faune et de la flore est une expérience très stimulante! On a pu observer des animaux dans leur habitat naturel, des animaux qu'on ne retrouve pas dans un pays nordique comme le nôtre. Mentionnons la vigogne, l'alpaga, le flamant, l'ara et le condor.»
Les étudiants ont commencé leur périple au Pérou par une excursion en bateau aux îles Ballestas, un archipel situé près de la côte et où vivent des oiseaux marins et des otaries. Ils se sont ensuite dirigés vers le désert côtier, une région très aride et très chaude. De là, ils ont pris la direction de l'altiplano, une région en haute altitude semblable à la toundra québécoise. Sur ces plateaux situés à quelques milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer vit la vigogne, une espèce sauvage menacée, semblable au lama.
Par la suite, les étudiants ont exploré l'altiplano du pays voisin, la Bolivie. Ils ont d'abord visité le Parc national de Sajama. Ensuite, ils se sont rendus dans le Parc national de Madidi étudier la forêt tropicale humide. Celle-ci couvre plus de la moitié du pays. La visite de la forêt amazonienne s'est effectuée en compagnie de deux guides naturalistes locaux parlant l'anglais. Selon Émilie Carrier, la diversité végétale et animale de la jungle profonde est rien de moins qu'exceptionnelle. «On marchait cinq minutes et on se retrouvait devant des plantes différentes de celles que l'on venait de voir, raconte-t-elle. On a aussi vu des traces de jaguar et de puma, mais on n'en a rencontré aucun. Les gros félins sont très timides! On entendait fréquemment toutes sortes de cris et de chants d'oiseaux. Mais ils restaient bien cachés!»
Après la forêt amazonienne, et toujours en Bolivie, le groupe a passé quelques jours dans la savane du Béni. Il a aussi vu l'immense désert de sel de Coipasa d'une superficie de plus de 2 000 kilomètres carrés.
Au Pérou et en Bolivie, les étudiants québécois et leur accompagnatrice ont fait la rencontre de professionnels de la conservation. L'un d'eux était Rolando Guttierez Condori, chef de la protection du Parc national de Sajama, en Bolivie. Au Pérou comme en Bolivie, les aires protégées ont ceci de particulier que des populations locales y vivent. Dans celle de Sajama, les habitants collaborent à la protection de la vigogne. Ce parc national a également comme vocation de protéger la forêt de quenua, la plus haute forêt du monde.
«À Sajama, souligne Émilie Carrier, les gens collaborent bien aux efforts de conservation. On nous a parlé de l'évolution des mentalités avec le changement des générations.
Pendant le voyage, chaque étudiant a fait deux présentations orales préparées avant le départ. Catherine Van Doorn a instruit ses collègues sur le quinoa, une plante nutritive indigène des Andes. Jaimie Vincent, pour sa part, a parlé de la Llareta, une plante à croissance très lente qui, en altitude, forme un coussin compact sur des rochers. La Llareta a presque disparu en raison de son utilisation comme combustible.
Selon Émilie Carrier, les divers programmes de conservation fonctionnels mis en place dans les deux pays peuvent inspirer des solutions originales aux biologistes d'ici. «Les projets qui fonctionnent au Pérou et en Bolivie, dit-elle, nous donnent de l'espoir, puisque malgré le peu de moyens disponibles, des espèces sont protégées ou exploitées de façon durable. Ça nous indique que nous aussi nous pouvons faire de telles actions ici.»