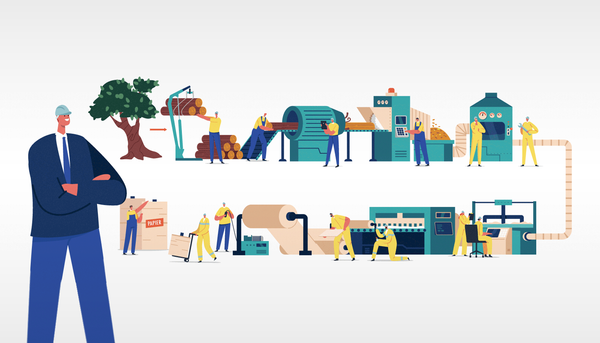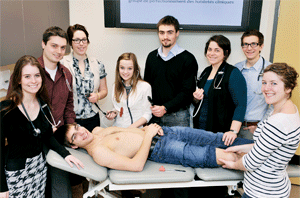
Neuf des dix membres du comité de direction du GPHC: Virginie Kelly, Charles Desfossés, Marie-Hélène Pilon, Maryse Frenette, Antoine Cloutier-Blais, Pascale Breault, Guillaume Plourde et Émilie Alain. Olivier Maillette agit comme patient simulé.
— Marc Robitaille
«Ce lieu d’échange et de pratique a comme objectif de consolider le savoir-faire et d’enrichir les savoirs des étudiants», explique l’étudiant de troisième année Charles Desfossés, président du comité de direction du GPHC. Selon lui, les ateliers offerts par le GPHC permettent aux étudiants au préexternat de s’améliorer. «Notre approche, poursuit-il, est basée sur l’autonomie de l’étudiant. Nous rassemblons des étudiants qui ont la volonté de réviser et de pratiquer toutes les manœuvres de l’examen physique qu’ils apprennent dans leurs cours. Notre approche a ceci de particulier que les étudiants s’entraident à l’intérieur de petits groupes. Les plus avancés transmettent leurs connaissances aux autres.»
L’examen locomoteur du haut du corps
Le prochain atelier du GPHC se tiendra le 29 février au pavillon Ferdinand-Vandry sur l’examen locomoteur du haut du corps. «On va se limiter aux problèmes de l’épaule et du cou, ce qui englobe beaucoup de diagnostics différents possibles», indique Charles Desfossés.
Jusqu’à maintenant, le GPHC a organisé 24 ateliers. Quelques-uns étaient consacrés à des activités particulières en plus grands groupes, comme ceux sur les habiletés de pointe, notamment pour la lecture d’épreuves radiologiques. L’atelier régulier du 29 février est destiné aux étudiants de deuxième et de troisième années. Huit moniteurs superviseront chacun un groupe de six étudiants. «Les huit étudiants de médecine qui agiront comme moniteurs ont tous de l’expertise concernant le thème de l’atelier puisqu’ils ont déjà une formation en physiothérapie», souligne-t-il.
Les moniteurs s’assurent que les étudiants aient des interactions positives et constructives. Ils doivent aussi amener les participants à s’interroger sur l’exécution technique, ainsi que sur les raisons de réaliser telle ou telle manœuvre.
Les cas fictifs soumis aux étudiants se rapprochent de la réalité. On pose des questions au patient simulé pour obtenir les informations essentielles. On procède ensuite à l’examen physique. Enfin, on valide les hypothèses diagnostiques. L’accent est donc mis à la fois sur le développement des habiletés et sur le développement du raisonnement clinique.
Jusqu’à maintenant, les ateliers ont touché à plusieurs sujets, dont le système digestif-urinaire et la cardiopneumologie. Un autre est l’examen neurologique. Pour cet examen, la pratique se fait en équipes de deux et couvre cinq étapes, dont l’examen de la démarche (ex.: faire marcher sur les talons), l’examen des sensibilités (ex.: comparer la température des deux genoux) et l’examen moteur (ex.: rechercher des tremblements actifs). D’un examen à l’autre, un étudiant joue le médecin, l’autre le patient, et vice-versa.
Dans chacun des ateliers, les participants utilisent les instruments médicaux appropriés. «En cardiopneumo, explique Charles Desfossés, nous avons tous un stéthoscope. Pour l’examen neurologique, il nous faut notamment le marteau réflexe.»
Carnets pédagogiques et guide clinique
Le comité de direction du GPHC comprend dix étudiantes et étudiants des trois années du préexternat. Ce comité planifie les ateliers, lesquels se déroulent en semaine de 19 h à 21 h. Il assemble également le contenu pédagogique nécessaire à chaque atelier. La plupart du temps, ce contenu prend la forme d’un document d’une trentaine de pages. Ces carnets pédagogiques portent sur les cas cliniques présentés en atelier et sur l’information scientifique pertinente. Ils sont adaptés au niveau de formation des étudiants et contiennent des tableaux synthèses, des schémas explicatifs et des grilles d’auto-évaluation.
La popularité des carnets a amené le comité de direction à lancer un projet de rédaction d’un petit guide clinique. On y trouvera l’essentiel de l’examen physique, soit plus de 200 objectifs cliniques. «Le guide devrait sortir en version électronique en avril prochain, souligne Charles Desfossés. Plusieurs dizaines d’étudiants y travaillent. D’autres agiront comme réviseurs et des médecins cliniciens réviseront la version finale.»