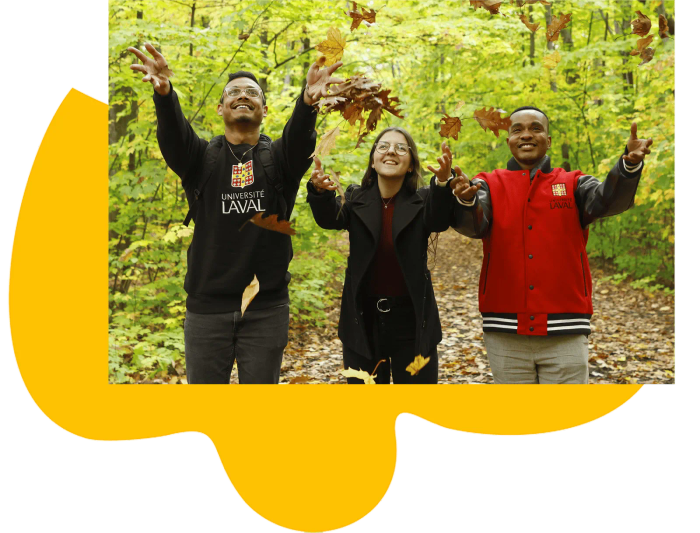Prise de photo par des étudiants québécois et français dans le système volcanique de Krafla, au nord-est de l'Islande. Les coulées volcaniques observées datent du plus récent épisode volcano-tectonique de 1975 à 1984. Cet épisode d'éruptions fissurales était accompagné de fréquents tremblements de terre. La présence des vapeurs chaudes témoigne de cette activité volcanique résiduelle.
Dans la deuxième moitié d’août, le professeur Constantin a accompagné un groupe de 12 étudiants en géologie dans un voyage d’étude de deux semaines en Islande. Cette île d’un peu plus de 100 000 km carrés est située à la jonction de l’Europe et de l’Amérique. Elle a été façonnée principalement par l’activité volcanique. On y trouve une quarantaine de volcans considérés actifs. L’un d’eux, le Grimsvotn, est entré en éruption le 21 mai 2011.
Karine Bélanger, inscrite au baccalauréat en génie géologique, était du voyage. «Un des intérêts de cette excursion, indique-t-elle, consistait à pouvoir comparer des roches volcaniques, qui souvent avaient moins d’un siècle, aux roches que l’on trouve au Québec et qui sont issues de formations géologiques vieilles de centaines de millions, voire de milliards d’années. Les structures géologiques sont les mêmes. Nous avons vu de quoi pouvaient avoir l’air les roches d’ici à leur naissance.»
En deux semaines, le groupe a visité pas moins de 43 sites géologiques sur cette île aux paysages grandioses mais tourmentés où les cimes enneigées dominent bien souvent les montagnes de roche et les champs de cendre. Les excursionnistes étaient constamment dans des conditions de terrain, faisant du camping par beau temps comme par mauvais temps. Dans cette contrée nordique, la température oscillait le jour entre 4 et 14 degrés Celsius.
«En volcanisme moderne, plusieurs sites sont vraiment fantastiques, affirme Marc Constantin. J’ai cependant eu un coup de cœur pour le Laki, un grand système fissural qui se poursuit sur 70 km. En 1783, il a émis de grandes quantités de laves et de gaz, soit du dioxyde de soufre et du fluor. Cette éruption fut la cause de modifications météorologiques d’envergure planétaire avec une baisse de la température moyenne estimée à 10 degrés Celsius.»
Karine Bélanger dit avoir particulièrement apprécié le parc national Thingvellir. L’endroit est le point de rencontre des plaques tectoniques d’Europe et d’Amérique du Nord. Il est fréquemment agité par des secousses. Il y a de nombreuses failles. «Dans cette partie du pays, les failles s’ouvrent d’environ 2 cm par an, souligne le professeur. Cette île est en expansion.»
Le groupe a visité la centrale géothermique de Nesjavellir, située près du volcan Hengill, où l’eau sort de terre à 83 degrés Celsius.
Le lac glaciaire Jokulsarlon est situé au sud du glacier Vatnajokull. «Ce glacier, le plus grand d’Europe, se jette dans un lac, c’est de toute beauté, soutient Karine Bélanger. Nous avons marché sur la langue glaciaire.»
Cet automne, les étudiants remettront leur rapport de voyage individuel sous cinq formats différents. Deux étudiants exposeront, au Département de géologie et de génie géologique, les spécimens de roches qu’ils ont prélevés sur les différentes structures volcaniques de l’île.
«Une excursion géologique a un aspect didactique irremplaçable, explique Marc Constantin. C’est d’autant plus formateur que l’on voit les phénomènes géologiques à grande échelle sur plusieurs kilomètres. L’échelle est également temporelle car on peut voir la superposition des événements géologiques.»