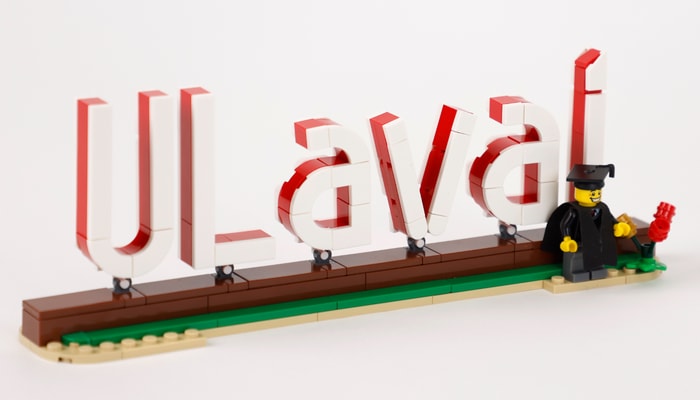La présente période de remise des diplômes favorise la réflexion sur l’évolution de l’université. L’université québécoise suit les tendances des institutions similaires d’Amérique du Nord. Sur une période de cinquante ans et avec l’explosion des connaissances, l’université a pris la voie de la spécialisation: développement impressionnant des dépenses de recherche et établissement d’un nombre considérable de programmes aux cycles supérieurs et en particulier de doctorats. Au début des années soixante, il était peu question d’entreprendre des études avancées au Québec. La priorité donnée à la recherche et aux programmes spécialisés a-t-elle défavorisé un autre secteur de l’université, soit les études de premier cycle ou de baccalauréat?
Quelques données permettent de cerner l’évolution des études de premier cycle. Qu’en est-il de l’évolution du temps scolaire des étudiants à temps complet? Les institutions proposent très souvent la norme suivante: un cours de trois crédits correspond à trois heures de cours en classe et à six heures par semaine de travail hors cours de la part de l’étudiant. Avec une charge normale de cinq cours, le tout correspond à une semaine de travail scolaire de quarante-cinq heures. Cette norme a-t-elle été mise en pratique? Une publication récente a intégré différentes enquêtes sur le temps scolaire des étudiants à temps complet de premier cycle aux États-Unis. Au début des années soixante, la semaine moyenne était de trente-neuf heures, quinze heures en classe et vingt-quatre heures en étude. Cette semaine moyenne est tombée à vingt-sept heures au début des années 2000, soit quinze heures en classe et seulement douze heures d’étude.
Cette baisse de plus de dix heures par semaine de temps d’étude s’applique à tous les sous-groupes comme la présence ou non du travail externe et à ceux qui consacrent généralement plus de temps au travail scolaire comme les femmes et les étudiants en génie. En somme, aujourd’hui, l’étudiant à temps complet est à temps partiel à l’université. L’évolution des notes reflète-t-elle la semaine écourtée des étudiants? La réponse est négative. Au cours des dernières décennies, il y a eu deux phénomènes, soit l’augmentation de la moyenne des notes et leur compression ou la diminution de leur dispersion. Une documentation américaine agrégée et par établissement se retrouve sur le site www.gradeinflation.com.
Un de mes anciens étudiants, Christian Nadeau, a étudié le phénomène à l’Université Laval (essai largement reproduit dans Le Soleil du 24 janvier 2003). De 1988 à 2001, les seize facultés sans exception ont vu croître les moyennes des notes. La dispersion des notes a d’ailleurs diminué dans toutes les facultés sauf une. À la session d’automne 1988, 26 pour cent des notes décernées à la faculté de médecine étaient des A contre 67 pour cent treize années plus tard, soit à l’automne 2001. Il existe un moyen peu compliqué d’expliciter l’inflation des notes. C’est d’inscrire au dossier de l’étudiant sa note avec la distribution des notes pour le groupe. L’informatique facilite cette réforme depuis longtemps.
Il existe une relation entre l’inflation des notes et la baisse du temps d’étude. Une recherche récente basée sur des données de l’Université de Californie à San Diego conclut que le temps d’étude moyen serait environ 50 pour cent plus faible si les étudiants d’un cours s’attendaient à une note moyenne de A au lieu de C.
La dépréciation des études de premier cycle reflète les incitations qu’affronte l’universitaire dans un monde de plus en plus spécialisé. S’il est un excellent communicateur et un intégrateur de connaissances, sa réputation demeure locale, limitée aux étudiants de son unité. De son côté, le chercheur vise la reconnaissance des membres de sa discipline et reçoit les nombreuses décharges d’enseignement à l’intérieur de son université. La promotion dépend des activités de recherche et l’inflation des notes achète la paix. Le professeur généraliste s’apparente à une forme de dinosaure qui peut à la limite conserver un rôle dans les activités administratives et de relations publiques d’un département. La spécialisation a les mêmes effets dans la profession médicale en laissant peu de prestige aux généralistes. Le développement des connaissances valorise la spécialisation.
Comment peut-on améliorer les conditions de formation au premier cycle et contrecarrer les tendances des dernières décennies? La dynamique institutionnelle a peu de chance d’être modifiée de l’intérieur. Pourquoi le serait-elle?
Pour l’économiste que je suis, l’instrument par excellence est celui de la concurrence. Il s’agit ici de favoriser la création d’institutions orientées exclusivement vers la formation des étudiants du premier cycle. Il existe au Québec un exemple de ce type d'établissement, l’Université Bishop’s. Soumises à une telle concurrence, les universités traditionnelles pourraient prendre plus au sérieux la formation de premier cycle. C’est d’ailleurs la recommandation formulée récemment par le Higher Education Quality Council of Ontario.
GÉRARD BÉLANGER
Professeur au Département d’économique