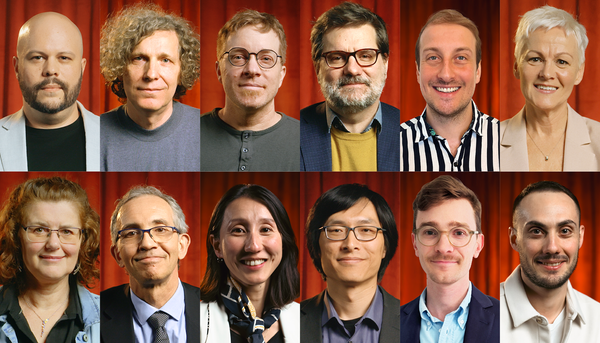Le volcan islandais Eyjafjallajökull. L'activité humaine génère 1,3 fois plus de dioxyde de soufre dans l'air que les sources naturelles.
Lorsqu’il entre en activité le 20 mars dernier, les coulées de lave sur son flanc est attirent surtout les photographes, ravis de saisir des images spectaculaires du magma en ébullition, ces roches fondues à environ 1 200 degrés provenant des profondeurs de la Terre. Les choses se corsent le 14 avril. À ce moment-là, la lave entre en contact avec le glacier au sommet du volcan et le fait fondre en partie, ce que les spécialistes qualifient d’hydrovolcanisme. Le mélange, composé de vapeur d’eau, de gaz volcaniques et de particules de cendre, devient alors véritablement explosif et projette des cendres très haut, jusqu’à 11 kilomètres de la surface terrestre. «Le magma, plutôt que de s’écouler, devient visqueux: il est formé à 58 % de silice», observe Réjean Hébert, professeur au Département de géologie et de génie géologique. Ce sont justement ces particules très abrasives qui inquiètent les responsables de la sécurité aérienne qui craignent que les moteurs d’avion ne soient endommagés comme l’avion de British Airways en 1982, affecté par des cendres volcaniques indonésiennes.
Réjean Hébert souligne que peu de volcans projettent des cendres loin dans l’atmosphère, car la plupart des éruptions ne sont pas explosives. C’est le cas du mont Pinatubo en Indonésie, entré en activité en 1991, qui se compare le mieux à la situation actuelle. «Ce volcan avait émis environ 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère, note le géologue. Les sulfates produits bloquent le rayonnement solaire. Entre 1991 et 1993, on avait observé un refroidissement de moins d’un degré Celsius en moyenne partout sur la planète.»
Pour l’instant, le volcan islandais émet environ 300 tonnes par jour de dioxyde de soufre, ce qui semble donc inférieur aux émanations du Pinatubo. Il faudra cependant attendre la fin de son activité volcanique pour pouvoir faire un bilan. D’autant plus que son voisin beaucoup plus imposant, le volcan Katla, pourrait lui aussi se réveiller, puisqu’il a toujours emboîté le pas au Eyjafjallajökull dans les mille dernières années. Les deux compères partagent sans doute des couloirs de lave communs en profondeur. Impossible cependant de prévoir une éventuelle explosion qui donne peu de signes avant-coureurs.
Toute cette actualité volcanique, et surtout la pollution entraînée par les émanations de soufre, n’inquiète pas Frédéric-Georges Fontaine, professeur au Département de chimie. Il fait remarquer que l’activité humaine génère 1,3 fois plus de dioxyde de soufre dans l’air que les sources naturelles. «À elle seule, l’exploitation des sables bitumineux au Canada produit 430 tonnes de SO2 par jour, note ce spécialiste de la pollution de l’air. Le plus gros producteur mondial de dioxyde de soufre est la Chine avec 25,5 millions de tonnes par année, les États-Unis produisaient en 1999 près de 20 millions de tonnes.» Selon lui, les pluies acides pourraient augmenter ponctuellement en Europe de l’Ouest quelque temps, mais les effets à long terme sur l’environnement de ce nuage de cendres semblent assez faibles. Par contre, le fait qu’il se situe à proximité des routes aériennes rend les choses plus compliquées, reconnaît Frédéric-Georges Fontaine.