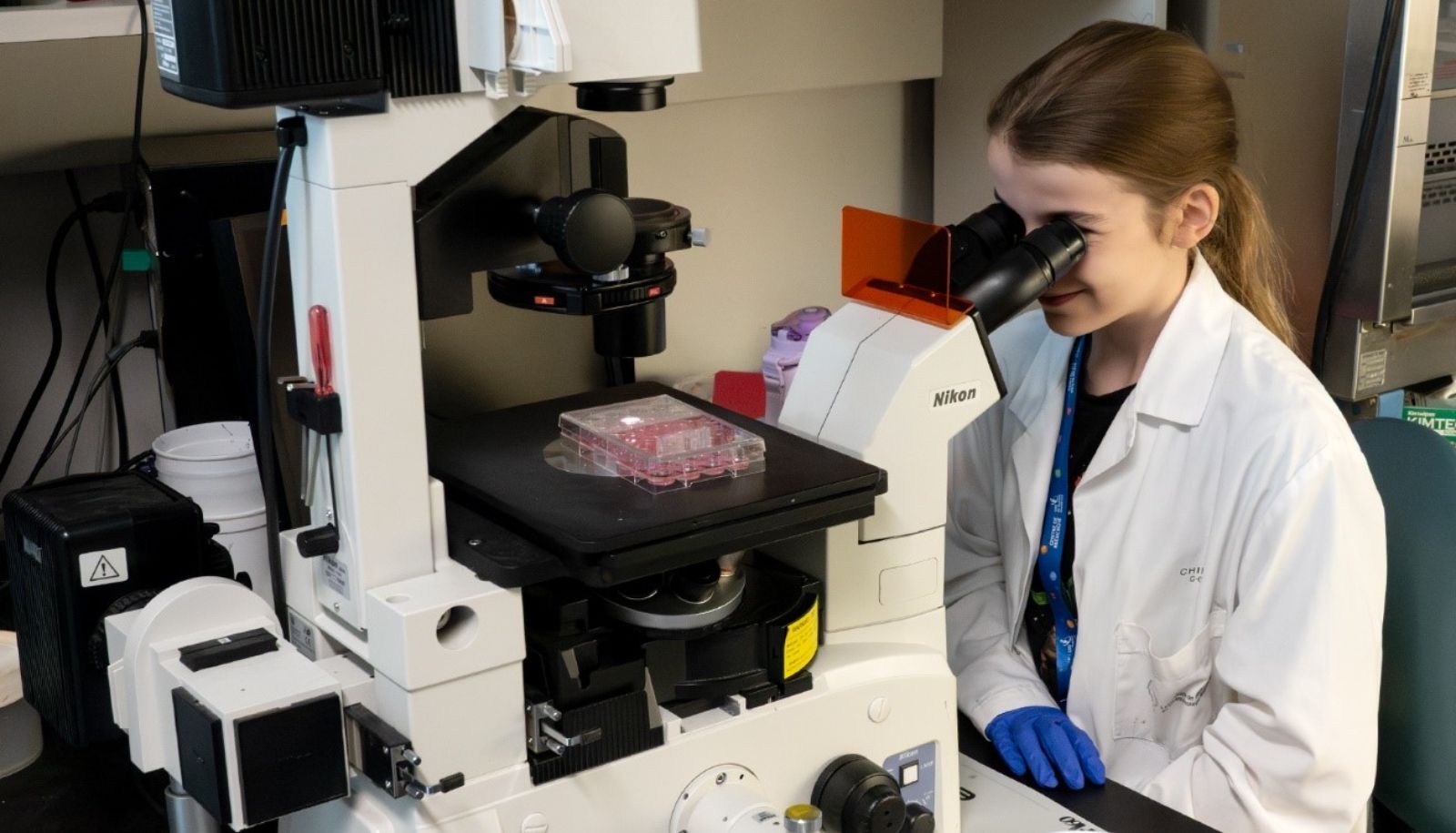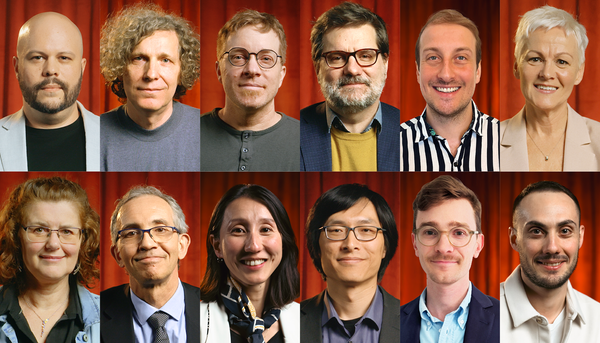Monsieur le Premier Ministre Charest,
La démonstration n’est plus à faire. L’accessibilité des Québécois aux soins de santé et plus particulièrement aux médecins, dans un délai raisonnable, laisse de plus en plus à désirer. Que faire? Afin de résoudre le problème de pénurie de médecins, votre gouvernement a augmenté le contingentement de places dans les facultés de médecine, présumant que ce surplus d'étudiants diplômés viendra bientôt gonfler le nombre de médecins ayant comme lieu de pratique le Québec. Rien de plus incertain, malheureusement, si l’on se fie à la tendance actuelle.
Afin de faciliter l’accessibilité des patients aux médecins, votre gouvernement s’est investi dans une approche qui vise à déshabiller Paul pour mieux habiller Pierre. En voulant favoriser l’accès aux médecins en déléguant de plus en plus de tâches médicales aux infirmières, vous venez ajouter au manque de soins infirmiers dans nos hôpitaux. Toujours afin de prolonger le rôle du médecin, votre gouvernement a aussi décidé d’investir dans la formation de l’infirmière praticienne. Risquer de diminuer encore davantage la prestation des soins infirmiers afin d’augmenter la prestation médicale m’apparaît contre-productif. Vouloir transformer le rôle premier de l’infirmière, qui est de prodiguer des soins infirmiers, en celui d’assistante-médecin va à l’encontre de la réalité américaine actuelle et de la tendance qui semble se dessiner au Canada, qui est de former un professionnel de la santé, l’assistant-médecin.
Qu’est-ce qu’un assistant-médecin? Ce professionnel de la santé assiste le médecin et travaille sous sa direction et supervision. Les tâches particulières qu’il accomplit varient selon le champ d’exercices du médecin qui le supervise et du type de tâches que ce dernier lui assigne. Il agit aussi à titre d'assistant du chirurgien au bloc opératoire, incluant la prestation des soins pré et postchirurgicaux délégués par ce dernier.
Qu’elle est la durée de formation de l’assistant-médecin? Au Canada, tout comme aux États-Unis, la durée de sa formation universitaire est de deux ans, comparativement à trois ans pour l’infirmière bachelière, cinq ans pour l’infirmière praticienne et sept ans pour le médecin généraliste. Les candidats doivent avoir un minimum de deux ans de scolarité universitaire afin d’être admis dans ce type de programme, ce qui représente un total de quatre ans de formation universitaire.
Où travaillent-ils? Aux États-Unis, environ 75 000 assistants-médecins travaillent présentement dans le système de santé. Au Canada, les assistants-médecins travaillent dans les Forces armées canadiennes et plusieurs, depuis 2002, travaillent dans le système de santé manitobain. En 2010, l’Ontario verra sa première cohorte d’assistants-médecins travailler dans son réseau de santé.
Pourquoi le Québec devrait-il former des assistants-médecins? Parce que de demander à des infirmières praticiennes ayant cinq ans de formation universitaire d’agir à titre d'assistants-médecins, alors que nous pourrions en former en deux ans, ne s’inscrit pas dans une politique financière, éducationnelle et de gestion responsable de la part de notre gouvernement. En se dotant de ce nouveau professionnel dans son réseau de santé, le Québec ferait un pas dans la bonne direction en fournissant enfin aux médecins des assistants formés sur mesure pour eux, tout en redonnant aux infirmières leur mission fondamentale et historique, soit la prestation de soins infirmiers. Le grand gagnant sera le patient qui n’aura plus à attendre des mois pour voir un médecin, sachant que son assistant est là, à l’urgence, à la clinique du coin, au CLSC de son entourage, prêt à le recevoir. Les autres gagnants seront les médecins et les chirurgiens qui pourront enfin compter sur les services d’assistants leur permettant de prolonger leur pratique. Le dernier gagnant sera nous tous, contribuables, qui économiseront argent et temps en misant sur la formation moins coûteuse et plus rapide d’un assistant-médecin, plutôt que de miser uniquement sur la formation beaucoup plus coûteuse et longue de plus de médecins et de plus d’infirmières praticiennes.
En espérant que votre gouvernement trouvera matière à réflexion en considérant, parmi les solutions durables à ce problème qui ne cesse de prendre de l’importance, la formation universitaire de l’assistant-médecin.
Veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’expression de ma plus haute considération.
.
ALAIN YVAN BÉLANGER
Professeur titulaire
Département de réadaptation
___________________________________________________________________________
Et si Benoît XVI avait un peu raison?
Dans tout le brouhaha médiatique autour des propos de Benoît XVI au sujet de la prévention du sida, il a été peu question de faits. En voici deux qui sembleraient pertinents à la discussion. (1) Au Cameroun, entre 1992 et 2001, les ventes de condoms ont augmenté de 6 à 15 millions; pendant la même période, l’incidence du sida est passée de 3 à 9 %. (2) Le pays africain qui a eu le plus de succès dans la lutte contre le sida est l’Ouganda qui, entre 1991 et 2001, a réussi à diminuer l’incidence de la maladie de 15 à 5 % ; or, la campagne ougandaise a été axée sur les principes «A-B-C», c’est-à-dire, abstinence en dehors du mariage, be faithful et, si A et B ne sont pas respectés, condom. Selon Edward Green, directeur du AIDS Prevention Research Project au Harvard Center for Population and Development Studies: «In every African country in which HIV infections have declined, this decline has been associated with a decrease in the proportion of men and women reporting more than one sex partner over the course of a year – which is exactly what fidelity programs promote.»
PATRICK DUFFLEY
Professeur titulaire
Faculté des lettres
_____________________________________________________________________________
Trois autres questions à Maria De Koninck
Dernièrement, la professeure Maria De Koninck a commenté les propos du pape sur la lutte au sida (Au fil des événements, 26 mars). Elle semble avoir ignoré la réelle et complète déclaration du pape et omis tout un pan de la littérature scientifique autour de ce sujet. Ses propos nous mènent à lui poser trois autres questions.
Qu’est-ce que le pape a dit exactement?
Une fois de plus, on a fait dire le contraire de sa véritable pensée à quelqu’un que l’on cite partiellement. Car ce que le pape a vraiment dit c’est: «…Je dirais qu'on ne peut pas surmonter ce problème du sida uniquement avec de l’argent, pourtant nécessaire. Si on n'y met pas l'âme, si les Africains n'aident pas (en engageant leur responsabilité personnelle), on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs: au contraire, ils augmentent le problème. La solution ne peut se trouver que dans un double engagement: le premier, une humanisation de la sexualité, c'est-à-dire un renouveau spirituel et humain qui apporte avec soi une nouvelle manière de se comporter l'un envers l'autre, et le deuxième, une véritable amitié également et surtout pour les personnes qui souffrent, la disponibilité, même au prix de sacrifices, de renoncements personnels, à être proches de ceux qui souffrent…» Le pape argumente à l’aide d’une «condition négative», tous comprendront alors que la conclusion n’est vraie que si la condition l’est aussi. Or ce que dit réellement le pape, c’est que si l’on ne se préoccupe pas de l’éducation sexuelle des personnes, alors rien ne sert de leur donner un moyen qu’ils ne sauraient même pas utiliser adéquatement, ou pire, qu’ils risquent d’utiliser d’une manière qui aggraverait le problème.
Selon les scientifiques, le préservatif aggrave-t-il le problème du sida?
Là est tout l’enjeu du débat, les réels propos du pape sont-ils conforment aux connaissances scientifiques en matière de santé? La réponse est oui, plusieurs chercheurs et études sérieuses le confirment. Notons entre autres la célèbre étude parue dans Science en 2004 sur le cas de l’Ouganda; l’article d’Helen Epstein, spécialiste de santé publique dans les pays en voie de développement, publié dans le British Medical Journal en 2008; le commentaire de James D. Shelton publié dans The Lancet en 2007 sur les dix mythes de l'épidémie du sida, dont le sixième mythe est «les préservatifs sont la solution» et, dernièrement, Edward C. Green, directeur de recherche sur la prévention du sida à l'Université Harvard déclarant aux médias que: «tous les indices dont nous disposons vont dans le même sens que ce qu'a dit le pape... Il a été prouvé que les préservatifs ne sont pas efficaces au niveau d'une population.» Tous ces scientifiques en viennent à la même conclusion que le moyen de prévention le plus efficace en Afrique demeure le «modèle abc», basé sur une campagne qui promeut d’abord (A) l'abstinence sexuelle, en particulier pour les plus jeunes, ensuite (B) be faithfull, la fidélité dans le couple et uniquement en dernier ressort (C) la contraception. Le facteur principal du succès de cette méthode résulte de l'éducation et des changements de comportement. Bref, contre le sida, l'éducation est plus efficace que le préservatif, et le préservatif sans éducation aggrave le problème à cause du phénomène connu de «compensation du risque» qui amène celui qui se sent plus en sécurité à prendre plus de risque.
Quels propos sont les plus irresponsables?
Sans retenue, la professeure a qualifié la déclaration du pape de malheureuse, déconnectée de la réalité et irresponsable. Or, ce qui nous apparaît le plus malheureux, c’est d’abord d’inventer une fausse polémique, puisque la position du magistère de l’Église catholique est depuis longtemps connue de tous. Ce qui est malhonnête, c’est de travestir les réels propos du pape. Et ce qui est le plus irresponsable, c’est que de supposés «experts» de ce problème demeurent déconnectés de la réalité et ne connaissent pas, ou pire cachent, des études sérieuses qui pourraient, si elles étaient honnêtement considérées, aider à lutter plus efficacement contre le fléau du sida en Afrique. En demandant l’accès gratuit aux médicaments, la position du pape nous semble cohérente avec les valeurs de vie, de justice et d’équité que toute l’Église prône. Ce qui préoccupe le pape et toute l’Église c’est la vérité et le bien intégral des personnes et non seulement de se donner bonne conscience en saupoudrant l’Afrique de quelques capotes.
SIMON LESSARD
Étudiant à la maîtrise en philosophie