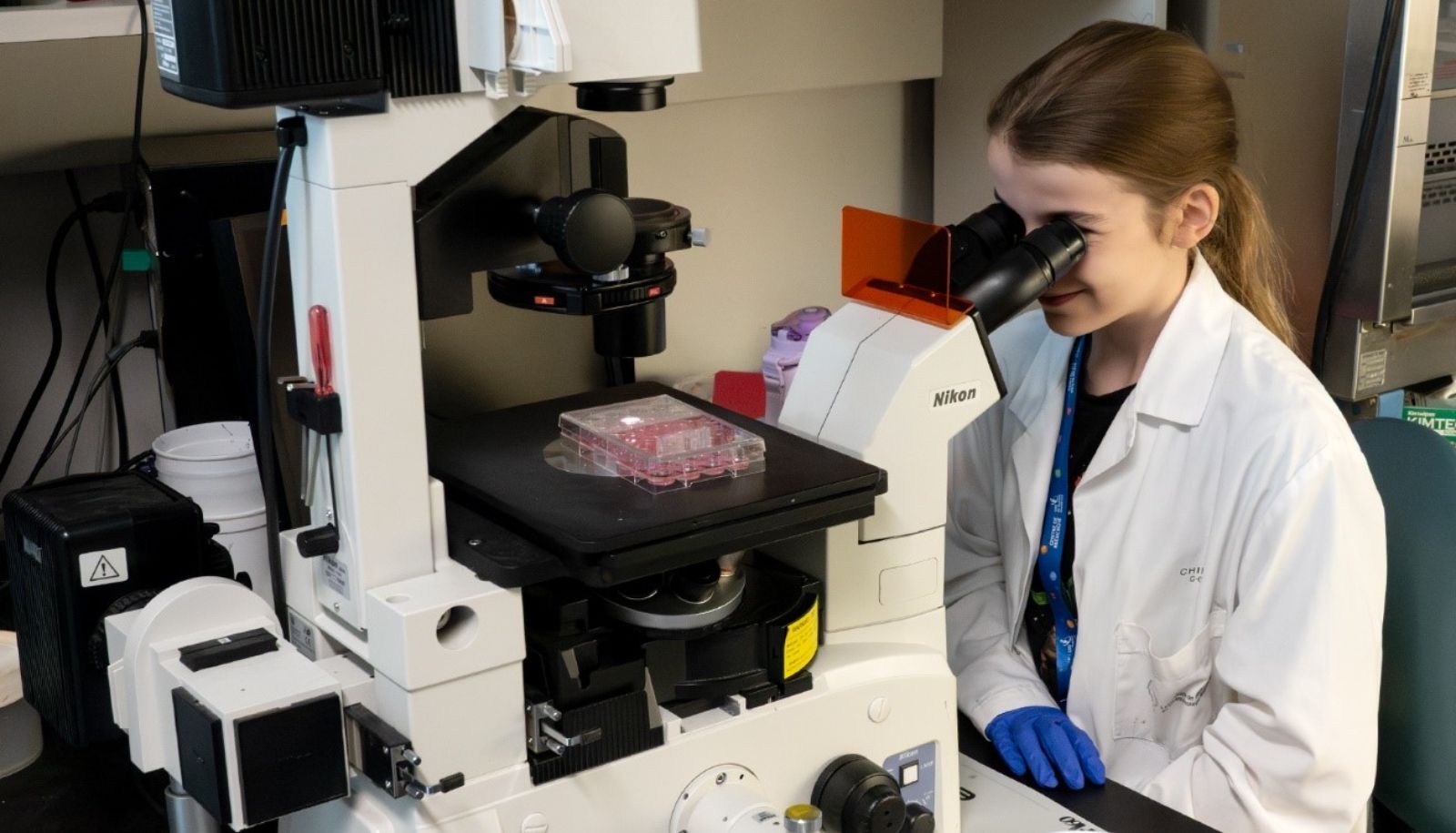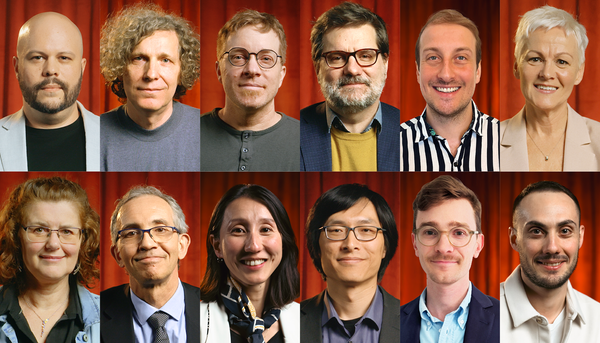Suivent ensuite les migrations massives de populations partant pour les États-Unis. Citant le spécialiste de l’histoire des franco-américains, Yves Roby, Jacques Lacoursière a souligné que les francophones formaient 10 % de la population dans six États de la Nouvelle-Angleterre à la fin du 19e siècle. Ces «Chinois de l’Est», qualifiés ainsi par ceux qui dénigraient leur propension à louer leurs bras pour un bas salaire, ont vécu souvent repliés sur eux-mêmes au sein de Petits Canadas, pas toujours appréciés des Américains. La francophonie se définit alors à l’échelle du continent, qu’il s’agisse des liens avec les populations installées au Nord des États-Unis ou celles de l’Ouest canadien. Jusqu’à la rupture, qui survient lors des États généraux du Canada français en 1967. «L’affirmation nationale québécoise est devenue territoriale, souligne Jacques Mathieu, et les communautés francophones hors Québec se sont senties exclues.» Dès lors, les enjeux des francophones deviennent de plus en plus régionaux, provinciaux, et les préoccupations locales.
C’est peut-être cet éclatement qui explique en partie la difficulté des Québécois aujourd’hui à définir un «Nous» collectif. Se greffe aussi, ajoute Jacques Lacoursière, la montée du phénomène de la mondialisation, qui peut pousser certains à se réfugier dans un pays virtuel. Au fond, les célébrations autour des 400 ans de la ville de Québec constituent peut-être l’occasion pour les citoyens de se rapprocher à nouveau. Conviés à une immense fête de famille, les francophones de souche et les différents groupes ethniques pourraient célébrer ensemble et dans le respect mutuel. Des fêtes bien différentes de celles du tricentenaire où il s’agissait de mettre en valeur les personnages historiques marquants de la naissance de Québec. L’année 2008 pourrait donc donner l’occasion à plusieurs dizaines de millions de francophones et de francophiles des Amériques de bâtir un projet commun.