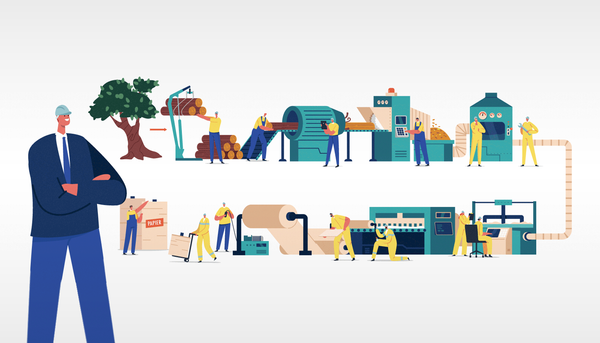Que font au juste ces étudiants de sciences géomatiques que l’on voit mesurer le campus sous toutes ses coutures? De deux choses l’une. Les premiers sont inscrits au cours «Travaux pratiques en topométrie» offert aux étudiants qui terminent leur première année d’études. «Ils apprennent à étalonner des instruments et à effectuer des relevés. Je leur demande de relever un pavillon et cent autres points – des contours de stationnement, des arbres, des bordures de trottoirs, des trous d’homme – et de les transférer sur un plan», explique la responsable du cours, France Plante. Les étudiants doivent aussi résoudre un problème de volumétrie. Cette année, leur professeure leur demandait de calculer le volume des deux buttes situées à proximité de la façade du pavillon Casault. Les étudiants inscrits à l’autre cours, «Travaux pratiques en géodésie GPS», terminent leur troisième année de bac. «On leur demande de faire comme s’ils avaient reçu le contrat d’installer huit nouveaux points géodésiques en utilisant des relevés satellitaires», explique le responsable du cours, Rock Santerre.
Les outils utilisés par les étudiants ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies, mais l’arrivée du GPS n’a pas relégué les instruments traditionnels aux oubliettes. «Les GPS géodésiques sont surtout utilisés pour les travaux à grande échelle, souligne le professeur Santerre. Leur précision est de l’ordre du centimètre.» Pour les travaux exigeant une plus grande précision, les arpenteurs-géomètres s’en remettent à un autre instrument. «Autrefois, on utilisait deux appareils, un télémètre pour mesurer les distances, et un théodolite, pour mesurer les angles, rappelle France Plante. Ces deux instruments sont maintenant combinés en un seul, doté d’une mémoire électronique, qu’on appelle une station totale. Sa précision est de l’ordre de 3 mm par kilomètre.»
Parce que l’Université Laval est la seule institution qui forme les arpenteurs-géomètres du Québec, son campus a deux particularités. D’abord, c’est sur son territoire qu’on retrouve la plus forte densité de points géodésiques, ces petites rondelles de métal fixées dans le béton des rues et des trottoirs qui servent de points de référence. «Il y en aurait environ 150 répartis sur une superficie de 1 km2», estime Rock Santerre. Mais surtout, le campus serait un des sites – sinon le site - le plus arpenté de la province. Depuis le début des années 1970, environ 1500 étudiants de la Faculté de foresterie et de géomatique ont appris les rudiments des techniques de mesure du territoire en parcourant les quatre coins de la Cité universitaire. «Auparavant, entre 1950 et 1970, les camps de formation pratique avaient lieu à la Forêt Montmorency, rappelle le professeur Rock Santerre. Pour des raisons pratiques, on a choisi de revenir sur le campus.» Et où les étudiants arpentaient-ils avant 1950? Les professeurs actuels n’en sont pas trop certains, mais nul doute que plusieurs invités connaîtront la réponse le 3 octobre prochain alors que le Département des sciences géomatiques réunira ses diplômés – plus de 2000 arpenteurs-géomètres ont été formés à l’Université depuis 1907 - ainsi que son personnel actuel et retraité pour marquer dignement le 100e anniversaire de sa fondation.