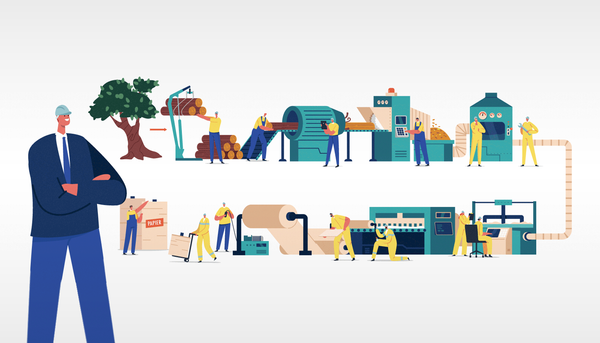La famille Ropana est originaire de la République centrafricaine. À cause de la guerre, madame Ropana et ses trois filles ont pris la fuite au Cameroun en 2014. Elles ont vécu comme réfugiées dans ce pays pendant près de cinq ans. C'est à ce titre qu'elles sont arrivées à Québec en janvier 2019. Elles vivent toujours dans cette ville.
— Stéphanie Arsenault
Il y aurait aujourd’hui presque 80 millions de personnes déplacées dans le monde. Ce chiffre avancé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés correspond à un pour cent de la population mondiale. Résultat de crises multiples, les migrations forcées ont un impact politique, social et économique sur les États et les sociétés. Elles constituent un enjeu contemporain majeur. Au Canada et au Québec, la population de migrants forcés a augmenté au cours des dernières années.
«Les catégories de personnes déplacées reconnues en droit international comprennent notamment les réfugiés, explique Adèle Garnier, professeure et directrice des programmes de 1er cycle au Département de géographie. On évalue entre 20 et 25 millions ces personnes forcées de quitter leur pays parce que leur vie est menacée. Le plus grand nombre de personnes déplacées le sont toutefois au plan domestique, c’est-à-dire qu’elles ne franchissent pas la frontière.»
Une autre catégorie sont les personnes sans État ou apatrides. C’est notamment le cas du peuple rohingya dont on parle beaucoup depuis quelques années. Ce groupe ethnique de Birmanie subit les exactions du gouvernement, qui ne les considère pas comme de vrais Birmans. Ces exactions ont mené à la fuite de plus d’un million de Rohingyas depuis 2016, qui ont trouvé refuge au Bangladesh voisin.
Cet hiver, le Département de géographie offrira un nouveau cours de premier cycle sur cette thématique. Il s’intitulera Exil et territoires: enjeux contemporains des migrations forcées. Le cours commencera le 20 janvier et il est possible de s’y inscrire jusqu’au 26 janvier. Plusieurs aspects seront abordés par la titulaire Adèle Garnier, notamment les causes de ces migrations. Ces causes comprennent les conflits armés, les crises politiques et économiques, les catastrophes environnementales et les changements climatiques.
Selon elle, la Syrie est un bon exemple d’une crise politique dans laquelle le pouvoir en place exerce une répression très importante et où interviennent d’autres pays. «Les populations déplacées sur le territoire se comptent par millions, dit-elle, tout comme celles qui se sont réfugiées à l’étranger.»
Un exemple de crise économique est le Venezuela. Ces dernières années, l’économie de ce pays sud-américain s’est effondrée avec la chute des prix du pétrole. À l’automne 2019, quelque 4,5 millions de réfugiés vénézuéliens vivaient désormais à l’étranger.
Sur les plans environnemental et climatique, le risque de déplacement forcé vient notamment de la sécheresse en Afrique de l’Ouest et de l’élévation du niveau de la mer autour de certaines îles du Pacifique.
Des camps de réfugiés semblables à des villes
En décembre 1950, l’Assemblée générale des Nations Unies créait le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd’hui, plus de 17 000 employés travaillent dans 135 pays à aider des dizaines de millions de personnes déplacées ou réfugiées. Une des responsabilités du Haut-Commissariat est la gestion des camps de réfugiés, en coordination avec d’autres organisations.
«Des centaines de milliers de personnes peuvent vivre dans un camp, indique la professeure Garnier. Par exemple, le camp de Kutapalong au Bangladesh accueillait presque 600 000 réfugiés rohingyas en 2020. Certains camps de réfugiés perdurent pendant des décennies et une certaine infrastructure s’y développe, notamment des écoles et des commerces. Cependant, les pays hôtes des camps souhaitent généralement que les réfugiés retournent chez eux ou s’établissent dans un pays tiers, et ne veulent donc pas que les camps se transforment en véritable villes.»
Parmi les autres aspects qui seront abordés dans le cours, il faut mentionner les organismes internationaux et le cadre juridique international, les politiques migratoires liées aux réfugiés dans les pays d’accueil, la mise en camps, le marché du travail, la migration irrégulière et les villes sanctuaires.
Selon elle, si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre de personnes déplacées dans le monde augmentera plutôt que de diminuer.
«La situation de plusieurs pays d’origine de nombreux réfugiés, tels que l’Afghanistan ou la Birmanie, ne semble pas permettre des mouvements de retour importants dans un futur proche, cependant que de nombreux pays d’accueil se montrent hostiles aux populations déplacées, soutient-elle. Pour mettre fin aux déplacements forcés, il faudrait assurer une paix durable, mais aussi une répartition équitable des ressources sur notre planète, ce qui demande des efforts considérables au Nord comme au Sud.»