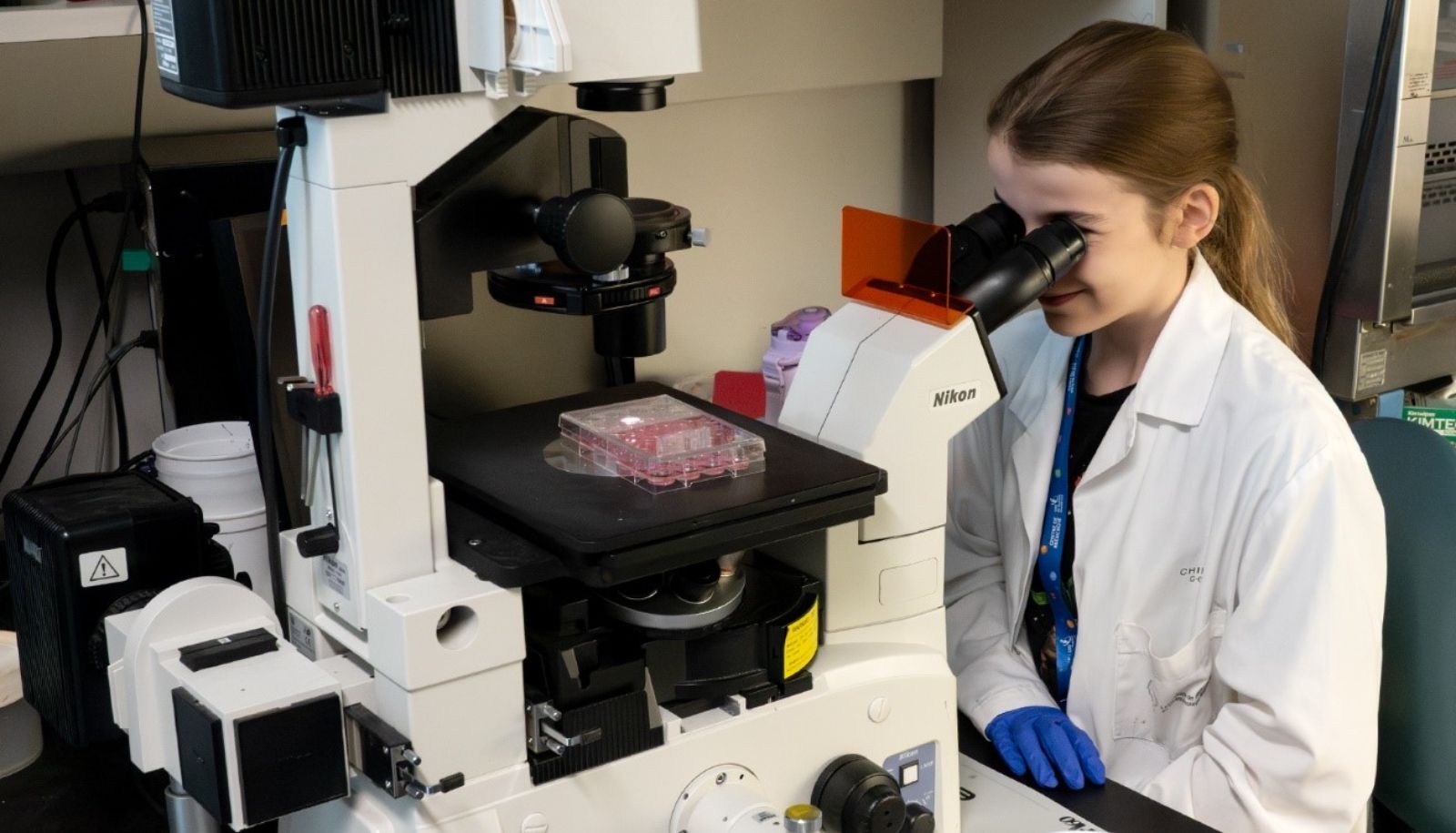La danseuse Laurie Bacon en compagnie de Nadine Rousselot, directrice du Bureau des Premiers Peuples à l'Université Laval le 30 septembre, toutes deux Innues de Pessamit
— Félix Desforges
Chaque année, la journée du 30 septembre représente une occasion d'honorer la mémoire des enfants autochtones disparus, de reconnaître les séquelles encore bien présentes du système des pensionnats et de soutenir les survivantes, les survivants ainsi que leurs familles et leurs communautés. Encore une fois cette année, l'Université Laval a présenté une série d'activités à l'ensemble de la communauté universitaire pour faire connaître les traditions et les savoirs des Premiers Peuples, et ce, dans un esprit de respect, de dialogue et de réciprocité.
La journée s'est déroulée en bonne partie en plein air sur le Grand Axe du campus. Elle a débuté à 8h par une performance de chanteurs et joueurs de tambours autochtones réunis à l'intérieur de la structure de perches d'un tipi. Les accompagnait une personne autochtone qui dansait en cercle autour du tipi. Quelque 150 personnes ont assisté à la cérémonie dans l'air vif du matin, sous un soleil radieux alors que quelques drapeaux flottaient dans le vent.

Le spectacle musical, avec chants et tambours autochtones, a donné lieu à une danse collective autour du tipi.
— Félix Desforges
Édouard Kistabish, Abitibiwinni et ancien chef de la communauté anicinape de Pikogan, a prononcé un mot de sagesse durant la prestation musicale.
«Quand je me suis réveillé, a raconté cet aîné, j'ai parlé à mon Créateur. J'ai demandé de me donner la force d'aller jusqu'au bout. Ce matin était spécial pour moi. Parce que j'ai été huit ans en pensionnat. Ils sont venus me chercher chez nous sur le territoire. J'avais sept ans. Je ne parlais pas votre langue. Pas un mot. Pas un oui, pas un non. Ça a fait mal, au pensionnat. C'est certain que je n'ai pas eu de violence physique, mais de la violence psychologique. On m'appelait de toutes sortes de noms: niaiseux, ignorant…»

L'aîné Édouard Kistabish, de la communauté anicinape de Pikogan, a prononcé un mot de sagesse qui a ému plus d'une personne.
— Félix Desforges
L'Université Laval en appui aux communautés autochtones
La première allocution qui a suivi ce témoignage était celle de Caroline Senécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes. Elle a souligné le plan En action avec les Premiers Peuples, lancé il y a cinq ans par le Conseil d'administration de l'Université Laval. «Par ce plan, a-t-elle dit, l'Université cherche à appuyer les membres des communautés autochtones afin qu'ils tracent leur propre chemin.»
Selon elle, il importe à l'Université de créer un environnement qui respecte les cultures autochtones et dans lequel la communauté étudiante autochtone peut se reconnaître. «À notre manière, a-t-elle poursuivi, nous propageons les valeurs communes autochtones de mieux-être, de collaboration et d'engagement. À l'Université Laval, cela se traduit par des bourses adaptées, des formations dédiées, des structures d'accueil pensées et repensées pour mieux répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants autochtones.»

La vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes Caroline Sénécal a expliqué que l'Université Laval a créé un environnement dans lequel la communauté étudiante autochtone peut se reconnaître.
— Félix Desforges
Dans le même esprit, mentionnons la construction en cours, sur le campus, d'un bâtiment de 7 étages qui comprendra 94 logements, tous destinés aux étudiantes et étudiants autochtones et à leur famille immédiate. L'Université est hôte de ce projet de résidence, ayant rendu le terrain disponible gracieusement.
«Je porte en moi 10 000 ans d'Innu»
Michèle Audette est conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université Laval, en plus de siéger comme sénatrice indépendante à Ottawa. Elle a insisté sur le gilet orange, ce symbole de la commémoration des enfants autochtones décédés et survivants des pensionnats.
«Le gilet orange, qu'on porte aujourd'hui, est un symbole puissant, important, pour se rappeler que c'est pas juste le 30 septembre que j'ai décidé d'être responsable pour enlever la lourdeur que trop de gens ont portée, a-t-elle expliqué. Une lourdeur imposée sur nos épaules. Parce que notre accueil, notre générosité ont été transformés. Je porte en moi 10 000 ans d'Innu. Wow! Trois cent soixante-deux ans de Québécois en moi avec mon père. C'est quand même mon père qui a le power. Mais des institutions ont formé des étudiants autochtones pour devenir des avocats et même des juges! Ça change, parce que vous avez eu le courage de faire différemment.»
Devoir de mémoire
Premier chirurgien autochtone du Québec, conférencier et militant, le Dr Stanley Vollant est originaire de la communauté innue de Pessamit. Il a eu une pensée pour celles et ceux qui sont sortis brisés des pensionnats. «Souvent, ils ont vécu un calvaire, a-t-il rappelé. Ma mère est morte à 52 ans et elle a vécu une vie difficile. C'est un devoir de mémoire pour la population québécoise et canadienne. Il est important de se tendre la main et se dire: On va être capables de faire un nouveau chemin et de guérir ensemble.»
La journée précédente, le Dr Vollant canotait sur le fleuve Saint-Laurent parmi un groupe de 20 personnes autochtones et allochtones. L'expédition mettait fin à un périple de 200 kilomètres à pied et en canot. «Quelle belle expérience que naviguer sur l'autoroute des Autochtones! s'est-il exclamé. Hier, on a fait 49 kilomètres. Pour moi, Jacques Cartier n'était pas un découvreur. C'était le premier touriste français sur ce territoire!»

Le Dr Stanley Vollant a eu une pensée pour celles et ceux qui sont sortis brisés des pensionnats autochtones.
— Félix Desforges
Le présentateur était Ryan Carignan, un Autochtone oji-cri de la Première Nation Pasqua, du sud de la Saskatchewan. Ce titulaire d'un baccalauréat en anthropologie de l'Université Laval est actuellement responsable des partenariats et événements au Bureau des Premiers Peuples. Dans son commentaire, à la fin de la cérémonie, il a dit avoir étudié «l'humain aujourd'hui et non l'histoire de l'humain». Et que les Autochtones ne sont pas «un artefact du passé». «On est là!» a-t-il lancé à la foule avec émotion après avoir rassemblé six étudiantes autochtones sur scène.
Soulignons la présence à cet événement de quelques parlementaires de l’Assemblée nationale: Ian Lafrenière, député caquiste de la circonscription de Vachon, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Pascal Paradis, député péquiste de la circonscription de Jean-Talon, Manon Massé, députée solidaire de la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, André A. Morin, député libéral de la circonscription de l'Acadie, et François St-Louis, député caquiste de la circonscription de Joliette.
Les personnes présentes ont ensuite été invitées à se joindre à une marche organisée par l'Université Laval et par l'organisme Puamun Meshkenu, créé par Stanley Vollant.
Discussion, boîte à livres et table ronde
De 11h30 à 12h30, dans un kiosque installé sur le Grand Axe, des membres du personnel du Bureau des Premiers Peuples ont fait de la sensibilisation aux réalités autochtones en plus de promouvoir les initiatives en cours.
Au même endroit et à la même heure, deux animatrices de la Fondation Nouveaux Sentiers ont répondu à des questions sur des enjeux autochtones, déposées dans une boîte de façon anonyme par le public.
De 11h à 13h, le camion de cuisine de rue La Sagamité a offert un menu composé de poutines, dont une poutine forestière, de burgers de gibier et de burritos végétariens.
De 12h30 à 13h30, à l'Espace Lounge du pavillon Ferdinand-Vandry, le pavillon trifacultaire médecine, pharmacie et sciences infirmières, a eu lieu l'inauguration d'une boîte à livres, une activité trifacultaire contenant 11 ouvrages d'auteurs et d'autrices des Premières Nations.
Enfin, la Faculté de théologie et de sciences religieuses a présenté une table ronde, de 8h30 à 12h15, à l'auditorium Jean-Paul-Tardif du pavillon La Laurentienne. Cet événement a offert un espace de dialogue entre des personnes autochtones et allochtones autour de thématiques liées à l'écologie, les traditions spirituelles et religieuses ainsi que les liens profonds avec les territoires.



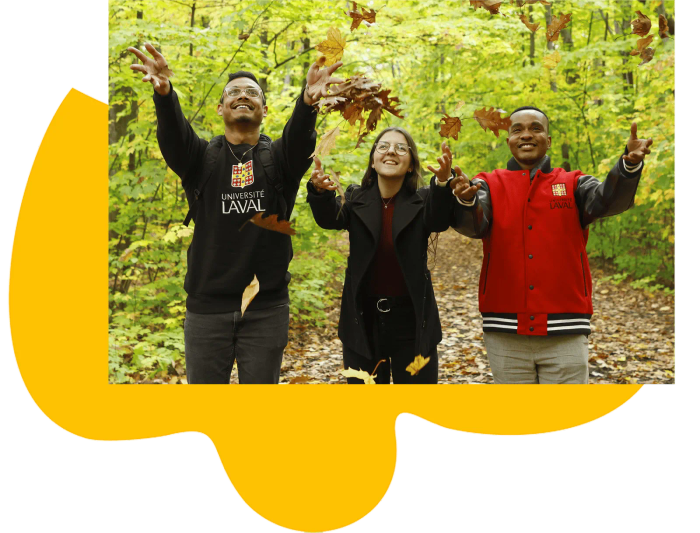



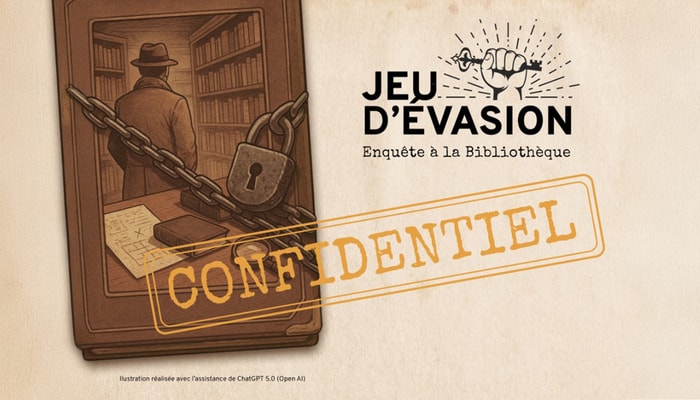

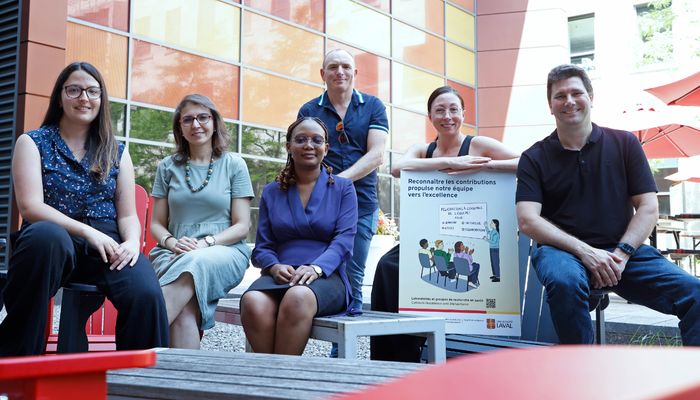



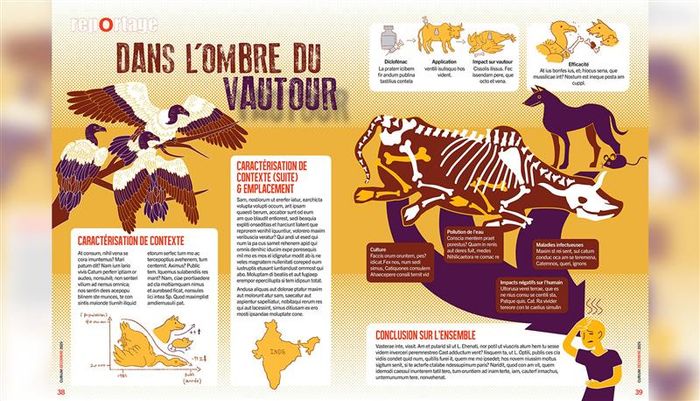

![Le dessin de Thomas Biscaro, à gauche, s'intitule Dystopia of the Omnicidal Landscape. À droite: The [Ordinary Man], par Charles-Antoine Lauzon.](https://assets.ulaval.omerloclients.com/assets/a464e128-97b7-412e-9aa8-f52eab80f4ad.png?quality=md)